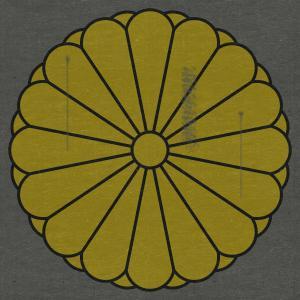
Le jour où IL daignera essuyer Lui-même mes larmes d'Ôé Kenzaburô.
Bonjour, chers lecteurs,
Embarquement, aujourd'hui, pour un Japon fantastique, fantasmé au jour de Rabelais et Mark Twain, peuplé de familles qui se déchirent, hanté de Pantagruel vicieux barbotant aux côtés de Tom Sawyer sous le soleil noir d'Hiroshima. Bienvenue dans le monde d'Ôé Kenzaburô.
La nouvelle, mais qui, épaisse pour une production japonaise, est peut-être un roman, le texte en tout état de cause, est le fait d'un malade, faux cancéreux et vrai grabataire qui, du fond de son lit d'hôpital, le regard plongé dans une nuit perpétuelle en raison des lunettes de plongée fumées héritées de son passé, se souvient de sa vie misérable, passée à vouloir justifier un père faible et brisé devant une mère impitoyable. Reviennent au jour les souvenirs, les tentatives de suicide ratées, les mutilations et les scarifications, la violence sourde qui habitait son cœur d'adolescent, toute cette douleur qui remonte à la façon dont les jours les plus heureux de sa vie, ces fameux « happy days » dont il promet sans cesse le récit repoussé et différé, - centre d'une vie approché par lents cercles concentriques -, se sont achevés dans l'horreur et la désillusion qu'il s'agira d'oublier par un impossible déni qui ruinera la poursuite de sa vie. Ces « happy days » sont les moments passés par le narrateur alors enfant avec son père, revenu de guerre traumatisé et s'étant enfermé dans la resserre de leur maison, où il se livra à de répugnantes obsessions alimentaires qui le feront grossir et déclencheront son cancer. Suite à une dispute avec sa mère, l'enfant va vivre avec le monstre énorme et lent, cette masse aveugle chaussée d'éternelles lunettes de plongées fumées, jusqu'au jour où les renégats viennent chercher ce père monstrueux, viennent chercher l'AUTRE (puisque c'est ainsi que le dé-nomme la mère pour l'effacer, puis l'enfant parce qu'il ne peut échapper à la vision de la mère haïe) pour tuer l'Empereur et le transformer en martyr afin de lui rendre sa divinité piétinée par la défaite et l'Amérique, pour lui rendre ce pouvoir volontairement abdiqué. Pour bombarder le palais impérial, il leur faut acheter des avions au marché noir, et voilà l'homme qui demande à son épouse les titres de banques mis à l'abri par le père de celle-ci. C'est le moment terminal du voyage vers la banque, bercé par un Bach que massacrent les officiers, jusqu'à ce moment où, sortant l'argent à la main, IL se fasse tuer ; sans que l'on sache précisément par qui; peut-être les officiers qui ne cherchaient qu'à le berner et non tuer l'Empereur.
« Quand il avait commencé à s'apercevoir que le cancer allait se développant dans la cavité de son corps avec l'exubérance du malt en fermentation, il avait pris conscience qu'il se libérait peu à peu de toutes ses entraves, par le seul jeu de la nature et de son pouvoir. Et pour cela il n'avait nul besoin de se forcer à accumuler refus sur refus ; il lui suffisait de rester tranquillement allongé : même pendant son sommeil, le cancer qui l'habitait et lui ouvrait la voie de la liberté poursuivait imperturbablement sa croissance. Souvent, lorsque sa tête était brûlante de fièvre, non seulement ce qui, dans la réalité, entrait dans le champ de son regard, mais aussi les formes crées par son imagination, lui apparaissaient comme voilées de brume, dans un espace au sein duquel son cancer prenait l'aspect d'un massif d'hyacinthes ou de chrysanthèmes jaunes dont une faible lueur violette baignait les corolles épanouies. Dans ces moment-là et jusqu'à ce que la fatigue atteignît le centre de son cerveau, il respirait avec une concentration particulière et, rassemblant dans ses narines toutes ses puissances de sensations, il s'efforçait de percevoir l'odeur d'hyacinthe ou de chrysanthème de son cancer. Cette chose qui toute seule, par ses propres moyens, croissait en lui, cette existence qui, sans autre ressort que la force logée en elle-même, allait le conduire au-delà des limites connues, en un lieu dont son esprit était incapable de se faire une image un peu précise – existence, qui plus est, dont il était en mesure de vérifier la présence dans sa chair et dans son sang , sous la forme de très authentiques sensations –, tout cela constituait à ses yeux l'expérience par excellence qu'il eût vécue depuis l'éveil de sa sexualité. Pareille analogie l'amenait à rêver d'une nouvelle flambée de sa sensualité, qui couvait encore sous la cendre. Et du fait que sa mort était là toute proche, sous ses yeux, le désir lui venait de ramener à la surface, de reconsidérer et de rendre à la liberté chacune des choses que, pendant les trente-cinq années de sa vie, il avait contraintes à l'état de tabous. »
Le jour où Il daignera essuyer Lui-même mes Larmes, nouvelle du recueil Dites-nous comment survivre à notre folie, Ed. Gallimard, trad. Marc Mécréant.
Délire d'un faux malade évoquant l'Andrés Schaltzmann des Racines du Mal, narrant son passé de violences et d'humiliations, le souvenir des jours passés dans une resserre sordide aux côtés de la pachydermique masse paternelle, polémiquant avec son scribe, revenant sur les faits pour les corriger, pour en évoquer la part d'imaginaire qui sert à donner plus de chair, plus de sang, plus de vie aux événements afin de les ancrer dans le présent, Le Jour où IL daignera est un texte complexe, d'une densité et d'une puissance rare.
Pour donner une idée du Jour où IL daignera essuyer Lui-même mes larmes, il faudrait bien sûr pouvoir dénouer les fils d'une narration complexe, feuilletée, polyphonique, déterminer les strates mémorielles et narratives, distinguer le réel de l'imaginaire pour quantifier l'incidence de l'un sur l'autre. Mais ce travail accompli, resterait à découvrir comment cette œuvre s'inscrit dans la littérature nippone tout en lui échappant, intégrant à son classicisme le modèle occidental, au travers des influences plus qu'évidentes de Faulkner, de Bataille et de Sartre, de la musique de Bach – ces trois derniers explicitement cités, la musique de l'Allemand accompagnant l'ultime et grotesque parade de l'AUTRE ; Bach accompagnant cette ultime bravade du père, obèse et cancéreux, pissant, littéralement, des flots de sang en raison de son foie malade, flots qu'éponge l'enfant au fond de leur pitoyable charrette aux roues taillées dans des billes de bois. Le père, l'AUTRE, figure bataillienne évoquant les sordides descriptions postfaçant l'Histoire de l'Œil.
Faulkner évidemment, par la complexité du récit qui cherche à dire un passé qui n'est pas passé, qui vit au dedans du narrateur, qui est sujet à disputes, contradictions, interprétations, relectures, mais demeure au fond mystère, mystère de l'existence qui s'épanouit en nous qui ne la comprenons pas, ne nous comprenons pas, ne comprenons pas nos vies. Faulkner, par le style, la phrase fleuve qui cherche à tout dire, l'événement, sa cause et son sens, sa portée, qui revient sur soi pour se corriger, pour récrire et ratiociner les faits selon une démarche truquée – celle de la mémoire. Faulkner, encore, par par ce dispositif de narration qui propose une voix, un narrateur dont le scribe doit rapporter non les dires, mais le récit – écrivant « il » pour dire les faits et non « je » pour citer (à moins que le narrateur ne dicte en disant directement IL pour JE) ; hormis lors de ces doubles parenthèses qui montrent la confrontation du narrateur qui dit enfin JE et de l'infirmière, qu'il appelle « exécutrice testamentaire » et qui est peut-être bien sa femme qu'il ne reconnaît plus, ne veux pas reconnaître, dans sa folie de se vouloir cancéreux et mourant pour attirer à lui cette mère qu'il aime et déteste, cette mère dont il souhaite l'amour et dont il souhaite triompher. Faulkner enfin par la recréation du récit, le pouvoir de la parole qui crée d'autres vies dans une vie, d'autres êtres dans les êtres, embrasse un pays dans un homme, fait du fait un signe annonciateur d'autres faits, qui structure les événements, les êtres, le monde, dans un tout de relations réciproques où l'Empereur, la viande trop rare, la Chine ennemie, le sang paternel, le cancer lui-même, la vie et la mort deviennent symboles les uns des autres, liés les uns aux autres, fondus dans ce tout qu'est UNE VIE.
Pareil aux romans faulkneriens, le récit d'abord chaotique passant du Je au Il, d'un narrateur à l'autre, plaçant en son cœur un « AUTRE » énigmatique, commençant par décrire la tonalité d'une existence, par ces sentiments qu'on explique d'ordinaire après les faits, comme un enchevêtrement de voix, de niveaux, de réminiscences et de projets, avant que l'histoire n'émerge, que des fragments de plus en plus longs et de plus en plus précis ne soient écrits et ne se connectent pour faire le texte. Ce fou, faux cancéreux, œdipien écrasé par le souvenir de son père et de la haine dont son père puis lui-même furent l'objet, suicidaire accroché à la vie.
Terrible récit de tourments et de violences, qui dit sans les dire, en utilisant IL pour Je, les traumas d'une vie brisée par fragments successifs, énigmatiques et flous, qui laissent deviner un centre absent rayonnant d'une lumière noire sur ce système chaotique que le narrateur ne peut fixer qu'à l'aide de ces lunettes jadis fumées par l'AUTRE pour regarder une éclipse. La déchéance du pays, ses méfaits en Chine, la honte et la guerre entrées dans les vies des personnages et (dés)incarnées par elles. Ôé sait faire entrer la Grande histoire et ses blessures dans la chair des personnages, par ces moments terribles où est gâché la rare nourriture disponible dans une recette ignoble qui imite le misérable régime des travailleurs coréens, cet anti-japonisme d'un repas ignoble, d'une queue de vache encore merdeuse, sanglante et au goût immonde, cuisinée avec des « herbes qui puent ».
Mais au fond, tout se résume à tourner, sans jamais oser le regarder en face, autour de l'événement qui brisa son histoire en deux. Car, passé l'Incident crucial qui termine les « happy days » tout autant qu'il les résume, l'enfant ne vivra plus que dans l'ombre de cet événement, dans la poursuite de ce père inconnu et désormais décédé, haï par la mère et qu'il s'acharne à aimer, à défendre, à honorer, contre toute logique et au péril de son âme. C'est une vie faussée, exsangue, moribonde, dont le seul moteur est le désespoir de l'après-guerre, cette maladie que l'AUTRE avait ramené et incubée dès avant la fin de la guerre, pareil à un prophète trop faible pour son savoir, incapable de se hisser à hauteur de sa clairvoyance. Dès lors, ce sera la tentation de la mort, plus que du suicide dont il est incapable tout autant qu'il est incapable de vivre; ce sera le masochisme de l'humiliation perpétuelle, devant sa mère et les autres, devant les petits voyous qu'il effrayera en se tailladant la main, pareil au Tyler Durden de Fight Club dont il partage la violence désespérée – mais non la folie destructrice, se contentant de se ronger soi-même, de souffrir à l'intérieur de sa chair rêvée malade, de cette enveloppe qu'il voudrait cancéreuse, dans les ténèbres de son regard oblitéré, jusqu'au moment où, glissant enfin dans la folie ou ayant achevé la reconstruction imaginaire de ses happy days, il se retrouve, enfant, vierge et innocent, au cœur du drame, dans l'œil du cyclone et jouisse de ce retour définitif dans le monde d'avant : « sous peu, inéluctablement, le cancer finira de ronger la vaine enveloppe extérieur de ses corps et âme, qui dissimulait depuis le 16 août 1945 sa vraie substance », et le voilà à nouveau sous le soleil de ce jour fatal, à chanter d'une voix de fausset la musique de Bach héritée de l'AUTRE.
