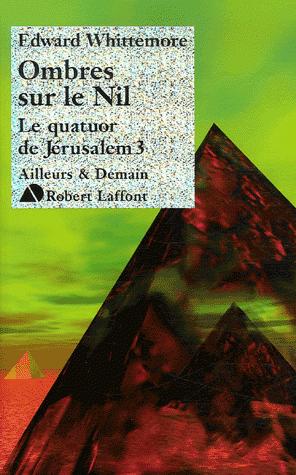Photographies © Simon Chauvin
Photographies © Simon Chauvin
But in Kilkenny, it is reported
On marble stones there as black as ink
With gold and silver I would support her
But I'll sing no more 'till I get a drink.
Carrigfergus, chanson traditionnelle irlandaise.
Vers le sommaire
1. « Le plus grand représentant du petit peuple »
S’il était possible qu’un personnage incarne à lui seul, dans Le Quatuor de Jérusalem d’Edward Whittemore, l'homme dans son acception moderne, c’est sans doute à un « petit homme noiraud » d’origine irlandaise, dernier né des trente-trois fils d’O’Sullivan Beare, que ce rôle serait dévolu. C’est bien lui en effet que l’on découvre aux côtés de Stern, le fils de Plantagenêt Strongbow, dans Le Codex du Sinaï ; lui également qui met en jeu la Jérusalem chrétienne dans l’interminable partie de Jérusalem au poker ; et c’est encore le même homme qui tente d’empêcher la mort programmée de Stern dans Ombres sur le Nil, laissant du même coup son ombre se porter avec celle de la rédemption avortée sur Les Murailles de Jéricho.
Joe O’Sullivan Beare est avant tout l’une des figures les plus polymorphes du Quatuor, ce qui n’est pas peu dire. Les ogres savants du siècle précédent, Strongbow et Wallenstein, portaient la marque de la démesure de leur temps, chacun à sa manière ; les hommes du vingtième siècle, O’Sullivan Beare en tête, croulent médiocrement sous le poids d’un monde que leurs prédécesseurs arpentèrent. Les grandioses projets politiques de Stern et les athanors délirants du jeune Nubar Wallenstein, épigone tardif de Paracelse sous overdose de mercure, n’y feront rien : le monde, à l’été 1922, s’est subitement changé en plomb sous l’effet d’une alchimie perverse.
Le personnage d’O’Sullivan Beare ne déroge pas à l’étrange système de références historiques développé par Edward Whittemore. Dónall Cam Ó Súilleabháin Béirre, ou Donal O’Sullivan Beare, plus connu sous le nom de Donal Cam, gouvernait les terres du comté de Cork, en Irlande, à la fin du XVIe siècle. Après la défaite concédée à Kinsale face à l’envahisseur anglais, en 1602, Donal O’Sullivan Beare dut quitter ses terres, suivi par mille de ses sujets, pour traverser l’Irlande en direction du Nord. C’est une troupe décimée, réduite à trente-cinq individus, qui parvint finalement à s’embarquer pour l’Espagne, où la descendance de Donal s’illustra notamment par le biais d’un Philip O’Sullivan Beare, auteur de divers ouvrages historiques et patriotiques. De l’authentique O’Sullivan Beare, on ne retrouve guère dans le Quatuor que la marche épique à travers l’Irlande. Le nom même de l’illustre famille est plaisamment détourné du folklore local* vers le domaine fantaisiste de la fable, où les noms peuvent coïncider phoniquement ou sémantiquement avec un caractère fondamental commun à toute la lignée, comme dans le Roman de Renart où le corbeau Rohart côtoie Tardif le limaçon.
"A l’issue de cette marche héroïque, les membres de son clan acquirent une certaine célébrité dans le sud-oust de l’Irlande, recevant le nom de O’Sullivan Foxes quand ils étaient sobres et rusés et celui de O’Sullivan Beares quand ils étaient ivres et balourds."
Edward Whittemore, Le Codex du Sinaï, éd. Robert Laffont, p.125
L’individu qui nous occupe est né en 1900 sur l’une des îles rocheuses d’Aran et, à l’instar de ses ancêtres, porte plus fréquemment le nom de Beare que celui de Fox, quoi qu’il eût dérogé à la règle en persistant dans sa lutte clandestine contre l’envahisseur anglais dans les campagnes irlandaises, en 1914. Grâce à un sens inné de la balistique, le jeune Joe parvient à décimer de loin les bataillons ennemis à l’aide d’un antique mousqueton de l’U.S. Cavalry qu’il utilise comme un obusier, décrivant des arcs-en-ciel d’une telle précision meurtrière que les Black and Tans finissent par frémir devant l’invisible menace. Des légendes chuchotées parmi les soldats parlent du « plus grand représentant du petit peuple », « ces fées malicieuses que l’on ne voyait que rarement mais dont l’influence était palpable, ces minuscules créatures en tunique verte, chapeau rouge et brodequins, qui passaient les ères à festoyer, à chanter et à jouer au hurley sur la lande. »** Ils ne croient pas si bien dire.
Au bout de quelques mois, Joe doit abandonner le combat : traqué par les Black and Tans, démasqué par des études balistiques, il enterre son fusil et quitte clandestinement le pays, dissimulé parmi une improbable cohorte de religieuses envoyées à Jérusalem par un ordre papal vieux de deux siècles. C’est donc sous l’aspect d’une clarisse à moustache que Joe découvre les ruelles de la Vieille Ville, et qu’il est finalement recueilli par un providentiel boulanger d’origine irlandaise, héros de la guerre de Crimée, qui lui prête son identité. Il va sans dire qu’un jeune nationaliste Irlandais d’à peine vingt ans, nonne défroquée doublée d’un vétéran de guerre britannique portant la Victoria’s Cross, se fond admirablement dans la population de l’antique cité ; et lorsqu’un tel homme rencontre un vieillard du nom de hadj Harun, qui prétend être âgé de trois mille ans et date son casque rouillé de la première Croisade, il n’a aucune raison de ne pas le croire.
Les divagations de hadj Harun, qui pourrait bien avoir été en d’autres temps Aaron, frère de Moïse, ou Harun al-Rachid, ou encore Melchisédech, le grand prêtre de Salem qui bénit Abraham, font entrer l’Irlandais catholique dans le secret des catacombes de la Ville Sainte, toujours rebâtie sur ses propres ruines. Ce voyage initiatique fait passer Joe du statut de trafiquant d’armes pour le compte de la Haganah à celui de roi occulte de Jérusalem, qu’il est le seul à connaître de fond en comble.
A Jérusalem comme en Irlande, Joe O’Sullivan Beare demeure « le plus grand représentant du petit peuple », ce héros paradoxalement anonyme, ce roi indigent dont les actes absurdes n’ont jamais de conséquence patente sur le monde visible, mais l’influencent subtilement, et qui chante des chansons à boire et joue au hurley sur la lande, ou au poker dans la Ville Sainte. C’est cette reconnaissance du secret comme principe directeur de la marche du monde qu’il transmet à son fils Bernini, à la fin de Jérusalem au poker :
« Je croyais que les pays étaient dirigés par des rois, des parlements et des présidents.
– C’est l’impression que ça donne vu de loin, mais c’est uniquement pour préserver les apparences, c’est purement superficiel. En vérité, c’est le petit peuple qui fait tourner la boutique, depuis toujours et pour toujours. Mais on ne les voit jamais, on ne fait que sentir leur présence. Promène-toi dans les bois et tu les entendras chuchoter, danser et jouer à leurs petits jeux, mais ne t’approche pas trop, car cela ne leur plairait pas. »
Edward Whittemore, Jérusalem au poker, p.445
Les tribulations de Joe O’Sullivan Beare prennent ainsi la forme d’une énième variation sur le thème du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ; mais cette fois, les jeux d’Oberon et Titania prennent une dimension politique. Qui mieux qu’un Irlandais, familier des banshees, pookas et autres leprechauns, aurait pu prendre en charge cette nouvelle facette de la complexe Weltanschauung mise en scène dans le Quatuor, qui le rapproche notamment des adeptes du registre fantastique ? Car dans la perspective de Joe, les occupations des hommes ne constituent qu’une écume dérisoire à la merci d’une force plus profonde, hostile chez Lovecraft, bienveillante dans le discours prodigué par Joe à Bernini, mais toujours cachée, inaccessible aux adeptes de la vraisemblance.
Cette réalité seconde, coutumière à ceux qui comme hadj Harun « voient plus loin que le point du jour », affleure derrière les anciens remparts de Jérusalem, sous son sol inégal où dorment deux douzaines de Vieilles Villes superposées : une réalité où les temps se chevauchent, clairement identifiables comme les strates d’une coupe géologique, chacune portant les traces d’existences révolues, et qui incite Joe à concevoir l’histoire humaine comme un éternel recommencement, un cycle ponctué à intervalles irréguliers par une nouvelle destruction de la Ville Sainte de tous, et sa reconstruction au mépris des fondations anciennes. Grâce à hadj Harun, Joe accède à la vision grandiose de cette interminable Sinaï Tapestry, et ressort transfiguré des caves de Jérusalem, demandant à qui voudra bien lui répondre : « Dans quel siècle sommes-nous ? » ***

2. L’homme de Smyrne
En dépit de ce rocambolesque tourbillon narratif, dont notre courageux lecteur est désormais coutumier, et de cette grandeur secrète, Joe demeure le personnage le plus tristement humain du Quatuor. Les inestimables richesses des caves de Jérusalem lui sont finalement indifférentes, à l’exception notable de la réserve d’insipide cognac marqué du sceau des Templiers, qu’il écluse à longueur de temps afin d’éveiller le simulacre d’une ivresse révolue, d’oublier la femme qui l’a délaissé et le fils qu’elle lui a confisqué. Après avoir cédé Jérusalem au peuple juif en la personne de Munk Szondi, il émigre à nouveau pour l’Amérique du Nord, avec pour principal bagage le véritable Codex du Sinaï qu’il ne peut lire, mais feuillette malgré tout, conscient de son insignifiance, parmi les Indiens Hopis. Il n’y disparaîtra définitivement qu’après avoir échoué à protéger l’ultime espoir de paix incarné par Stern.
« Le plus grand représentant du petit peuple », qui détient les clés des sous-sols de la Ville Sainte, et du même coup de la plupart des mystères engendrés par les hommes, est en même temps l’archétype de l’homme du vingtième siècle. L’individu ne dispose plus du monde, il n’a plus la moindre possibilité d’influer sur le cours d’une histoire qui lui échappe ; il ne lui reste plus qu’à faire face à la désillusion, au désenchantement du monde. Il ne peut plus opposer à la souffrance que le réconfort paradoxal de la mort, condamné à faire l’aveu de son impuissance et de l’inaltérable cruauté du monde.
C’est à travers le regard trouble de Joe, qui aimerait se croire de retour au combat contre les Black and Tans, que le lecteur assiste au massacre de la population arménienne de Smyrne par les Turcs. Arpentant misérablement les rues en compagnie de Stern, pour qui il convoie des armes, et de leur ami Sivi, il découvre sur le pavé une fillette mutilée. Dans un passage qui demeure parmi les plus marquants dans l’ensemble de l’œuvre, Stern n’a d’autre choix que d’achever l’enfant.
« Des flammes dans le ciel, quelqu’un qui sort d’un immeuble en trébuchant, en feu. Ni un homme ni une femme, rien qu’un mannequin de braises qui a parcouru des centaines de kilomètres pour parvenir ici, qui a marché durant des années pour parvenir ici, imaginez un peu, mais en fait on ne voit pas aussi loin, non, on n’y voit pas à plus de dix mètres avec cette fumée, mais on n’a pas besoin d’y voir très loin, l’univers ne fait pas plus de dix mètres de large, et après cela il n’y a plus rien à voir.
Stern ramassa le poignard, Joe le vit faire. Il le vit empoigner la fillette par les cheveux et lui relever la tête. Il vit son cou blanc et gracile.
Le poignard ensanglanté tomba en cliquetant sur le pavé et, cette fois-ci, il ne releva pas la tête. Cette fois-ci, il ne tenait pas à voir les yeux de Stern. »
Le Codex du Sinaï, op. cit., p. 286
La vision fantastique des innombrables Vieilles Villes et des siècles d’histoire que Jérusalem recouvre cède la place à un espace et à un temps minimaux. Le désenchantement du monde passe, pour Joe O’Sullivan Beare, par cet instant où l’univers se réduit jusqu’à ne plus contenir qu’une ruelle de Smyrne – pas si loin de l’antique port d’Aulis – un soir de 1922. Il passe par le sacrifice d’une nouvelle Iphigénie, tout aussi innocente que la première, mais dont nulle divinité jalouse n’aura réclamé l’injuste sacrifice ; la douleur seule, engendrée par une cruauté aveugle, exige ici de mettre fin à l’agonie à laquelle se résume désormais l’existence de la victime. Face à l’omniprésence de la souffrance et du crime déjà accompli, le seul acte de générosité possible réside dans le don de la mort, ou dans la ferveur passive d’une prière pour un au-delà plus clément. Impossible, dans ces conditions, de voir plus loin que le point du jour ; nulle rédemption ne saurait atteindre le monde tel que Joe le contemple à cet instant. C’est ce sacrifice absurde et nécessaire qui marque, dans le Quatuor de Jérusalem, le véritable commencement du vingtième siècle. Désormais, les dizaines de milliers morts arméniens et grecs de Smyrne, au même titre que les millions de victimes des guerres mondiales, se réduisent pour la postérité à l’innocuité du chiffre.
L’écriture vivace de Whittemore traduit plus que jamais, dans ce chapitre d’une intense cruauté, une volonté de parer à l’oubli des morts de Smyrne, à la relégation de la souffrance des innocents dans la froide neutralité des statistiques, et de lui restituer au moyen de la fiction son intensité originelle. L’histoire et la fiction ne peuvent que coïncider dans l’espace de cette ruelle sanglante : voilà qui semble donner tout son sens à l’étrange cohabitation de l’histoire avec la fiction dans l’œuvre de Whittemore. Il fallait un point de départ tangible, à l’uchronie hybride que constitue le Quatuor ; cet épicentre, ce point de déclenchement où le trop-plein du texte rejaillit sur l’ensemble, c’est le massacre de Smyrne.
O’Sullivan Beare et Stern se rejoignent désormais dans l’unique figure impuissante et désabusée de l’homme de Smyrne : il faudra au premier un flot quotidien d’alcool, au second des injections fréquentes de morphine, pour vivre avec cette vision. Après la désillusion subie en Irlande lorsqu’il fallut rendre les armes, s’ajoute pour Joe le constat sans retour de l’impossibilité d’œuvrer pour une quelconque cause en ce monde. Qui sait si les armes convoyées pour le compte de Stern n’ont pas joué leur rôle dans l’hécatombe ? Mais Stern, qui eut la force d’abaisser ce poignard macabre et salvateur continuera jusqu’à sa mort, en dépit de l’indéfectible cruauté du réel et de sa propre culpabilité, d’incarner l’espoir improbable d’une rédemption par l’histoire.