L'été sera narcissique ou ne sera pas. Pendant mes vacances, je m'amuse à publier à nouveau quelques billets dont le souvenir s'est imposé un peu par hasard. Loin d'un best of, je vous livre ces billets en espérant qu'ils vous feront passer un moment agréable.
Sortant à peine de la salle ce 23 décembre 2008 (L'Arlequin, rue de Rennes) et totalement bouleversé, sidéré par ce spectacle cinématographique total, une espèce d'utopie filmée qui ne se reproduira pas, j'ai voulu m'interroger sur mon désir de cinéma avant de parler du film (et qu'en dire, sinon que c'est un absolu chef d'oeuvre ?) et de reproduire deux articles de presse.
Pourquoi retourner au cinéma ?
Pourquoi cette attirance renouvelée pour ce rectangle d'ombres et de lumière où se répète en boucle une histoire déjà morte, alors qu'au-dehors la vie prononce notre nom en murmurant "encore"...
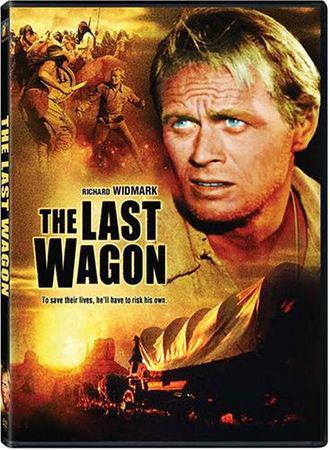

Alors, pourquoi retourner au cinéma ? La timidité du sourire de Chaplin vers la fin de City lights : il a tout risqué pour que la jeune fleuriste recouvre la vue et risqué surtout que son premier regard à elle, si belle et souriante, sur lui qui vient de recevoir une volée de pierres de gamins ignorants de leur propre cruauté, lui le petit homme qui n'avait rien à lui, rien pour lui, que cette capacité à donner et à risquer ; que ce regard le réduise en statue de sel.

Démons et merveilles, je chasse les démons et je retourne au cinéma pour une fois encore m'émerveiller.
Roland Barthes différenciait la littérature de plaisir et la littérature de jouissance. Il en est de même du cinéma. Ainsi ce film cinquantenaire qui sort dans deux salles à Paris intramuros, 8 salles France entière, après un lifting qui n'est pas de circonstance, mais d'essence. Lola Montès de Max Ophuls avec la Martine Carol dans le rôle titre est un film de jouissance, une jouissance faite film.
Quelle merveille et on se dit : quelle merveilleuse invention, le cinéma !
J'ai lu une critique réservée de ce film. Et ça donnait : "Sur tous ces points, on peut me reprocher une certaine étroitesse d’esprit surtout si l’on compare ces critiques limitées au plaisir illimité que nous avons tous pris à revoir ce dernier film d'un grand metteur en scène."
Car on ne survit pas vraiment au voyage dans les hauteurs d'autant plus vertigineuses de ce film extravagant que le sujet en est assez bas. Une pute, qui se vend par goût du pouvoir, qui risque tout et perd tout et vient le raconter dans un cirque américain.
Histoire vraie, à croire que le cinéma a inventé des destins pour le plaisir de les filmer en 35 mm.
Lolo Montès est un film, comme on disait avant, comme l'aurait dit Truffaut, en "scope couleur", ce qui veut dire. Ce qui veut dire écran très large et couleurs profondes. Comparez la profondeur d'un rouge à celle d'un vert. Lola porte les deux et nous entraîne vers les grands espaces de la sensualité, de la peur, de la volupté et du dégout.
Lola est Martine Carol et (inversement, bien sûr). Martine Carol était non seulement, à l'époque, l'actrice française la plus adulée, la plus sexy, mais peut-être la plus douloureuse. Lorsque Max Ophuls rennonce à Danielle Darrieux (la sublime) avec qui il vient de tourner Madame de..., sait-il qu'il confie un des rôles les plus difficiles à une femme (actrice) des plus fragiles. Elle mourra quelques années après de cette fragilité, mais elle sort, lors du tournage (difficile) de quelques tentatives de suicide, plus ou moins assumées. Cette histoire d'une femme qui raconte sa vie avec froideur, comme quelque chose de passé, de déjà mort dans l'invraisemblable pornographie d'un cirque (ses récits scandés par le fouet de l'incroyable Peter Ustinov, acteur que je détestais étant jeune, ce qui prouve que la jeunesse n'est pas toujours l'intelligence, ni la grâce) cette histoire ne peut-elle être celle de la belle Martine ? Le cinéma étant miroir grossissant des troubles affectant les stars, Lola ne rappelle-t'elle pas la BB de Vie privée de Louis Malle ou la plus décente Gloria Swanson de Billy Wilder dans Sunset Boulevard ?
Je ne sais pas. Ce qui me reste de Lola Montès, c'est l'idée absurde que, comme la plupart des gens, j'aurais pu le manquer. C'est l'idée d'un film aux multiples dimensions, à voir en large, en hauteur et en profondeur. Pour son premier film en couleurs (eastmancolor), Ophuls n'a pas dépensé l'argent du producteur pour rien (ou pour les 20.000.000 de $ que coute Mlle Kidman à chacun de ses films nauséeux) : le film se voit en très large et, comme disait Truffaut, on ne peut tout voir en une fois, tellement l'image est riche. Le scope n'empêche pas l'image de se déployer dans une hauteur vertigineuse dont, peut-être, le grand Myasaki a pu s'inspirer. Je pense au Voyage de Shihiro et ses constructions surréalistes et industrieuses, sinon industrielles.
Que dire d'autre, sinon que Lola Montès est un film d'une beauté inattendue, d'une richesse formelle peu égalée, d'une profondeur rare dans la disséquation de l'esprit humain, du désir, de la souffrance, de la déchéance.
Contrairement au film sur l'Australie, Lola Montès est sorti dans deux salles, Paris intra muros et 6 autres salles en France. C'est un film ambitieux et peut-être légérement difficile d'accès. Il faut supporter les premières trois minutes pour jouir, d'une infinie jouissance, des 90 mn qui suivent.
Courage, le cinéma de qualité ne mord pas, ne blesse pas, le seul risque majeur est celui d'un orgasme mental gigantesque qui donnerait envie d'autres films. Courage, donc.
Quelques affiches du film

L'affiche 2008, bleue, glacée


Approfondir sur le net
- La page très intéressante de la Cinémathèque, consacrée au film et à sa "résurrection" : Cliquer.
- De la Cinémathèque, encore, feuilleter les premières pages du scénario original du film : Cliquer.
- A voir aussi, le site du Ciné-club de Caen : Cliquer.
Quelques images du film







Quelques propos de presse sur le film

Gérard Lefort dans Libé
Lola Montès de Max Ophuls
avec Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook, Oskar Werner… 1 h 55.
Lola Montès est un mystère au sens du Moyen-Âge. Qui se joue sur les parvis laïques et pas dans les églises. Un propos de bateleur qui renoue avec la vocation originelle du cinéma. Des façons de montreur d’ombres, un art forain dont Max Ophuls est le saltimbanque magnifique.

Grand Guignol. Voilà par exemple un film en Cinémascope et Technicolor qui développe une véritable phobie de l’espace et de la polychromie. Sans cesse des panneaux coulissants rétrécissent le cadre et la couleur est interrompue par des filtres qui imposent une série de dominantes : rouge, doré, bleu… Truffaut l’avait vu parce que cela crève les yeux : l’histoire «vraie» de Lola Montès, aventurière qui finira sa vie en racontant son destin «fabuleux» dans un cirque américain, est constamment empêchée. Par des tulles, des voiles, des mousselines, des dentelles, des paravents, des grilles et même, plan suprême dans la roulotte-mobil home de Lola, par le tuyau d’un poêle qui tranche l’image en deux. C’est une scène sidérante où pendant le long dialogue entre Lola et un de ses amants, le visage de l’actrice (Martine Carol) est littéralement barré. De même pour les dialogues parasités par d’autres paroles, d’autres sons et bruits, au point qu’ils sont parfois inaudibles. Ophuls, à cet égard, faisait phosphorer la stéréophonie alors naissante, lui donnant un quasi-relief en 3D. A l’horizon de son projet, Lola Montès pourrait être un film tourné derrière un mur, un film qui se contenterait de deviner l’action et de tendre l’oreille à sa rumeur. Comme Bresson qui voulait filmer le déluge biblique du point de vue des empreintes laissées dans la boue par les animaux de l’Arche.
Cette déconfiture de l’espace et cette cacophonie des sons ont bien des effets. Cathartiques d’abord, puisque le film à très grand spectacle prend ses spectateurs au piège de leur distraction et des plaisirs qu’ils en tirent. La vie racontée de Lola est un Grand Guignol, reality show avant l’heure où il s’agit de «vendre l’homme devant l’homme». La contestation de la «société du spectacle» est à l’œuvre, déconstruction des procédés de la représentation par l’exhibition de ses coulisses. Lola est comme la Mariée de Duchamp, mise à nue par ses prétendants, même (un mari, des amants).
Spirou inquiétants. Du coup, sur ces ruines du théâtre classique, une sorte de démocratie moderne fait florès où les places, celle du spectateur comme celle du réalisateur, sont mouvantes. Plusieurs vies sont possibles pendant le film. Celle de Lola en personne, moins bombe sexuelle qu’attentat permanent à la pudeur (bourgeoise). Profession ? Scandaleuse, comme d’autres sont roi (de Bavière) ou va-nu-pieds étudiant. On peut aussi, comme au défilé des chars à carnaval, déplacer le curseur du punctum vers certains détails excitants : les apartés chuchotés du sensationnel Peter Ustinov, monsieur Loyal à plus d’un titre («Va me chercher un whisky» «Ça va ? Tu tiens le coup ?»), qui sont, comme notre point de vue diffracté sur le film, sa critique en direct, notre quant-à-soi, c’est-à-dire nos doutes, nos peurs de solitude, nos bonheurs d’être ensemble. Mais aussi bien les inquiétudes populaires de la camériste de Lola (Paulette Dubost et ses «oh la la», citation vivante de la Lisette de la Règle du jeu de Renoir) ou les grooms du cirque, Spirou inquiétants, masqués de rouge comme dans une nouvelle d’Edgar Poe. Et Lola évidemment, son visage de glace, le visage de Martienne de Martine Carol, ses traits qu’Ophuls n’a pas statufiés par sadisme ou haine du star-system, mais pour qu’on puisse au contraire s’y accrocher, entre Marlène et Anouk Aimée qui, des années avant, des années après, furent elles aussi Lola : George Sand au cigare, putain du roi, fille légère comme la liberté, madone des sleepings et madone tout court, aussi enchâssée dans ses atours et ses parures qu’une sainte de cathédrale, sauf qu’au moment de sauter dans le vide pour son martyre qui est le vertige primordial du film («Plus haut Lola ! Plus haut !»), ce sont de vraies larmes qui coulent sur ses vraies joues.
Comme le suggèrent les tableaux naïfs du rideau tiré sur la scène finale, Lola Montès est un mystère au sens du Moyen-Âge. Qui se joue sur les parvis laïques et pas dans les églises. Un propos de bateleur qui renoue avec la vocation originelle du cinéma. Des façons de montreur d’ombres, un art forain dont Max Ophuls est le saltimbanque magnifique.
Le point de vue du Monde

"Lola Montès" : un chef-d'oeuvre effrayant.
Le film que vous allez voir, mesdames, messieurs, est une espèce de fantôme. En décembre 1955, Max Ophuls présentait au public parisien Lola Montès, grand film en Eastmancolor et CinémaScope qui n'eut pas l'heur de plaire. Retiré de l'affiche, Lola Montès a été montré ensuite monté et doublé (le film est en français, anglais et allemand) de différentes façons (Le Monde du 15 mai).
Les efforts de la Cinémathèque française ont permis de redonner vie à un film très proche de la version que voulut Ophuls.

Bien sûr, les spectateurs de 2008 seront moins déroutés par la chronologie désarticulée du récit, par la violence chromatique des images. Mais ce qui fit fuir les spectateurs du Marignan, il y a plus d'un demi-siècle, effraie encore aujourd'hui. La déchéance livrée en pâture de la célèbre courtisane du XIXe siècle, le trafic marchand des sentiments et du plaisir restent des objets de scandale qu'Ophuls met en scène avec violence, dans une fièvre qui confine parfois au délire, sans prétendre à la compassion. C'est le plus malheureux et le moins aimable des chefs-d'oeuvre.
Après un long prologue, lorsqu'on découvre enfin Martine Carol, star de l'époque, interprète de Lola Montès, les premiers mots qu'elle prononce sont : "Ça va aller." Parfaite antiphrase. Dans ces premières séquences, on a vu Lola en bête de cirque, offerte à la concupiscence et au mépris du public par un Monsieur Loyal monstrueux (Peter Ustinov). L'ex-courtisane qui fit tourner les têtes couronnées ne survit qu'en rejouant, sur le mode de la pantomime, les épisodes les plus scandaleux de sa carrière. Comme un cauchemar, le film glisse du spectacle de cirque à la reconstitution historique au cinéma. Lola, adolescente, met le grappin sur l'amant de sa mère ; Lola séduit et abandonne Franz Liszt ; Lola s'insinue dans l'intimité du roi Louis Ier de Bavière et provoque l'édition locale de la révolution de 1848.
SAISISSANT DE DÉSESPOIR
Quand il filme le cirque, Max Ophuls fait cavaler des nains peints en rouge, galoper des écuyères légèrement vêtues dans un charivari permanent qui tourne autour d'une figure immobile, celle de Lola, qui tient à peine debout et s'exprime d'une voix inaudible.
Depuis 1955, on a dit beaucoup de mal de Martine Carol. L'actrice n'est pas une grande tragédienne, et chacun des retours en arrière montre ses limites (la séquence de l'adolescence la fait sombrer dans le ridicule - elle était âgée de 35 ans au moment du tournage). Mais il y avait assez de tristesse en elle pour qu'elle compose un masque de morte-vivante saisissant de désespoir dans ces séquences du cirque. On dirait qu'elle ne survit que grâce à l'énergie perverse que lui insuffle son infernal Monsieur Loyal, dont Peter Ustinov fait un démon.
Les limites de l'actrice n'empêchent pas le film de se déployer dans toute son ampleur. Certes, les séquences historiques respectent en partie les lois du genre en vigueur à l'époque, mais Ophuls impose à ses deux univers les mêmes déformations qui suscitent le vertige et la claustrophobie. La caméra est suprêmement mobile (exploit prodigieux étant donné la lourdeur du matériel de l'époque), mais, au lieu d'agrandir le cadre du Scope, ces mouvements le fractionnent en un labyrinthe dont aucun personnage ne peut s'échapper.
Cette sensation est accentuée par l'utilisation récurrente de grilles, de fenêtres à petits carreaux, de rambardes qui font les barreaux de la prison dans laquelle Lola Montès s'est enfermée.
Cet enfer n'est pas celui qui guette les filles perdues. C'est celui où l'amour et l'argent s'échangent indifféremment, où la célébrité est une marchandise. Ophuls avait appris à connaître Hollywood (le cirque de Lola est américain), où il s'était exilé pendant la seconde guerre mondiale, et l'on peut discerner dans Lola Montès une parabole du viol de la culture et de l'histoire européennes par le show-business américain. Ce n'est qu'un contre-chant. Lola Montès est avant tout le récit d'une agonie. C'est le dernier film de Max Ophuls, mort deux ans plus tard.
