La pensée scientifique moderne doit au philosophe autrichien Karl Popper sa règle d’or, que voici : pour qu’une théorie soit recevable, il faut la formuler de façon à ce qu’elle puisse, le cas échéant, être réfutée (« falsifiée ») par les faits observés. En économie le keynésianisme est un exemple parfait de ces théories irréfutables.
Par Fabio Rafael Fiallo.
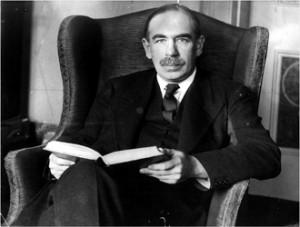
John Maynard Keynes
La pensée scientifique moderne doit au philosophe autrichien Karl Popper sa règle d’or, que voici : pour qu’une théorie soit recevable, il faut la formuler de façon à ce qu’elle puisse, le cas échéant, être réfutée (« falsifiée ») par les faits observés.
D’après cette règle d’or de Popper, si la réalité vient contredire une théorie, mais celle-ci retombe toujours sur ses pattes parce que ses défenseurs sont à même d’ajuster leur argumentation en toute circonstance sans devoir abandonner la théorie en question, alors on a affaire à une théorie infalsifiable, et donc non scientifique, qui ressemble plutôt aux vaticinations de l’astrologie.
En économie nous avons un exemple parfait de ce genre de théorie. Formulée par John Maynard Keynes à l’époque de la Grand Dépression des années 30, elle consiste à voir dans les dépenses publiques le moyen de faire sortir une économie de la récession ou de la dépression.
Or, cette foi dans les dépenses publiques comme vecteur de croissance ne se trouve pas confortée par les faits, bien au contraire.
On le voit, par exemple, avec la politique de relance du président Obama (son fameux « stimulus package ») : huit cents milliards de dollars injectés depuis 2009 dans l’économie américaine par le biais de dépenses publiques de tout ordre, et ce dans le but, déclaré par Obama lui-même, de faire descendre le chômage au-dessous de la barre de 8% et de remettre l’économie sur le chemin d’une croissance soutenue.
Or, trois années plus tard, le chômage aux Etats-Unis demeure au-dessus de la barre de 8%. Pour ce qui est de la croissance, parmi les onze reprises économiques enregistrées aux Etats-Unis au cours des 60 dernières années, celle d’Obama s’avère être la plus faible, la plus incertaine et la plus lente de toutes[1].
Quand on fait allusion à ces résultats plus que décevants, les gourous du keynésianisme n’en démordent pas pour autant. Ils prétendent alors que la situation économique aurait été pire encore s’il n’y avait pas eu de « stimulus package ».
Et quand on leur répond que le but du plan d’Obama n’était pas d’adoucir les effets de la récession mais de la surmonter, alors ils avancent un tout nouvel argument, à savoir, que pour venir à bout de la récession, huit cents milliards de dollars n’étant pas suffisants, il faudrait dépenser encore quelque centaines de milliards de plus.
Ainsi, incommodés par les faits, les avocats de la dépense joyeuse modifient opportunément leur argumentation au gré des circonstances.
Finalement, à court de réussite récente, ils sortent un vieux joker de leur poche : ils invoquent le New Deal lancé par le président Franklin Roosevelt en 1933, avec les dépenses massives qu’il aura entraînées, et censé – selon eux – avoir sorti l’Amérique de la Grand Dépression.
Sauf que, le New Deal ne fut pas le grand succès que l’on nous décrit, car il n’empêcha pas l’économie américaine de sombrer en 1937 dans une « dépression dans la dépression ».
Le Dow Jones chute de 49% entre mars 1937 et mars 1938, la production industrielle se rétrécit de 40% entre août 1937 et janvier 1938, et le chômage grimpe de 14% à 19% (alors que dans une Europe sans New Deal le chômage se situait à 12% en 1938).
Tant et si bien qu’en 1938, Roosevelt se voit obligé de rectifier le tir et réduit ou supprime certains impôts et introduit un ensemble d’incitations au secteur privé (« politique de l’offre »). La reprise durable démarre à ce moment-là et non pas – comme on nous le martèle – avec les grandes dépenses de 1933[2].
Les avocats de la dépense publique prétendent également avoir la solution aux problèmes des pays, tels ceux de l’Europe du Sud, qui sont aux prises avec une dette souveraine insoutenable. Pour nos keynésiens récalcitrants, s’il faut s’attaquer au déficit des comptes de l’Etat, eh bien, augmentons les impôts, mais ne touchons en tout cas pas aux dépenses (notamment aux effectifs de la fonction publique), et ce afin de ne pas nuire à la croissance économique.
Là encore, leur théorie se trouve contredite par les faits.
Une étude menée par les économistes Alberto Alesina et Silvia Ardagna, de l’université de Harvard, couvrant les 107 plans d’austérité mis en place dans les pays de l’OCDE au cours des 30 dernières années, montre que les plans les plus efficaces sont ceux qui ont comporté des coupes dans les dépenses publiques sans augmentations d’impôts(cf.« Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending »).
Une équipe du Fonds monétaire international arrive à une conclusion semblable : les coupes dans les dépenses publiques et les réformes structurelles (baisse des charges sociales, libéralisation du marché du travail) sont les seuls moyens de réduire durablement la dette souveraine d’un pays (cf. Chipping Away at Public Debt).
En fait, si les dépenses publiques permettaient vraiment de relancer l’économie, ou de préserver celle-ci de la récession, pourquoi, alors, le Japon, la Grèce et l’Italie, pays qui depuis longtemps en font un usage démesuré, se trouvent-ils dans le pétrin que l’on sait ?
Et c’est dans ce cul-de-sac du maintien (« stabilisation ») des dépenses publiques, avec en prime des augmentations d’impôts et de charges sociales, que le président Hollande a choisi d’évoluer !
- Harvey Golub, “How the Recovery Went Wrong”, Wall Street Journal, 22 mai 2012. ↩
- Harold L. Cole et Lee E. Ohanian, “New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression”, Journal of Political Economy, 2004; et Burton Folsom Jr. et Anita Folsom, “Did FDR End the Depression”, Wall Street Journal, 12 avril 2010. ↩

