Aboutissements de Henry Bauchau
Marc Villemain
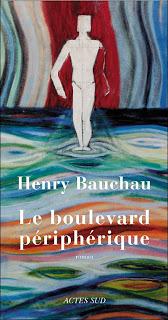
Éditions Actes Sud
On ne peut plus guère lire un livre de Henry Bauchau sans se dire que c’est peut-être son dernier ; à quatre-vingt quinze ans, l’homme se tient fragile sur une canne et n’est plus guère disponible à l’écriture qu’une ou deux heures par jour. S’il n’en savait rien, aucun lecteur pourtant ne pourrait jamais penser qu’il est aussi proche de la fin des jours. Il ne s’agit pas ici de vocabulaire, de codes, de tendance à sacrifier aux goûts et aux facilités du moment, mais d’acuité, d’existence intérieure, de perception intime du rythme, de l’harmonie, de pénétration des mots, sans parler de cette élégance, de cette réserve auxquelles les temps nous déshabituent.
Paris, 1980. Chaque jour, le narrateur prend sa voiture, le bus ou le RER pour rendre se rendre à l’hôpital et y visiter Paule, sa belle-fille, dont chacun, malgré « la mécanique de l’espérance », pressent bien que le cancer lui fait vivre ses dernières heures. Ce faisant, il se remémore la figure de Stéphane, l’ami de jeunesse, qui l’initia trente ans plus tôt à la varappe avant d’entrer dans la Résistance et d’y perdre la vie. Les deux figures se superposent dans l’esprit du narrateur jusqu’à s’entremêler et façonner son regard ; entre le réel de la souffrance d’un être aimé et le souvenir de l’ami devenu maître avant de mourir dans de terribles circonstances, le narrateur ne peut que bredouiller sa pudeur, sa banalité, l’ordinaire de sa vie. « Je m’en vais sur la pointe des pieds. C’est un peu comme ça que j’ai vécu. Ce n’est peut-être pas ainsi qu’on peut porter soi-même tout son poids », écrit-il en sortant de la chambre de Paule. Mais à ces deux figures chéries vient s’ajouter une troisième, qui ne les surplombe pas mais les travaille jusqu’à les épuiser, celle d’un russe blanc dénommé Shadow, devenu officier nazi, et qui décida, naguère, de la mort de Stéphane. La vie conduira le narrateur à visiter dans sa prison, et jusqu’à sa mort, cet homme qui ne se remettait pas des blessures d’enfance, doté d’une noblesse dont la souveraineté fut chèrement acquise, ce Shadow que l’arrachement à sa condition première de fils aura transformé en un homme à l’intelligence glaciale et aux manières brutales. Fermé à tout sentiment, donc, en tout cas jusqu’à Stéphane, dont la manière que celui-ci eût d’accepter la mort et de s’y préparer constituera pour Shadow le premier et seul véritable échec de sa très brillante et très monstrueuse carrière ; Le Silence de la Mer n’est pas loin.
D’autres diront mieux que moi la singularité de l’écriture de Henry Bauchau, dont l’assurance apaisée est d’autant plus remarquable que chaque phrase émet une onde de fragilité, quelque chose qui, malgré l’apparente évidence de la prose, nous apparaît sous une forme parfois friable, comme s’il s’agissait toujours de s’excuser d’écrire. Chez Bauchau, l’existence intérieure est le seul monde souverain, mais il est exposé, ébranlé, malmené, c’est une plénitude dont on ne peut jamais dire qu’elle est acquise. L’enfance n’est pas ici le rocher où l’homme mûr vient se ressourcer ou se comprendre, mais plutôt un petit caillou ou une bille qui traîne au fond des poches. « Ce que j’ai fait de mon enfance, je n’en sais rien, je l’ai perdue en partie, mais il en reste des traces effilochées à tous les buissons, à toutes les ronces de ma vie. » Tout tremble chez Bauchau, l’espérance comme la mélancolie, la joie passagère comme la perception de se sentir vivre. Les autres sont tout regards, et tout regard fragilise : « Implacables les autres pour vous faire constater que tout change et vous apprendre à mourir. Sans les autres, est-ce que l’on ne mourrait pas ? » Quelque chose chez Bauchau semble être resté bloqué, clos, impuissant à éclore en liberté. On dirait qu’il ne peut se sentir vivre autrement qu’en se contractant, en serrant de près chaque affect. Cette forme d’inaptitude au monde est très contrariante pour celui qui, par ailleurs, observe ce dernier avec tant de compréhension et d’envie.
Certaines scènes devront pouvoir figurer dans une anthologie de la justesse. Celles avec Stéphane bien sûr, quand tous deux gravissent les montagnes et que, dans le silence, se nouent de ces amitiés qui se passent du luxe des mots. « A partir de ce regard jeté d’en haut sur le sourire de Stéphane, le vertige, dont j’ai toujours souffert, me quitte. Je n’ai plus affaire qu’à la paroi, à la pesanteur, au travail de mes quatre pattes et je n’ai plus été paralysé par la peur. Quelque chose a eu lieu comme si Stéphane m’avait revêtu de sa force. » Stéphane est un taiseux, sans doute parce qu’il ne se sent pas autorisé à parler, lui qui n’en a pas la science (« ce garçon, peu instruit, qui avait quitté l’école à seize ans, était un maître auprès duquel j’apprenais une technique, une science de la gaieté dans l’effort et l’énergie du plaisir difficile »), mais davantage encore parce qu’il sait, d’instinct ou d’intuition, que l’humanité qui s’impose doit se dispenser de phrases. Dans l’anthologie devront aussi figurer ces innombrables scènes à l’hôpital où les regards s’échangent, où les mots se heurtent, où les familles font taire leurs histoires, où s’endossent les masques de l’à-propos. Ou encore cette scène, durant la guerre, où des femmes s’interposent entre les nazis et leurs maris, et de leur seul cri unique parviennent à éviter le pire, aux uns comme aux autres. Et ce moment où le narrateur se reconnaît dans le regard perdu d’un Arabe qui travaille sur un chantier, « cet homme malheureux, si proche de moi, le plus proche peut-être, [qui] restera pour toujours un inconnu. » Ou le souvenir de ce qui fut son premier amour d’enfant, amour évidemment non consommé, secret, fugitif, emporté par la vie : après la messe, sur le parvis, « elle me regardait un instant mais, comme on le lui avait appris, sans attention particulière et passait très vite à un autre d’entre nous. Pas une fois je n’ai pu desserrer la bouche pour lui dire un mot. Quel mot venu de quelle langue, de quel pays caché, puisque l’amour entre enfants n’était qu’un béguin qui faisait rire ? » A l’enfance ou à l’âge adulte, l’intériorité est comme condamnée à rester cadenassée, on ne peut jamais que la manifester, au mieux avec maladresse, au pire en buttant sur l’incompréhension. Il faut dire qu’elle nous est à nous-mêmes grandement obscure : « Des fragments, nous ne pouvons connaître que cela, le monde et nos rêves ne nous livrent que des fragments révélés par nos trajectoires nocturnes dont rien ne demeure en nous que des traces sombres maculées par des mains ou des griffes inconnues. » Henry Bauchau est parvenu à un tel degré d’intimité avec le verbe que son épure, sans doute nécessaire, constitue pour tout aspirant une des plus belles leçons d’écriture et de littérature. Disons-le tout net : cela faisait quelques temps déjà que nous attendions d’être secoués, bouleversés par un roman contemporain de langue française.
Article paru dans Le Magazine des Livres, n° 10, mai/juin 2008

