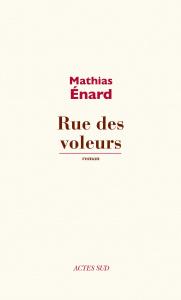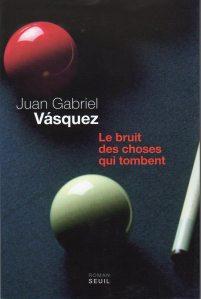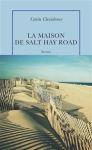De la chance, oui… dans le Petit Bois toujours vert
(copyright: le talentueux Stéphane Vermorel, agence 154)
Mes Amis, en ce début d’année, tout d’abord : tous mes vœux ! De richesse de vue et de découvertes inoubliables (notamment). J’ai raté la Noël, le Jour de l’An, mais voilà voilà, je reviens enfin, avec du lourd – et il était grand temps. C’est que… j’ai une chance folle, voyez-vous. J’ai certes négligé le Petit Bois, mais c’est parce que j’ai une chance folle. Non pas que ma vie soit exempte d’ennuis hélas… Mais, en ce début 2013, j’ai à mes yeux l’essentiel-existentiel : l’Amour, l’Amitié, l’Amitié, l’Amour. Et c’est considérable. Mais puisque je ne suis pas ici pour tenir journal, et que vous ne m’en voulez pas une seconde pour mon absence… Commençons bien l’année, avec un petit panorama des œuvres qui n’auront pas ou peu couru les pages et écrans de la culture, et que j’ai gardées sous le coude de ma disponibilité. Ce sont là des lectures qui m’ont, moi, tout à fait emballée depuis septembre. Hors prix littéraires, ou presque. Hors grands boulevards… Et hors saison donc.
- Deux jeunes déjà grands, à l’avenir grandiose
Je parlerai d’abord de ces deux auteurs de la Rentrée 2012 qui ne cessent de m’éblouir, de livre en livre. Ces deux écrivains ont ceci de commun qu’ils tendent vers un universalisme (et un humanisme) parfaitement détachés de cette forme d’auto-égo-fiction que je n’arrive pas à comprendre dans notre production Hexagonale. Les livres de ces deux-là sont des mondes, livrés entiers, riches, complexes, lointains, étrangers, familiers. Bon, de la grande littérature, celle qui invente, donne la mesure de problématiques contemporaines, interroge, livre quelque sérieuse vérité au détour de pages tournées les unes derrière les autres sans ennui aucun, attentivement et passionnément. Ce sont là pour moi deux (premiers ?) représentants d’une nouvelle génération d’auteurs concernés par des mondes autres que les leurs, qui n’en racontent pas moins le leur – autrement dit, le même pour tous.
Mathias Enard, vous le connaissez sans doute, est passé tout près encore de prix littéraires à la hauteur de son talent. Il a reçu quelque lot (non négligeable) de consolation, mais enfin, Rue des Voleurs est un grand livre. Le sujet, d’abord, était périlleux, et ce n’est pas là son seul mérite évidemment. Raconter l’itinéraire d’un gamin de Tanger approché par les fanatiques, livré à la misère, poussé par un instinct de survie et l’amour des livres à se sauver à toutes jambes maigres pour passer en Europe… Il y avait là de quoi faire du misérabiliste, du manichéen, du repoussant, du navrant. Il n’en est rien : cette histoire-là est prenante, haletante, intelligente, toujours sur le fil tendu entre réalité contemporaine et fiction crédible, menant une réflexion sensible et critique sur l’immigration, ses réalités, ses clichés, ses dangers. Ecriture fantastique, narration parfaite, grand art de la justesse (voire de la justice). Hautement recommandable par les temps qui courent (formule certes fourre-tout, mais vous aurez compris). Ed. Actes Sud, 256 p., 21,50 E.
Juan Gabriel Vasquez est de la même trempe, si je puis dire. Cet auteur colombien, installé à Barcelone, est, aux dires de nombreux prestigieux lecteurs et autres spécialistes, le prochain Garcia Marquez. Je suis d’accord, à ceci près que son œuvre, hors le talent manifeste qui s’y déploie, n’a pas grand chose à voir avec l’univers marquezien, sinon l’origine, à mi-chemin entre Bogota et Cartagena.
Vasquez s’est fait repérer il y a quatre ans en France avec l’incroyable Histoire secrète du Costaguana, et il surprend à chaque nouveau livre, pour l’étendue de son imagination et la variété des territoires qu’il investit. Dans le dernier, Le Bruit des choses qui tombent, c’est la Colombie, certes, mais cette fois-ci contemporaine : où l’on déplore les morts du narcotrafic avec une résignation devenue pour ainsi dire une « idiosyncrasie nationale ». Le narrateur, Antonio, rencontre dans une partie de billard Valverde, ex-narco qui vient de purger ses vingt ans de prison. Trois semaines plus tard, le vieil homme qui voulait réparer sa vie se fait descendre, et Antonio reçoit une balle au passage. De la mort du premier va surgir la quête d’Antonio : mener l’enquête pour reconstruire l’itinéraire du défunt et se reconstruire lui-même. Sur le chemin, c’est toute la Colombie des années 70 à 90 qui apparaît, avec pour fatalité et fascination des foules : la terreur, Pablo Escobar, ses narcodollars et ses projets grandiloquents qui marquèrent une génération… à laquelle appartient l’auteur. Cela vous semblera peut-être bien « couleur locale »… pourtant, à constater le progrès constant de la violence dans notre vieille Europe, personnellement je me suis sentie concernée. Et éblouie, donc, par ce récit. Traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon, Ed. du Seuil, 293 p., 20 E.
Continuons avec ces quatre autres ouvrages que j’ai adorés… Venus de France et d’ailleurs, ils sont très différents les uns des autres, mais le plaisir de les lire est Garanti…
- Du côté de Canaan, avec Sebastian Barry

- La Survivance, par Claudie Hunzinger
Voilà un récit qui devrait toucher au-delà du cercle des libraires. Jenny et Sils mettent la clé sous la porte : librairie de campagne et maison attenante doivent être quittés, faute de succès dans les affaires. Mais, fauchés comme les blés à quelques années de la retraite, ces littéraires « façonnés de lectures et de rêves » n’ont nulle part où aller. Seule la Survivance, vieille grange abandonnée dans la montagne, à mille mètres, sans eau ni électricité, pourrait être un refuge pour leurs livres, leurs animaux et eux. Comment passer d’une vie confortable à la rude réalité des éléments ? Entre camping sauvage et apprentissage du jardinage comestible, la vie nouvelle réserve autant de calamités que de bonheurs. Au milieu des cerfs, l’heure est aussi au bilan d’une vie menée librement. « Que peuvent les livres ? » Des regrets ? On ne le saura pas, mais on suit, par la grâce de cette écriture noble et solide comme un chêne, dont je parlais déjà ici, l’aventure du couple, avec ce léger frisson lancinant : et si ça nous arrivait ? « C’est le sursis qui donne à la vie son parfum déchirant », délicieux aussi. Ed. Grasset, 279 p., 18 E.
- La dactylographe de Mr James, imaginée par Michiel Heyns
Nécessité fait loi : Frieda, jeune orpheline londonienne, doit, en dépit de ses aspirations littéraires, gagner sa vie. Elle devient dactylographe, le métier d’avenir pour les femmes dans les années 1900. Engagée par Henry James himself, elle s’installe vite à Rye, petite ville côtière du Sud où l’écrivain a fui les mondanités londoniennes. Qui font le déplacement : la flamboyante et irritante Edith Wharton, grande amie de la maison, la famille James, et ce séduisant Morton Fullerton, journaliste américain basé à Paris. De passage, ce dernier séduit l’inexpérimentée Frieda qui tombe dans ses bras et lui fait une promesse… engageant alors son propre avenir. L’histoire semble courte, mais elle ne l’est pas, car elle tient au regard de Frieda sur elle-même comme sur cet environnement. Coincée entre les affres créatives d’un Mister James dans la fleur de l’âge et sa Remington, la dactylo assiste de loin à sa vie, sans être dupe, en quête – de ce qu’elle ignore d’elle-même. L’Angleterre du début du XXe siècle, ses modes, ses Suffragettes, le spiritisme et les travaux littéraires donnent à ce roman un cadre délectable, à double-tiroir. Sous les feuillets une seule question : que faire de sa liberté ? Et un constat : la frivolité des uns peut être si périlleuse, pour la vie des autres. Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Françoise Adelstain, Ed. Philippe Rey, 324 p., 22 E.
- La maison de Salt Hay Road, par Clarin Clevidence
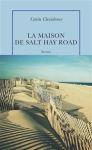
Vous l’aurez peut-être compris, dans tous ces livres, comme dans les choix du Petit Bois habituellement, il est question, d’une manière ou d’une autre, de littérature et de vie (et là j’ai une pensée émue pour Jorge Semprùn…).
Ces pages, ces tranches, vibrent toutes de ce qui nous anime : vivre, survivre, exister – si possible pleinement. C’est bien là tout ce que je nous souhaite, à tous, pour cette nouvelle année. A bientôt !
Ps. Je regrette sincèrement de ne pas vous avoir fait part de tant de spectacles actuels auxquels j’ai assisté, comme West Side Story au Châtelet, Philippe Caubère à la Maison de la Poésie à Paris… – mais il est encore temps ! Allez-y, c’est fantastique.