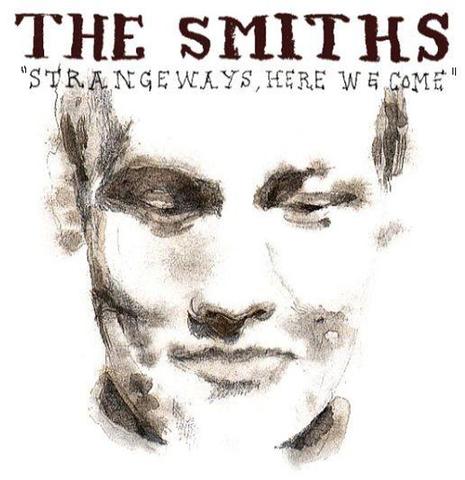 J'ai cru très longtemps que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, était le cercle. Ce fut même, il me semble, ma toute première pensée positive au sujet de cette musique. Cela se
passait dans une période révolue de ma vie, en 1989. J'écoutais Mind Bomb de The The. Parce que j'avais lu que Johnny Marr, le guitariste de The The, avait appartenu à un groupe
mythique séparé deux ans plus tôt, je suis un jour revenu de la bibliothèque-discothèque de Montreuil (c'était avant les médiathèques), avec un album vinyle, « Strangeways,
Here We Come ». Les guillemets ont leur importance, il y a peu de titres à guillemets intégrés. « Heroes », de Bowie, en est un. Ces disques sont les Bernardo de la
pop : on dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Leur muet avertissement nous invite à nous méfier, et ne rien prendre pour argent comptant. Mais cela, je l'ignorais encore.
J'étais accompagné de Stéphane G. ; c'était le début de l'été. Nous désirions le choc : aimer et n'écouter que ça jusqu'en septembre. Chez moi, nous nous sommes assis de
part et d'autre de la platine de mon père, dépourvue de couvercle : dans un jardin, nous aurions pu dire que le disque tournait à ciel ouvert. Mais nous étions dans un appartement. Dès la
première chanson, mon ami et moi fûmes également stupéfaits et unanimes : comment un groupe aussi réputé pouvait-il proposer une daube aussi complète ? S'agissait-il de l'album de la
trahison, de gens qui auraient auparavant accompli de grandes choses ? Que signifiaient ces chansons vides et lisses, hyper « commerciales », entrecoupées des ridicules
roulements de gorge du chanteur ?
« Le pauvre truc de gilou » murmurait Stéphane toutes les quarante secondes, affectant d'examiner la pochette tant cela le mettait à honte, d'être vu par moi en train
d'écouter ça. Je me revois désigner le disque de ma main ouverte, comme s'il pouvait m'expliquer. L'incroyable est que le disque me répondait : en tournant, en tournant.
Aujourd'hui (période non révolue de ma vie), je ne crois plus que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, soit le cercle, mais plutôt son dérivé tordu : le fameux « ruban de
Möbius ». Les motifs des chansons ont un peu de largeur, lorsqu'ils tournent c'est tout une surface qui s'incurve. Chaque phrase musicale semble subir un mouvement de torsion. L'intérieur
se révèle extérieur, ou vice-versa, de part et d'autre de la vrille. L'on croit quitter la figure, qu'on y est encore ; on croit y être encore, que tout, d'une certaine manière, s'est
transformé.
Dire que ce sont des chansons autonomes, hautaines, vivant sur l'énergie insufflée par chaque section à la suivante, n'est vrai qu'en partie. Il faut y ajouter une notion d'offrande : on
vient présenter son ruban de Möbius au monde comme les Bourgeois de Calais les clefs de la ville - la corde au cou. Le « monde », en l'occurrence, s'arrête aux rives de l'Angleterre,
mais cela ne change rien au message. Le « monde », à partir d'un certain moment, c'est tout ce qui n'est pas Morrissey-Marr. L'écriture devient alors une technique de survie, celle
que va adopter la pudeur, embarquée dans ce processus d'offrande et de mise à nu de soi. L'écriture, surtout, se veut contrat : voici la corde, nous vous demandons de ne pas l'utiliser
pour nous pendre.
En février 1987, lorsque paraît ce disque, Morrissey (words, disent les crédits de pochette, pas « lyrics », non : words, les mots nus) n'a plus que
quelques mois pour bénéficier de la protection de son expert personnel en rubans de Möbius de toutes formes et de toutes tailles, arrondis, écrasés, découpés, regonflés, spiralés, - de cette
ambiguïté faite homme : Johnny Marr (music, la pensée). Morrissey solo, bientôt, ce sera l'histoire de l'exhibitionniste finalement exhibé, pourchassé par plus malade que lui,
contraint de fuir, à Los Angeles, se dissimuler à l'endroit précis de la planète où tout le monde rêve d'être vu. Morrissey-Marr, c'est encore l'artiste complet, qui sait que même nu, on lui
demandera encore d'ôter quelque chose, peut-être même de s'ôter la vie, et qui agit en conséquence. L'écoute des bootlegs d'époque, surtout la tournée américaine 1986, révèle de façon
stupéfiante comme ce groupe, réellement un malgré l'absence quasi totale de signes de connivence entre ses membres, pouvait du jour au lendemain multiplier par 4 ou 5 la vitesse
d'exécution de ses chansons, torchant ainsi tout un concert, si d'aventure quelque chose émanant du public était venu froisser son inter-susceptibilité. Et, à l'écoute du moins, l'on se rend
compte qu'il ne fallait pas grand-chose. Une feuille de papier à cigarette les séparait du monde. Et le « contrat » était écrit dessus.
Une question me vient toutefois, réécoutant Strangeways, encore et encore : et si, dans cet album « testamentaire » qui n'a pourtant rien du testament, ni même d'une somme
(plutôt d'une grande soustraction à ce qu'ils avaient préalablement construit, et en cela Stéphane G. et moi n'avions pas entièrement tort), - et si, finalement, c'était Johnny Marr qui se
mettait le plus à nu ? Bien sûr, Morrissey est en train de quitter le rock anglais pour rejoindre la grande variété honteuse, qui, en Grande-Bretagne, s'appelle un peu la pop : Sandie
Shaw, il lui écrivait des lettres de fan, Morrissey, et rougissait quand l'ex-dame des Sixties le lui rappelait chez un Drucker local. Ce seront bientôt les poses christiques en contre-plongée
des pochettes solo, les concerts auxquels les filles les plus bourges de la fac allaient s'offrir le frisson correct, protégées par l'asexualité revendiquée et l'homosexualité supposée du
garçon. J'ai connu tout ça. Elles parlaient entre elles et chuchotaient tu as vu, sur ce vieux clip des Smiths, à un moment il mange une pomme.
Je repose ma question : et si c'était Johnny Marr qui lui avait tendu la pomme, par laquelle ils prirent soudain conscience qu'ils étaient nus ? Et si avant de quitter ce groupe au
mois d'août de cette même année 1987, il avait décidé lui aussi de se mettre à honte, non pas en se calant tant bien que mal des glaïeuls dans la poche arrière du pantalon pour ensuite fouetter
l'air dans une complète absence de rythme et de contrôle apparent de son corps (rituel du « Moz » attesté dès les toutes premières vidéos), mais, par sa musique, son écriture, son jeu
de guitare, son jeu de claviers, ses arrangements, sa pensée omniprésente, de montrer tout simplement ses sentiments ? Dans un contexte plutôt droitier, qu'on le veuille ou non
(« Des gens qui sont plus faibles que nous prennent ce qu'ils veulent de l'existence », j'appelle ça un propos droitier), n'est-ce pas de la compassion, dont fait
preuve, par exemple, toute l'instrumentation de Stop Me If You Think That You've Heard This One Before ? Il faut écouter tous ces petits éléments qui viennent compléter la ligne
principale, ils fonctionnent comme des capteurs d'émotion, posés sur tout le corps de la mélodie, chargés de la faire vibrer, de l'amplifier secrètement, en tel ou tel point.
Amplifier secrètement : la quadrature du cercle des Smiths.
Et n'est-ce pas un geste de compassion, encore, que celui de cette guitare, l'instrument-roi de Marr, partageant une grande partie de son espace avec les violons d'un orchestre Machinchose,
crédité sur la pochette, et dont on sait qu'il s'agissait du pauvre synthétiseur de Johnny ? Et sans que le résultat soit pour autant de la synth-pop ? Non, la guitare passe
le relais à d'autres sons, à des textures, et leur confie les messages qu'elle formulait auparavant seule. Mais les messages ne changent pas. La virtuosité descend jusqu'à la maladresse pour
lui apprendre à dire la même chose, tout en lui laissant le droit de rester maladresse. Compassion. (Certes pour soi-même, Johnny Marr jouant les deux.)
En matière de musique, d'écriture, le « naturel » n'est pas très recommandé. Pour la santé intellectuelle, évitez le bio. Dans cet album qui n'est autre qu'un organisme génétiquement
modifié, la guitare se livre à de nombreuses métamorphoses. Le travail de production la présente en permanence enveloppée d'une nimbe, non pas d'un écho vulgaire, mais au contraire d'un
surcroît de clarté, d'une aura de propreté. J'y vois le même effet que celui des guillemets du titre. Dans cette nimbe, entre ces guillemets, et sans espoir de retour au naturel du
« riff », la guitare semble jouer la citation de quelque chose qui est peut-être déjà mort. C'est de la parole qui se montre dans son processus d'agonie. Et ce que « cite »
cette guitare, n'est pas une phrase musicale du passé, nous ne sommes pas dans la reprise, ou le collage, ou l'ironie : la guitare se cite elle-même, au présent, en même temps qu'elle se
formule, vierge et inouïe, prise dans ses propre glaces.
La semaine dernière, à propos de Bob Mould, j'ai évoqué un processus de mutation, lié à une inquiétude de l'intégrité physique. Ici, le doute est maintenu quant à la quantité de données
personnelles entrant dans la composition chimique de ce que nous entendons. Les guillemets mettent en valeur, respectent, citent, mais également amenuisent : ils peuvent signifier que là
n'était pas tout à fait le mot exact, celui qu'eût exigé notre « pensée réelle ». Donc Morrissey est peut-être fake, du moins quand on découvre ça à 16-17 ans on s'interroge,
et Johnny Marr « parle » d'une façon qui n'exclut pas la présence possible, ailleurs, d'une pensée réelle. Et à eux deux, avec leurs deux façons combinées de ne pas se dire, je crois
qu'ils disent justement tout. Ils nous présentent une œuvre de nudité, entre guillemets et pourtant transparente, pleine de compassion, génétiquement outrageusement modifiée, prise dans une
lumière très lavée, comme après la pluie, lorsque tout est à la fois précis et magnifié. Et si notre lucidité soudaine est une lucidité heureuse, c'est parce qu'ils y déposent cette petite
envie de pleurer, jouissive, comme un filtre à l'angoisse.
L'on m'objectera que je prête à Strangeways de tels sentiments, sachant qu'il s'agit du dernier album du groupe. Très bien. Mais c'est tout de même Johnny Marr qui s'apprête à partir.
Il doit savoir, au moment, où il enregistre, ce qui se trame en lui ; ou bien cela se trame tellement bien que cela joue pour lui. Sur la photo intérieure de l'album précédent, le célébré
The Queen Is Dead, ce garçon est montré en studio, à moitié à plat ventre sur une chaise, se bouchant les oreilles, comme suppliant un acouphène de le laisser tranquille. Cette photo
me bouleverse comme si je voyais Bernanos en train d'écrire.
Fin de la première partie.
J'ai cru très longtemps que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, était le cercle. Ce fut même, il me semble, ma toute première pensée positive au sujet de cette musique. Cela se
passait dans une période révolue de ma vie, en 1989. J'écoutais Mind Bomb de The The. Parce que j'avais lu que Johnny Marr, le guitariste de The The, avait appartenu à un groupe
mythique séparé deux ans plus tôt, je suis un jour revenu de la bibliothèque-discothèque de Montreuil (c'était avant les médiathèques), avec un album vinyle, « Strangeways,
Here We Come ». Les guillemets ont leur importance, il y a peu de titres à guillemets intégrés. « Heroes », de Bowie, en est un. Ces disques sont les Bernardo de la
pop : on dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Leur muet avertissement nous invite à nous méfier, et ne rien prendre pour argent comptant. Mais cela, je l'ignorais encore.
J'étais accompagné de Stéphane G. ; c'était le début de l'été. Nous désirions le choc : aimer et n'écouter que ça jusqu'en septembre. Chez moi, nous nous sommes assis de
part et d'autre de la platine de mon père, dépourvue de couvercle : dans un jardin, nous aurions pu dire que le disque tournait à ciel ouvert. Mais nous étions dans un appartement. Dès la
première chanson, mon ami et moi fûmes également stupéfaits et unanimes : comment un groupe aussi réputé pouvait-il proposer une daube aussi complète ? S'agissait-il de l'album de la
trahison, de gens qui auraient auparavant accompli de grandes choses ? Que signifiaient ces chansons vides et lisses, hyper « commerciales », entrecoupées des ridicules
roulements de gorge du chanteur ?
« Le pauvre truc de gilou » murmurait Stéphane toutes les quarante secondes, affectant d'examiner la pochette tant cela le mettait à honte, d'être vu par moi en train
d'écouter ça. Je me revois désigner le disque de ma main ouverte, comme s'il pouvait m'expliquer. L'incroyable est que le disque me répondait : en tournant, en tournant.
Aujourd'hui (période non révolue de ma vie), je ne crois plus que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, soit le cercle, mais plutôt son dérivé tordu : le fameux « ruban de
Möbius ». Les motifs des chansons ont un peu de largeur, lorsqu'ils tournent c'est tout une surface qui s'incurve. Chaque phrase musicale semble subir un mouvement de torsion. L'intérieur
se révèle extérieur, ou vice-versa, de part et d'autre de la vrille. L'on croit quitter la figure, qu'on y est encore ; on croit y être encore, que tout, d'une certaine manière, s'est
transformé.
Dire que ce sont des chansons autonomes, hautaines, vivant sur l'énergie insufflée par chaque section à la suivante, n'est vrai qu'en partie. Il faut y ajouter une notion d'offrande : on
vient présenter son ruban de Möbius au monde comme les Bourgeois de Calais les clefs de la ville - la corde au cou. Le « monde », en l'occurrence, s'arrête aux rives de l'Angleterre,
mais cela ne change rien au message. Le « monde », à partir d'un certain moment, c'est tout ce qui n'est pas Morrissey-Marr. L'écriture devient alors une technique de survie, celle
que va adopter la pudeur, embarquée dans ce processus d'offrande et de mise à nu de soi. L'écriture, surtout, se veut contrat : voici la corde, nous vous demandons de ne pas l'utiliser
pour nous pendre.
En février 1987, lorsque paraît ce disque, Morrissey (words, disent les crédits de pochette, pas « lyrics », non : words, les mots nus) n'a plus que
quelques mois pour bénéficier de la protection de son expert personnel en rubans de Möbius de toutes formes et de toutes tailles, arrondis, écrasés, découpés, regonflés, spiralés, - de cette
ambiguïté faite homme : Johnny Marr (music, la pensée). Morrissey solo, bientôt, ce sera l'histoire de l'exhibitionniste finalement exhibé, pourchassé par plus malade que lui,
contraint de fuir, à Los Angeles, se dissimuler à l'endroit précis de la planète où tout le monde rêve d'être vu. Morrissey-Marr, c'est encore l'artiste complet, qui sait que même nu, on lui
demandera encore d'ôter quelque chose, peut-être même de s'ôter la vie, et qui agit en conséquence. L'écoute des bootlegs d'époque, surtout la tournée américaine 1986, révèle de façon
stupéfiante comme ce groupe, réellement un malgré l'absence quasi totale de signes de connivence entre ses membres, pouvait du jour au lendemain multiplier par 4 ou 5 la vitesse
d'exécution de ses chansons, torchant ainsi tout un concert, si d'aventure quelque chose émanant du public était venu froisser son inter-susceptibilité. Et, à l'écoute du moins, l'on se rend
compte qu'il ne fallait pas grand-chose. Une feuille de papier à cigarette les séparait du monde. Et le « contrat » était écrit dessus.
Une question me vient toutefois, réécoutant Strangeways, encore et encore : et si, dans cet album « testamentaire » qui n'a pourtant rien du testament, ni même d'une somme
(plutôt d'une grande soustraction à ce qu'ils avaient préalablement construit, et en cela Stéphane G. et moi n'avions pas entièrement tort), - et si, finalement, c'était Johnny Marr qui se
mettait le plus à nu ? Bien sûr, Morrissey est en train de quitter le rock anglais pour rejoindre la grande variété honteuse, qui, en Grande-Bretagne, s'appelle un peu la pop : Sandie
Shaw, il lui écrivait des lettres de fan, Morrissey, et rougissait quand l'ex-dame des Sixties le lui rappelait chez un Drucker local. Ce seront bientôt les poses christiques en contre-plongée
des pochettes solo, les concerts auxquels les filles les plus bourges de la fac allaient s'offrir le frisson correct, protégées par l'asexualité revendiquée et l'homosexualité supposée du
garçon. J'ai connu tout ça. Elles parlaient entre elles et chuchotaient tu as vu, sur ce vieux clip des Smiths, à un moment il mange une pomme.
Je repose ma question : et si c'était Johnny Marr qui lui avait tendu la pomme, par laquelle ils prirent soudain conscience qu'ils étaient nus ? Et si avant de quitter ce groupe au
mois d'août de cette même année 1987, il avait décidé lui aussi de se mettre à honte, non pas en se calant tant bien que mal des glaïeuls dans la poche arrière du pantalon pour ensuite fouetter
l'air dans une complète absence de rythme et de contrôle apparent de son corps (rituel du « Moz » attesté dès les toutes premières vidéos), mais, par sa musique, son écriture, son jeu
de guitare, son jeu de claviers, ses arrangements, sa pensée omniprésente, de montrer tout simplement ses sentiments ? Dans un contexte plutôt droitier, qu'on le veuille ou non
(« Des gens qui sont plus faibles que nous prennent ce qu'ils veulent de l'existence », j'appelle ça un propos droitier), n'est-ce pas de la compassion, dont fait
preuve, par exemple, toute l'instrumentation de Stop Me If You Think That You've Heard This One Before ? Il faut écouter tous ces petits éléments qui viennent compléter la ligne
principale, ils fonctionnent comme des capteurs d'émotion, posés sur tout le corps de la mélodie, chargés de la faire vibrer, de l'amplifier secrètement, en tel ou tel point.
Amplifier secrètement : la quadrature du cercle des Smiths.
Et n'est-ce pas un geste de compassion, encore, que celui de cette guitare, l'instrument-roi de Marr, partageant une grande partie de son espace avec les violons d'un orchestre Machinchose,
crédité sur la pochette, et dont on sait qu'il s'agissait du pauvre synthétiseur de Johnny ? Et sans que le résultat soit pour autant de la synth-pop ? Non, la guitare passe
le relais à d'autres sons, à des textures, et leur confie les messages qu'elle formulait auparavant seule. Mais les messages ne changent pas. La virtuosité descend jusqu'à la maladresse pour
lui apprendre à dire la même chose, tout en lui laissant le droit de rester maladresse. Compassion. (Certes pour soi-même, Johnny Marr jouant les deux.)
En matière de musique, d'écriture, le « naturel » n'est pas très recommandé. Pour la santé intellectuelle, évitez le bio. Dans cet album qui n'est autre qu'un organisme génétiquement
modifié, la guitare se livre à de nombreuses métamorphoses. Le travail de production la présente en permanence enveloppée d'une nimbe, non pas d'un écho vulgaire, mais au contraire d'un
surcroît de clarté, d'une aura de propreté. J'y vois le même effet que celui des guillemets du titre. Dans cette nimbe, entre ces guillemets, et sans espoir de retour au naturel du
« riff », la guitare semble jouer la citation de quelque chose qui est peut-être déjà mort. C'est de la parole qui se montre dans son processus d'agonie. Et ce que « cite »
cette guitare, n'est pas une phrase musicale du passé, nous ne sommes pas dans la reprise, ou le collage, ou l'ironie : la guitare se cite elle-même, au présent, en même temps qu'elle se
formule, vierge et inouïe, prise dans ses propre glaces.
La semaine dernière, à propos de Bob Mould, j'ai évoqué un processus de mutation, lié à une inquiétude de l'intégrité physique. Ici, le doute est maintenu quant à la quantité de données
personnelles entrant dans la composition chimique de ce que nous entendons. Les guillemets mettent en valeur, respectent, citent, mais également amenuisent : ils peuvent signifier que là
n'était pas tout à fait le mot exact, celui qu'eût exigé notre « pensée réelle ». Donc Morrissey est peut-être fake, du moins quand on découvre ça à 16-17 ans on s'interroge,
et Johnny Marr « parle » d'une façon qui n'exclut pas la présence possible, ailleurs, d'une pensée réelle. Et à eux deux, avec leurs deux façons combinées de ne pas se dire, je crois
qu'ils disent justement tout. Ils nous présentent une œuvre de nudité, entre guillemets et pourtant transparente, pleine de compassion, génétiquement outrageusement modifiée, prise dans une
lumière très lavée, comme après la pluie, lorsque tout est à la fois précis et magnifié. Et si notre lucidité soudaine est une lucidité heureuse, c'est parce qu'ils y déposent cette petite
envie de pleurer, jouissive, comme un filtre à l'angoisse.
L'on m'objectera que je prête à Strangeways de tels sentiments, sachant qu'il s'agit du dernier album du groupe. Très bien. Mais c'est tout de même Johnny Marr qui s'apprête à partir.
Il doit savoir, au moment, où il enregistre, ce qui se trame en lui ; ou bien cela se trame tellement bien que cela joue pour lui. Sur la photo intérieure de l'album précédent, le célébré
The Queen Is Dead, ce garçon est montré en studio, à moitié à plat ventre sur une chaise, se bouchant les oreilles, comme suppliant un acouphène de le laisser tranquille. Cette photo
me bouleverse comme si je voyais Bernanos en train d'écrire.
Fin de la première partie.
Magazine Culture
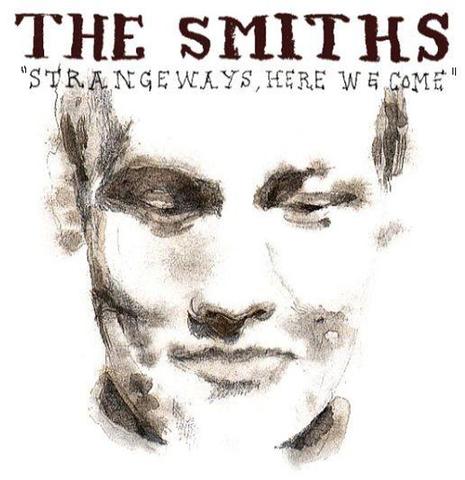 J'ai cru très longtemps que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, était le cercle. Ce fut même, il me semble, ma toute première pensée positive au sujet de cette musique. Cela se
passait dans une période révolue de ma vie, en 1989. J'écoutais Mind Bomb de The The. Parce que j'avais lu que Johnny Marr, le guitariste de The The, avait appartenu à un groupe
mythique séparé deux ans plus tôt, je suis un jour revenu de la bibliothèque-discothèque de Montreuil (c'était avant les médiathèques), avec un album vinyle, « Strangeways,
Here We Come ». Les guillemets ont leur importance, il y a peu de titres à guillemets intégrés. « Heroes », de Bowie, en est un. Ces disques sont les Bernardo de la
pop : on dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Leur muet avertissement nous invite à nous méfier, et ne rien prendre pour argent comptant. Mais cela, je l'ignorais encore.
J'étais accompagné de Stéphane G. ; c'était le début de l'été. Nous désirions le choc : aimer et n'écouter que ça jusqu'en septembre. Chez moi, nous nous sommes assis de
part et d'autre de la platine de mon père, dépourvue de couvercle : dans un jardin, nous aurions pu dire que le disque tournait à ciel ouvert. Mais nous étions dans un appartement. Dès la
première chanson, mon ami et moi fûmes également stupéfaits et unanimes : comment un groupe aussi réputé pouvait-il proposer une daube aussi complète ? S'agissait-il de l'album de la
trahison, de gens qui auraient auparavant accompli de grandes choses ? Que signifiaient ces chansons vides et lisses, hyper « commerciales », entrecoupées des ridicules
roulements de gorge du chanteur ?
« Le pauvre truc de gilou » murmurait Stéphane toutes les quarante secondes, affectant d'examiner la pochette tant cela le mettait à honte, d'être vu par moi en train
d'écouter ça. Je me revois désigner le disque de ma main ouverte, comme s'il pouvait m'expliquer. L'incroyable est que le disque me répondait : en tournant, en tournant.
Aujourd'hui (période non révolue de ma vie), je ne crois plus que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, soit le cercle, mais plutôt son dérivé tordu : le fameux « ruban de
Möbius ». Les motifs des chansons ont un peu de largeur, lorsqu'ils tournent c'est tout une surface qui s'incurve. Chaque phrase musicale semble subir un mouvement de torsion. L'intérieur
se révèle extérieur, ou vice-versa, de part et d'autre de la vrille. L'on croit quitter la figure, qu'on y est encore ; on croit y être encore, que tout, d'une certaine manière, s'est
transformé.
Dire que ce sont des chansons autonomes, hautaines, vivant sur l'énergie insufflée par chaque section à la suivante, n'est vrai qu'en partie. Il faut y ajouter une notion d'offrande : on
vient présenter son ruban de Möbius au monde comme les Bourgeois de Calais les clefs de la ville - la corde au cou. Le « monde », en l'occurrence, s'arrête aux rives de l'Angleterre,
mais cela ne change rien au message. Le « monde », à partir d'un certain moment, c'est tout ce qui n'est pas Morrissey-Marr. L'écriture devient alors une technique de survie, celle
que va adopter la pudeur, embarquée dans ce processus d'offrande et de mise à nu de soi. L'écriture, surtout, se veut contrat : voici la corde, nous vous demandons de ne pas l'utiliser
pour nous pendre.
En février 1987, lorsque paraît ce disque, Morrissey (words, disent les crédits de pochette, pas « lyrics », non : words, les mots nus) n'a plus que
quelques mois pour bénéficier de la protection de son expert personnel en rubans de Möbius de toutes formes et de toutes tailles, arrondis, écrasés, découpés, regonflés, spiralés, - de cette
ambiguïté faite homme : Johnny Marr (music, la pensée). Morrissey solo, bientôt, ce sera l'histoire de l'exhibitionniste finalement exhibé, pourchassé par plus malade que lui,
contraint de fuir, à Los Angeles, se dissimuler à l'endroit précis de la planète où tout le monde rêve d'être vu. Morrissey-Marr, c'est encore l'artiste complet, qui sait que même nu, on lui
demandera encore d'ôter quelque chose, peut-être même de s'ôter la vie, et qui agit en conséquence. L'écoute des bootlegs d'époque, surtout la tournée américaine 1986, révèle de façon
stupéfiante comme ce groupe, réellement un malgré l'absence quasi totale de signes de connivence entre ses membres, pouvait du jour au lendemain multiplier par 4 ou 5 la vitesse
d'exécution de ses chansons, torchant ainsi tout un concert, si d'aventure quelque chose émanant du public était venu froisser son inter-susceptibilité. Et, à l'écoute du moins, l'on se rend
compte qu'il ne fallait pas grand-chose. Une feuille de papier à cigarette les séparait du monde. Et le « contrat » était écrit dessus.
Une question me vient toutefois, réécoutant Strangeways, encore et encore : et si, dans cet album « testamentaire » qui n'a pourtant rien du testament, ni même d'une somme
(plutôt d'une grande soustraction à ce qu'ils avaient préalablement construit, et en cela Stéphane G. et moi n'avions pas entièrement tort), - et si, finalement, c'était Johnny Marr qui se
mettait le plus à nu ? Bien sûr, Morrissey est en train de quitter le rock anglais pour rejoindre la grande variété honteuse, qui, en Grande-Bretagne, s'appelle un peu la pop : Sandie
Shaw, il lui écrivait des lettres de fan, Morrissey, et rougissait quand l'ex-dame des Sixties le lui rappelait chez un Drucker local. Ce seront bientôt les poses christiques en contre-plongée
des pochettes solo, les concerts auxquels les filles les plus bourges de la fac allaient s'offrir le frisson correct, protégées par l'asexualité revendiquée et l'homosexualité supposée du
garçon. J'ai connu tout ça. Elles parlaient entre elles et chuchotaient tu as vu, sur ce vieux clip des Smiths, à un moment il mange une pomme.
Je repose ma question : et si c'était Johnny Marr qui lui avait tendu la pomme, par laquelle ils prirent soudain conscience qu'ils étaient nus ? Et si avant de quitter ce groupe au
mois d'août de cette même année 1987, il avait décidé lui aussi de se mettre à honte, non pas en se calant tant bien que mal des glaïeuls dans la poche arrière du pantalon pour ensuite fouetter
l'air dans une complète absence de rythme et de contrôle apparent de son corps (rituel du « Moz » attesté dès les toutes premières vidéos), mais, par sa musique, son écriture, son jeu
de guitare, son jeu de claviers, ses arrangements, sa pensée omniprésente, de montrer tout simplement ses sentiments ? Dans un contexte plutôt droitier, qu'on le veuille ou non
(« Des gens qui sont plus faibles que nous prennent ce qu'ils veulent de l'existence », j'appelle ça un propos droitier), n'est-ce pas de la compassion, dont fait
preuve, par exemple, toute l'instrumentation de Stop Me If You Think That You've Heard This One Before ? Il faut écouter tous ces petits éléments qui viennent compléter la ligne
principale, ils fonctionnent comme des capteurs d'émotion, posés sur tout le corps de la mélodie, chargés de la faire vibrer, de l'amplifier secrètement, en tel ou tel point.
Amplifier secrètement : la quadrature du cercle des Smiths.
Et n'est-ce pas un geste de compassion, encore, que celui de cette guitare, l'instrument-roi de Marr, partageant une grande partie de son espace avec les violons d'un orchestre Machinchose,
crédité sur la pochette, et dont on sait qu'il s'agissait du pauvre synthétiseur de Johnny ? Et sans que le résultat soit pour autant de la synth-pop ? Non, la guitare passe
le relais à d'autres sons, à des textures, et leur confie les messages qu'elle formulait auparavant seule. Mais les messages ne changent pas. La virtuosité descend jusqu'à la maladresse pour
lui apprendre à dire la même chose, tout en lui laissant le droit de rester maladresse. Compassion. (Certes pour soi-même, Johnny Marr jouant les deux.)
En matière de musique, d'écriture, le « naturel » n'est pas très recommandé. Pour la santé intellectuelle, évitez le bio. Dans cet album qui n'est autre qu'un organisme génétiquement
modifié, la guitare se livre à de nombreuses métamorphoses. Le travail de production la présente en permanence enveloppée d'une nimbe, non pas d'un écho vulgaire, mais au contraire d'un
surcroît de clarté, d'une aura de propreté. J'y vois le même effet que celui des guillemets du titre. Dans cette nimbe, entre ces guillemets, et sans espoir de retour au naturel du
« riff », la guitare semble jouer la citation de quelque chose qui est peut-être déjà mort. C'est de la parole qui se montre dans son processus d'agonie. Et ce que « cite »
cette guitare, n'est pas une phrase musicale du passé, nous ne sommes pas dans la reprise, ou le collage, ou l'ironie : la guitare se cite elle-même, au présent, en même temps qu'elle se
formule, vierge et inouïe, prise dans ses propre glaces.
La semaine dernière, à propos de Bob Mould, j'ai évoqué un processus de mutation, lié à une inquiétude de l'intégrité physique. Ici, le doute est maintenu quant à la quantité de données
personnelles entrant dans la composition chimique de ce que nous entendons. Les guillemets mettent en valeur, respectent, citent, mais également amenuisent : ils peuvent signifier que là
n'était pas tout à fait le mot exact, celui qu'eût exigé notre « pensée réelle ». Donc Morrissey est peut-être fake, du moins quand on découvre ça à 16-17 ans on s'interroge,
et Johnny Marr « parle » d'une façon qui n'exclut pas la présence possible, ailleurs, d'une pensée réelle. Et à eux deux, avec leurs deux façons combinées de ne pas se dire, je crois
qu'ils disent justement tout. Ils nous présentent une œuvre de nudité, entre guillemets et pourtant transparente, pleine de compassion, génétiquement outrageusement modifiée, prise dans une
lumière très lavée, comme après la pluie, lorsque tout est à la fois précis et magnifié. Et si notre lucidité soudaine est une lucidité heureuse, c'est parce qu'ils y déposent cette petite
envie de pleurer, jouissive, comme un filtre à l'angoisse.
L'on m'objectera que je prête à Strangeways de tels sentiments, sachant qu'il s'agit du dernier album du groupe. Très bien. Mais c'est tout de même Johnny Marr qui s'apprête à partir.
Il doit savoir, au moment, où il enregistre, ce qui se trame en lui ; ou bien cela se trame tellement bien que cela joue pour lui. Sur la photo intérieure de l'album précédent, le célébré
The Queen Is Dead, ce garçon est montré en studio, à moitié à plat ventre sur une chaise, se bouchant les oreilles, comme suppliant un acouphène de le laisser tranquille. Cette photo
me bouleverse comme si je voyais Bernanos en train d'écrire.
Fin de la première partie.
J'ai cru très longtemps que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, était le cercle. Ce fut même, il me semble, ma toute première pensée positive au sujet de cette musique. Cela se
passait dans une période révolue de ma vie, en 1989. J'écoutais Mind Bomb de The The. Parce que j'avais lu que Johnny Marr, le guitariste de The The, avait appartenu à un groupe
mythique séparé deux ans plus tôt, je suis un jour revenu de la bibliothèque-discothèque de Montreuil (c'était avant les médiathèques), avec un album vinyle, « Strangeways,
Here We Come ». Les guillemets ont leur importance, il y a peu de titres à guillemets intégrés. « Heroes », de Bowie, en est un. Ces disques sont les Bernardo de la
pop : on dirait qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Leur muet avertissement nous invite à nous méfier, et ne rien prendre pour argent comptant. Mais cela, je l'ignorais encore.
J'étais accompagné de Stéphane G. ; c'était le début de l'été. Nous désirions le choc : aimer et n'écouter que ça jusqu'en septembre. Chez moi, nous nous sommes assis de
part et d'autre de la platine de mon père, dépourvue de couvercle : dans un jardin, nous aurions pu dire que le disque tournait à ciel ouvert. Mais nous étions dans un appartement. Dès la
première chanson, mon ami et moi fûmes également stupéfaits et unanimes : comment un groupe aussi réputé pouvait-il proposer une daube aussi complète ? S'agissait-il de l'album de la
trahison, de gens qui auraient auparavant accompli de grandes choses ? Que signifiaient ces chansons vides et lisses, hyper « commerciales », entrecoupées des ridicules
roulements de gorge du chanteur ?
« Le pauvre truc de gilou » murmurait Stéphane toutes les quarante secondes, affectant d'examiner la pochette tant cela le mettait à honte, d'être vu par moi en train
d'écouter ça. Je me revois désigner le disque de ma main ouverte, comme s'il pouvait m'expliquer. L'incroyable est que le disque me répondait : en tournant, en tournant.
Aujourd'hui (période non révolue de ma vie), je ne crois plus que la figure des Smiths, la forme de leur écriture, soit le cercle, mais plutôt son dérivé tordu : le fameux « ruban de
Möbius ». Les motifs des chansons ont un peu de largeur, lorsqu'ils tournent c'est tout une surface qui s'incurve. Chaque phrase musicale semble subir un mouvement de torsion. L'intérieur
se révèle extérieur, ou vice-versa, de part et d'autre de la vrille. L'on croit quitter la figure, qu'on y est encore ; on croit y être encore, que tout, d'une certaine manière, s'est
transformé.
Dire que ce sont des chansons autonomes, hautaines, vivant sur l'énergie insufflée par chaque section à la suivante, n'est vrai qu'en partie. Il faut y ajouter une notion d'offrande : on
vient présenter son ruban de Möbius au monde comme les Bourgeois de Calais les clefs de la ville - la corde au cou. Le « monde », en l'occurrence, s'arrête aux rives de l'Angleterre,
mais cela ne change rien au message. Le « monde », à partir d'un certain moment, c'est tout ce qui n'est pas Morrissey-Marr. L'écriture devient alors une technique de survie, celle
que va adopter la pudeur, embarquée dans ce processus d'offrande et de mise à nu de soi. L'écriture, surtout, se veut contrat : voici la corde, nous vous demandons de ne pas l'utiliser
pour nous pendre.
En février 1987, lorsque paraît ce disque, Morrissey (words, disent les crédits de pochette, pas « lyrics », non : words, les mots nus) n'a plus que
quelques mois pour bénéficier de la protection de son expert personnel en rubans de Möbius de toutes formes et de toutes tailles, arrondis, écrasés, découpés, regonflés, spiralés, - de cette
ambiguïté faite homme : Johnny Marr (music, la pensée). Morrissey solo, bientôt, ce sera l'histoire de l'exhibitionniste finalement exhibé, pourchassé par plus malade que lui,
contraint de fuir, à Los Angeles, se dissimuler à l'endroit précis de la planète où tout le monde rêve d'être vu. Morrissey-Marr, c'est encore l'artiste complet, qui sait que même nu, on lui
demandera encore d'ôter quelque chose, peut-être même de s'ôter la vie, et qui agit en conséquence. L'écoute des bootlegs d'époque, surtout la tournée américaine 1986, révèle de façon
stupéfiante comme ce groupe, réellement un malgré l'absence quasi totale de signes de connivence entre ses membres, pouvait du jour au lendemain multiplier par 4 ou 5 la vitesse
d'exécution de ses chansons, torchant ainsi tout un concert, si d'aventure quelque chose émanant du public était venu froisser son inter-susceptibilité. Et, à l'écoute du moins, l'on se rend
compte qu'il ne fallait pas grand-chose. Une feuille de papier à cigarette les séparait du monde. Et le « contrat » était écrit dessus.
Une question me vient toutefois, réécoutant Strangeways, encore et encore : et si, dans cet album « testamentaire » qui n'a pourtant rien du testament, ni même d'une somme
(plutôt d'une grande soustraction à ce qu'ils avaient préalablement construit, et en cela Stéphane G. et moi n'avions pas entièrement tort), - et si, finalement, c'était Johnny Marr qui se
mettait le plus à nu ? Bien sûr, Morrissey est en train de quitter le rock anglais pour rejoindre la grande variété honteuse, qui, en Grande-Bretagne, s'appelle un peu la pop : Sandie
Shaw, il lui écrivait des lettres de fan, Morrissey, et rougissait quand l'ex-dame des Sixties le lui rappelait chez un Drucker local. Ce seront bientôt les poses christiques en contre-plongée
des pochettes solo, les concerts auxquels les filles les plus bourges de la fac allaient s'offrir le frisson correct, protégées par l'asexualité revendiquée et l'homosexualité supposée du
garçon. J'ai connu tout ça. Elles parlaient entre elles et chuchotaient tu as vu, sur ce vieux clip des Smiths, à un moment il mange une pomme.
Je repose ma question : et si c'était Johnny Marr qui lui avait tendu la pomme, par laquelle ils prirent soudain conscience qu'ils étaient nus ? Et si avant de quitter ce groupe au
mois d'août de cette même année 1987, il avait décidé lui aussi de se mettre à honte, non pas en se calant tant bien que mal des glaïeuls dans la poche arrière du pantalon pour ensuite fouetter
l'air dans une complète absence de rythme et de contrôle apparent de son corps (rituel du « Moz » attesté dès les toutes premières vidéos), mais, par sa musique, son écriture, son jeu
de guitare, son jeu de claviers, ses arrangements, sa pensée omniprésente, de montrer tout simplement ses sentiments ? Dans un contexte plutôt droitier, qu'on le veuille ou non
(« Des gens qui sont plus faibles que nous prennent ce qu'ils veulent de l'existence », j'appelle ça un propos droitier), n'est-ce pas de la compassion, dont fait
preuve, par exemple, toute l'instrumentation de Stop Me If You Think That You've Heard This One Before ? Il faut écouter tous ces petits éléments qui viennent compléter la ligne
principale, ils fonctionnent comme des capteurs d'émotion, posés sur tout le corps de la mélodie, chargés de la faire vibrer, de l'amplifier secrètement, en tel ou tel point.
Amplifier secrètement : la quadrature du cercle des Smiths.
Et n'est-ce pas un geste de compassion, encore, que celui de cette guitare, l'instrument-roi de Marr, partageant une grande partie de son espace avec les violons d'un orchestre Machinchose,
crédité sur la pochette, et dont on sait qu'il s'agissait du pauvre synthétiseur de Johnny ? Et sans que le résultat soit pour autant de la synth-pop ? Non, la guitare passe
le relais à d'autres sons, à des textures, et leur confie les messages qu'elle formulait auparavant seule. Mais les messages ne changent pas. La virtuosité descend jusqu'à la maladresse pour
lui apprendre à dire la même chose, tout en lui laissant le droit de rester maladresse. Compassion. (Certes pour soi-même, Johnny Marr jouant les deux.)
En matière de musique, d'écriture, le « naturel » n'est pas très recommandé. Pour la santé intellectuelle, évitez le bio. Dans cet album qui n'est autre qu'un organisme génétiquement
modifié, la guitare se livre à de nombreuses métamorphoses. Le travail de production la présente en permanence enveloppée d'une nimbe, non pas d'un écho vulgaire, mais au contraire d'un
surcroît de clarté, d'une aura de propreté. J'y vois le même effet que celui des guillemets du titre. Dans cette nimbe, entre ces guillemets, et sans espoir de retour au naturel du
« riff », la guitare semble jouer la citation de quelque chose qui est peut-être déjà mort. C'est de la parole qui se montre dans son processus d'agonie. Et ce que « cite »
cette guitare, n'est pas une phrase musicale du passé, nous ne sommes pas dans la reprise, ou le collage, ou l'ironie : la guitare se cite elle-même, au présent, en même temps qu'elle se
formule, vierge et inouïe, prise dans ses propre glaces.
La semaine dernière, à propos de Bob Mould, j'ai évoqué un processus de mutation, lié à une inquiétude de l'intégrité physique. Ici, le doute est maintenu quant à la quantité de données
personnelles entrant dans la composition chimique de ce que nous entendons. Les guillemets mettent en valeur, respectent, citent, mais également amenuisent : ils peuvent signifier que là
n'était pas tout à fait le mot exact, celui qu'eût exigé notre « pensée réelle ». Donc Morrissey est peut-être fake, du moins quand on découvre ça à 16-17 ans on s'interroge,
et Johnny Marr « parle » d'une façon qui n'exclut pas la présence possible, ailleurs, d'une pensée réelle. Et à eux deux, avec leurs deux façons combinées de ne pas se dire, je crois
qu'ils disent justement tout. Ils nous présentent une œuvre de nudité, entre guillemets et pourtant transparente, pleine de compassion, génétiquement outrageusement modifiée, prise dans une
lumière très lavée, comme après la pluie, lorsque tout est à la fois précis et magnifié. Et si notre lucidité soudaine est une lucidité heureuse, c'est parce qu'ils y déposent cette petite
envie de pleurer, jouissive, comme un filtre à l'angoisse.
L'on m'objectera que je prête à Strangeways de tels sentiments, sachant qu'il s'agit du dernier album du groupe. Très bien. Mais c'est tout de même Johnny Marr qui s'apprête à partir.
Il doit savoir, au moment, où il enregistre, ce qui se trame en lui ; ou bien cela se trame tellement bien que cela joue pour lui. Sur la photo intérieure de l'album précédent, le célébré
The Queen Is Dead, ce garçon est montré en studio, à moitié à plat ventre sur une chaise, se bouchant les oreilles, comme suppliant un acouphène de le laisser tranquille. Cette photo
me bouleverse comme si je voyais Bernanos en train d'écrire.
Fin de la première partie.
