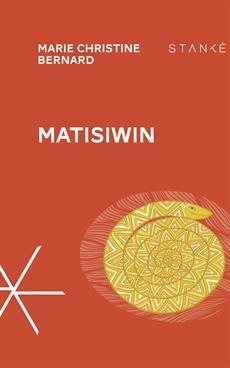
Matisiwin. Vivre.
Ce week-end, j’ai pris mon paquetage, je me suis bien emmitouflée et j’ai emboîté le pas de Sarah-Mikonic Ottawa sur le moteskano, le chemin des ancêtres. Sarah, petite-fille d’indienne atikamekw (disparue, mais dont l’âme, bien présente, est la narratrice de ce récit), fille d’indienne « civilisée » de force, mère trop jeune d’une petite fille également, s’est perdue dans l’alcool, abîmée. Les causes : les blessures d’une lignée d’Indiens marquée de manière indélébile par la violence des Blancs. Les enfants enlevés à leur famille pour rejoindre des internats où on les rebaptise, leur ôtant leur nom indien pour leur donner un nom bien français (Wapikoni, la mère de Sarah, deviendra Geneviève ; son frère deviendra Martin et finira par oublier son identité première). La violence des hommes qui empêchera Martin de témoigner son amour à sa fille. Toutes ces agressions, ces négations de l’individu qui l’enferme en lui-même, le recroqueville dans une coquille fragile, et pourtant coriace.
En entreprenant cette marche à travers les steppes, les lacs, les forêts, Sarah marche à sa propre rencontre et à la rencontre de sa lignée. De ces hommes et ces femmes qui l’ont mise au monde, élevée, éduquée, mais qui jamais ne se sont livrés à elle, qui jamais ne lui ont permis de s’ancrer à des racines qu’ils ont eux-mêmes perdues, qu’on leur a arrachées, violemment. Sarah retrouve le lien au corps, à la nature, à la vie au fur et à mesure du récit. Et le lecteur, lui aussi, éprouve successivement cette violence et cet apaisement à travers la langue de Marie Christine Bernard. Une écriture qui m’a profondément touchée : il s’en dégage à la fois de la force et de la douceur, de la poésie aussi. Au cours de ma lecture, j’ai pensé inévitablement à Le Clézio (mon auteur chouchou pour ceux qui ne le sauraient pas encore). Pour cette écriture juste, ce rapport à la nature, au peuple indien, aux errants d’un monde qui se coupe de son essence profonde. Pour cette évocation du langage et du silence :
Et chez les Atikamekw, le silence fait partie du langage : le corps parle. Ils sont toujours à l’aise dans le silence.
Pour cette idée du temps aussi :
Ils disent « le temps des Indiens ». Indian Time. Ils disent que les Indiens sont toujours en retard. Qu’il ne faut pas leur donner de rendez-vous, qu’ils ne savent pas respecter un horaire. Que c’est bien désolant. Ceux qui sont allés au pensionnat savent à quel point ils trouvent cela désolant.
Que savent-ils du temps ? Ils font comme avec le reste. Ils mettent tout dans des petites cases. Les choses à faire. Les mots à dire. Les rêves. Les gens. Le froid. La pluie. Les étoiles. Des petites cases pour ranger les animaux, les plantes, les pierres par ordre de règne, de classe, de famille ou de genre avec des noms qui parlent de toutes sortes de choses, sauf d’eux. Quand je vais à la rencontre de Wapoc dans mon chemin de collets, je ne me demande pas à quels famille, classe, embranchement va appartenir ce lièvre qui sera venu offrir sa vie pour ma famille. Je me demande s’il aura le ventre assez doux pour compléter la couverture destinée à tenir mon bébé au chaud, si sa chair sera parfumée de bourgeons de sapins ou d’écorce, si Mikeciw, le renard, est passé avant moi. Et quand je commence à préparer la peau, je ne me demande pas si je vais avoir le temps de terminer avant de commencer autre chose. Je prépare la peau. Ça prend le temps que ça prend.
Chez eux, tu commences quelque chose et quand la case change, tu dois tout laisser en plan pour commencer autre chose. Tu continueras ce que tu as commencé la semaine prochaine, le même jour, à la même heure. Même jour ? Même heure ? Aucune heure, aucun jour n’est pareil à un autre. Et si la vie s’arrête d’ici là, comment vas-tu pouvoir terminer la tâche entreprise ?
Le temps des Blancs, c’est comme si l’infini avait été cassé en petites perles toutes égales qu’ils enfilent sur un collier qui ne sera jamais refermé, qui ne parera jamais aucun cou. A quoi sert un collier qui va toujours tout droit ? Je veux bien enfiler des perles et que ces perles soient des morceaux de temps. Mais chaque perle a sa couleur et son poids, et ne ressemble à aucune autre. Chaque est heure est habitée d’elle-même et nous dicte ce dont elle doit être faite.
Matisiwin, Marie-Christine Bernard, éditions Stanké

Classé dans:Les Mots de Nadège
