« Que c’est agréable de n’être plus jeune ! Agréable de ne plus se préoccuper de ce que pensent les gens ! On peut vivre à sa guise… quand on a soixante-dix ans. » (p. 525)
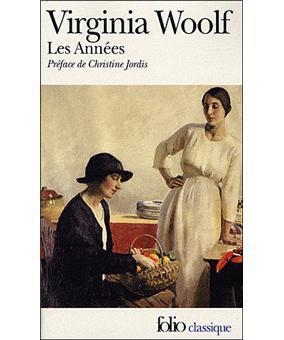
D’après mon expérience, les romans se partagent en deux catégories (avec une infinité de variations entre les deux). Il y a d’abord les romans qui nous embarquent facilement dans leur histoire ; le lecteur est plutôt passif et n’a qu’à se laisser porter par la vague ; nous avons ici affaire aux page-turner, aux romans-détente, aux romans d’aventures à rebondissements, aux polars bien troussés. Et puis il y a les romans qui exigent une participation active du lecteur, qui l’invitent à s’approprier les images, les sons, les sensations décrites, à les faire siennes. Ceux-là ne se laissent pas facilement cerner au départ, mais au bout d’un certain nombre de pages ils déploient une grande puissance d’envoûtement (s’ils sont bons évidemment). Au risque de tomber dans le comble du cliché, dans le second cas on trouve typiquement la Recherche de Proust. Les premiers peuvent nous laisser un peu sur notre faim, un peu vides, lorsqu’on les termine, car ils fonctionnent sur le mode de l’addiction. On sort des seconds plus enrichis, avec un sentiment de plénitude, comme si l’on était parvenus au sommet d’une montagne. Les deux catégories sont nécessaires à mon équilibre😉
Si Les Années de Virginia Woolf appartient à la seconde catégorie sans hésitation (le contraire eut été étonnant), il est quand même d’une facture beaucoup plus classique que Les Vagues (qui faisaient « dialoguer » les fors internes de ses « personnages »). Les Années ce sont tout simplement les années qui s’écoulent entre 1880 et 1930 et quelques, le temps de voir vivre et se croiser trois générations d’une même famille, les Pargiter. Du grand-père colonel à sa petite-fille médecin, en passant par sa fille suffragette, son fils avocat, la fille qui a épousé un Irlandais, le fils qui est parti au loin, la fille aînée qui est restée vieille fille pour s’occuper de son père (ils sont 7 ou 8 enfants, je ne les ai pas comptés), leur cousine riche, leurs cousines pauvres, etc etc. Leur monde : Londres, Oxford, la campagne anglaise, les réceptions, le voyage aux Indes, les réunions associatives, le déclassement vers les bas quartiers de Londres.
La guerre, les nouveautés technologiques, une mèche blanche ou un embonpoint qui pointe, un décès, sont autant de signes qui forgent l’impression du temps qui passe : les heures, les jours, les années défilent comme dans un carrousel. Tout y passe, y compris les événements les plus minimes. Et d’ailleurs, les grands événements de la Grande Histoire nous sont à peine suggérés, incidemment, au même titre qu’un dé à coudre perdu dans les plis d’un fauteuil. Il faut comprendre que quand Rose se prend une pierre et fait de la prison, c’est parce qu’elle revendique le droit de vote pour les femmes (du moins j’ai cru le comprendre, mais évidemment je n’en suis pas sûre à 100%). De très nombreuses allusions percent dans ce roman fourmillant, et dévoilent autant de critiques du système social où s’insèrent les personnages, mais elles sont tellement elliptiques qu’on pourrait ne pas y prendre garde, et rire simplement de la vieille bonne congédiée et marmonnante, quand il s’agit de bien plus que cela.
L’écriture de Virginia Woolf est géniale, je crois que quiconque s’y intéresse partage cette affirmation. C’est même l’intérêt principal du roman, plus que l’histoire en elle-même. (Petite parenthèse : ce doit être une question de traduction mais ici j’ai eu l’impression que cette écriture était plus légère et anodine que dans Les Vagues traduites par Yourcenar). Toujours est-il que par son écriture, même filtrée par la traduction, Woolf porte un regard à la fois naïf et incisif sur les choses les plus triviales du quotidien, ce qui les rend tout d’un coup insolites. Elle embrasse dans une même phrase ou un même paragraphe les choses et les personnes les plus lointaines. Les flux de pensée des personnages se marient harmonieusement avec la mécanique invisible de l’univers. Elle relie des choses en apparences très différentes mais qui semblent d’un coup fonctionner en syntonie.
« Il pleuvait. Une pluie fine, une légère averse, saupoudrait les pavés et les rendait gras. Cela valait-il la peine d’ouvrir son parapluie, de faire signe à un cab ? se demandaient les gens au sortir du théâtre, en levant les yeux vers le ciel calme, laiteux, et ses étoiles ternes. (…) Cela valait-il la peine de s’abriter sous l’aubépine, sous la haie ? semblaient se demander les brebis ; et les vaches, déjà au pacage dans les champs gris, sous les buissons incolores, continuaient à ruminer, à mâchonner, d’un air endormi, avec des gouttes de pluie sur leurs flancs. » (p.99)
Elle a un don pour transcrire les dialogues : ce ne sont pas les dialogues bien écrits, enlevés, plaisants à lire, du roman romanesque de bon aloi. Ce n’est pas ainsi que nous parlons dans la vraie vie, n’est-ce pas ? Quand nous parlons, nous commençons une phrase sans la finir, nous interrompons notre interlocuteur, nous divaguons… Eh bien il semblerait que Woolf ait branché sa petite caméra secrète pour surprendre ces conversations sans queue ni tête de la vraie vie et les retranscrire… Même si en réalité, elle a dû les travailler soigneusement ! Et elle s’en amuse la coquine !
« Toutes les conversations seraient absurdes, je pense, si on les mettait par écrit », fit-elle en remuant son café. Maggie arrêta sa machine un instant et dit avec un sourire : « Même si on ne le fait pas. » (p. 240)
Voire même, elle s’immisce carrément dans le roman à la toute fin, avec cette phrase, au beau milieu d’un dialogue, comme si la romancière qu’elle est disait : « zut à la fin de me fatiguer à reproduire leurs stupides conversations ! » :
« C’est facile pour vous qui habitez Londres… », disait-elle. Mais l’ennui de noter les paroles des gens c’est qu’ils racontent tant de bêtises… des vraies bêtises. » (p. 444) Si vous le dîtes, Mrs Woolf !
Elle excelle à rendre compte des tours et détours de la pensée de quelqu’un qui rêvasse :
« Qu’elle était ignorante. Par exemple, cette tasse – elle la tint devant elle. De quoi est-elle faite ? d’atomes ? Et que sont les atomes, comment adhèrent-ils les uns aux autres ? La surface dure et unie de la porcelaine avec son motif de fleurs rouges lui apparut soudain comme un merveilleux mystère. » (p. 221)
Elle montre le sentiment d’oppression que ressentent beaucoup de femmes en société, et l’échappatoire, le sentiment de libération que représentent les transports modernes pour elles :
« Au milieu de la circulation, elle distingua un véhicule rebondi. Dieu soit loué, sa teinte était jaune. Dieu soit loué, elle n’avait pas manqué son omnibus. Elle fit un signe et grimpa sur l’impériale. Elle poussa un soupir de soulagement, lorsqu’elle remonta sur ses genoux le tablier de cuir. La responsabilité passait entre les mains du conducteur. Elle se détendit et respira la douce atmosphère de Londres. » (p. 152)
« Juste à temps, se dit Kitty, debout dans son compartiment. Elle avait peine à croire qu’un monstre si formidable pût s’élancer si doucement pour entreprendre un tel parcours. Elle vit le buffet reculer. Nous voilà partis, se dit-elle, en se laissant tomber sur la banquette. Nous voilà partis. Toute la tension de son corps se relâcha. Elle était seule ; et le train roulait. On dépassa la dernière lampe du quai. La dernière silhouette s’évanouit. Quelle joie ! se dit-elle, comme si elle était une petite fille échappée à sa nurse. Nous voilà partis ! » (p. 352)
« Eleanor ferma le livre. Je le lirai un de ces jours, se dit-elle. Lorsque j’aurai mis Crosby à la retraite et que… Prendrait-elle une autre maison ? Voyagerait-elle ? Irait-elle enfin aux Indes ? Sir William se mettait au lit dans la chambre voisine. Sa vie à lui se terminait, elle commençait la sienne. Non je ne chercherai pas à m’installer dans une autre maison. Certainement pas, songea-t-elle, considérant la tâche au plafond. De nouveau elle eut la sensation du navire qui clapote doucement à travers les vagues, du train qui se balance de côté et d’autre, le long des rails. Les choses passent, se transforment, se dit-elle, les yeux au plafond. Et où allons-nous ? Où cela ? Où cela ?… Les papillons de nuit s’élançaient autour du plafond ; le livre glissa à terre. Craster a gagné le cochon, mais qui donc a eu le plateau d’argent ? Elle rêvassait, fit un effort, se retourna pour souffler la bougie. L’obscurité régna. » p. 288
Et aussi le décalage, la brèche temporelle que produisent notamment les technologies modernes :
« Elle semblait rassembler deux images de son cousin ; sans doute celle du téléphone et celle qui lui apparaissait dans le fauteuil. Ou bien en existait-il une autre ? Cette façon de connaître les gens à demi, d’être à moitié connu soi-même, cette sensation de l’œil qui se pose sur la chair, comme une mouche qui rampe, c’est bien désagréable, se dit-il, mais impossible à éviter après tant d’années. » (p. 401)
« – J’ai dit : est-ce un oiseau ? Non, je ne crois pas. C’est trop gros. Cependant ça avance, et subitement, j’ai pensé : C’est un aéroplane. Et c’était vrai. Tu te souviens, ils avaient survolé la Manche peu de temps auparavant. J’étais avec vous dans le Dorset quand j’ai lu cela dans le journal. Alors quelqu’un, ton père je crois, a dit : ‘Le monde ne sera plus jamais le même à présent.' » (p. 419)
Et enfin, Woolf a beaucoup d’humour (si, si !) qui se manifeste soit par de l’ironie, un effet de grossissement des petites manies des gens par exemple, ou la moquerie des convenances de l’époque, soit dans certains dialogues d’une grande drôlerie, comme celui-ci :
« J’étais seule, assise, j’ai entendu la sonnette, je me suis dit : C’est la blanchisseuse. Des pas montaient l’escalier. North est apparu. North. » Sara porta la main à sa tête en manière de salut. « Il avait cet air-là… ‘Pourquoi diable ?’ ai-je demandé. ‘Je pars demain pour le front’, m’a-t-il dit en claquant les talons. ‘Je suis lieutenant du…’, je ne sais plus… régiment royal d’attrapeurs de rats ou quelque chose de ce genre. Et il a posé sa casquette sur le buste de notre grand-père. ‘Combien de morceaux de sucre réclame un lieutenant des régiments royaux des attrapeurs de rats ?’ ai-je demandé. « Un. Deux. Trois. Quatre ?‘ » (p. 370)
Voilà, voilà, j’espère, avec cette petite collection de citations, vous avoir donné l’envie de vous plonger dans ce roman, et bien d’autres, d’une romancière que je découvre petit à petit (et dans son cas, il est précieux de prendre son temps pour savourer). Merci à Lili qui donne sur son blog de passionnée woolfienne tant de clés de lecture de cette oeuvre ! Par exemple ici, ici et ici.
« Les années » de Virginia Woolf, traduction de Germaine Delamain et Colette-Marie Huet, préface de Christine Jordis, Folio classique, réédité en 2008, 452 p.


