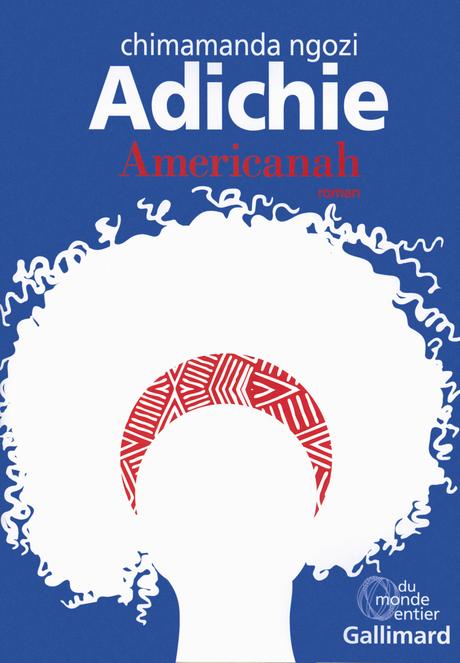 C’est une des alchimies secrètes telles qu’en concocte parfois le petit dieu des lecteurs, que celle d’avoir lu Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie (j’ai le droit de dire que je fais encore des fautes à son nom ? #shame) juste après avoir lu Bakhita. Après la petite esclave soudanaise échouée en Italie, l’étudiante nigériane émigrée aux États-Unis. Entre les deux, pas grand chose de commun à première vue, à part leur africanité. La première est née dans un village reculé du Darfour en 1869 ; la seconde est une enfant de la classe moyenne de Lagos grandie dans les 70’s et 80’s du XXe siècle. La première ne maîtrise aucune langue vraiment ; la seconde parle un anglais châtié mâtiné d’expressions igbos. La première est religieuse en Italie ; la seconde est une blogueuse en vue aux États-Unis. La première ressent en son corps et son âme l’injustice suprême ; la seconde la prend comme objet d’observation et la vit sur un mode forcément mineur en vue des souffrances de l’esclavage. Mais en dépit des différences notables, le « signe de Caïn » qu’elles portent toutes les deux les unit : celui d’arborer une peau noire dans un monde culturellement blanc, ce signe inscrit sur elle qui leur vaut des traitements différents, des préjugés peu favorables et de se situer dans « l’oeil d’une psychose », collective et hystérique, notamment aux USA.
C’est une des alchimies secrètes telles qu’en concocte parfois le petit dieu des lecteurs, que celle d’avoir lu Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie (j’ai le droit de dire que je fais encore des fautes à son nom ? #shame) juste après avoir lu Bakhita. Après la petite esclave soudanaise échouée en Italie, l’étudiante nigériane émigrée aux États-Unis. Entre les deux, pas grand chose de commun à première vue, à part leur africanité. La première est née dans un village reculé du Darfour en 1869 ; la seconde est une enfant de la classe moyenne de Lagos grandie dans les 70’s et 80’s du XXe siècle. La première ne maîtrise aucune langue vraiment ; la seconde parle un anglais châtié mâtiné d’expressions igbos. La première est religieuse en Italie ; la seconde est une blogueuse en vue aux États-Unis. La première ressent en son corps et son âme l’injustice suprême ; la seconde la prend comme objet d’observation et la vit sur un mode forcément mineur en vue des souffrances de l’esclavage. Mais en dépit des différences notables, le « signe de Caïn » qu’elles portent toutes les deux les unit : celui d’arborer une peau noire dans un monde culturellement blanc, ce signe inscrit sur elle qui leur vaut des traitements différents, des préjugés peu favorables et de se situer dans « l’oeil d’une psychose », collective et hystérique, notamment aux USA.
Dans le roman fleuve d’Adichie, nous suivons la trajectoire de la jeune Ifemelu, depuis ses années d’écoliere dans un établissement huppé de la capitale Lagos, jusqu’à son arrivée aux États-Unis à l’âge de 19 ans, et son retour au pays natal, 13 ans après. On croise ses amis, ses parents, sa tante elle-même émigrée en Amérique. Son histoire d’amour avec Obinze file tout le roman, poignante comme l’est la nostalgie d’un lieu évanoui où l’on se sentirait vraiment chez soi. L’auteur nous plonge dans la fièvre lagosienne où tout le monde semble dévoré par l’ambition, dans les problèmes du pays, ses inégalités, mais aussi la saveur sans filtre des échanges humains. On croise une mère qui se convertit chaque mois à une nouvelle secte protestante, un père au chômage et dépressif, une tante médecin et entretenue par un général proche du régime, un groupe d’amis obsédés par l’idée de l’exil, la réussite sociale et les peaux claires. Les années de jeunesse nigériane occupent toute la première partie du roman, quand une Ifemelu déjà adulte, installée depuis longtemps aux États-Unis et songeant au retour, se souvient, tandis qu’elle est installée dans un salon de coiffure africain miteux.
Toute la deuxième partie se concentre sur l’exil américain d’Ifemelu et là… ça barde ! C’est un incroyable roman sur le déracinement mais surtout sur la condition noire aux États-Unis. L’auteur ne fait pas, ou peu, dans la théorie. À travers une Ifemelu très consciente et à la forte personnalité, elle observe les décalages, les non-dits, les angles morts et les tabous du rêve américain, vu d’une « Noire non-américaine » comme l’inscrit Ifemelu dans le titre de son blog « sur la race » qui devient extrêmement populaire. Elle met le doigt sur des situations parfois cocasses, souvent désolantes, le ton est ironique, et les vérités, cinglantes. Revendiquant sa subjectivité, et le droit pour les noirs en Amérique d’être en colère (ce qui fait peur aux autres reconnaît-elle), elle évite pourtant l’écueil du manichéisme : il n’y a pas les bons d’un côté, les méchants de l’autre. Les noirs ne forment pas un « bloc », chacun a sa manière de vivre avec la couleur de sa peau (ou de l’ignorer), et il y a une ligne de fracture notable entre noirs américains et noirs africains émigrés récemment en Amérique. Bien que vigoureuse, la critique développée par l’auteur à travers Ifemelu et ses billets de blog englobe pleinement la complexité du monde.
« Cher noir non-américain, quand tu fais le choix de venir en Amérique, tu deviens noir. Cesse de discuter. Cesse de dire je suis jamaïcain ou je suis ghanéen. L’Amérique s’en fiche. Quelle importance si tu n’es pas « noir » chez toi ? Tu es en Amérique à présent. (…) Quand tu décris les femmes noires que tu admires, emploie toujours le mot « forte » parce que c’est ce que les Noires sont censées être en Amérique. Si tu es une femme, ne dis pas ce que tu penses comme tu le ferais dans ton pays. Parce que en Amérique, les femmes noires qui réfléchissent font peur. Et si tu es un homme, sois super-détendu, ne t’excite jamais, sinon quelqu’un pourrait craindre que tu sortes un pistolet. (…) Si tu racontes à un non-noir l’incident raciste dont tu as été victime, ne montre aucune amertume. Ne te plains pas. Sois indulgent. Si possible, drôle. Avant tout, ne te mets pas en colère. Les Noirs ne sont pas supposés s’emporter sur des questions racistes. Sinon tu n’attires pas la sympathie. » (P. 332)
Mais bien que l’enjeu principal de la partie américaine soit la question de la race, le roman aborde bien d’autres sujets : les questions d’intégration, d’éducation, d’inégalité économique, de culture, le féminisme et l’engagement politique (l’élection d’Obama est vécue de l’intérieur). Mais c’est aussi simplement un roman envoûtant et fascinant qui nous immerge complètement dans les aléas de ses personnages et nous fait naviguer entre des scènes croquées avec justesse et humour. Au plus pourrait-on regretter quelques longueurs. En miroir, nous avons également l’expérience d’Obinze en Angleterre.
« Alexa, et les autres invités, peut-être même Georgina, comprenaient tous la fuite devant la guerre, devant la pauvreté qui broyait l’âme humaine, mais ils étaient incapables de comprendre le besoin d’échapper à la léthargie pesante du manque de choix. » (P. 409)
Il y a donc du roman d’aventure et d’apprentissage dans « Americanah », le terme employé par les Nigérians pour qualifier ceux d’entre eux qui ont émigré aux États-Unis. Des réflexions précieuses et actuelles sur la condition noire, qui n’est pas une question de gènes mais de façon d’être perçu et d’y réagir. Et au fil des pages, une nostalgie en filigrane pour le pays de l’enfance. Sort-on hors de soi quand on émigre ? Toute la trajectoire d’Ifemelu montre sa difficile conquête d’elle-même après les « trahisons » de la migration, et ainsi, elle atteint l’universel.
« Les larmes lui piquaient les yeux. Il prit sa main, la garda serrée dans la sienne sur la table et le silence s’alourdit entre eux, un silence ancien qui leur était familier. Elle était à l’intérieur de ce silence et elle y était en sûreté. » (P. 633)
Si vous voulez en savoir plus sur Adichie et son dernier roman, lisez l’article qui la qualifie de « Tolstoï africain et féminin ».
« Americanah »de Chimamanda Ngozi Adichie, Galimard, Folio, 2014, 685 p.
Publicités
