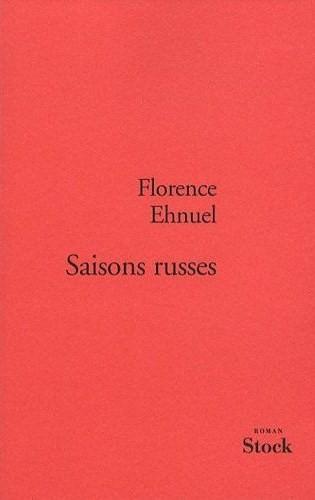 Florence Ehnuel avait, l’an dernier, obtenu un succès mérité avec son texte, Le Beau sexe des hommes, dont j’avais rendu compte dans ces colonnes. Avec son nouveau roman, Saisons russes (Stock, 151 pages, 15 €), elle continue de creuser un sillon entamé en 2004 avec la publication de son premier livre, L’Amour conjugué.
Florence Ehnuel avait, l’an dernier, obtenu un succès mérité avec son texte, Le Beau sexe des hommes, dont j’avais rendu compte dans ces colonnes. Avec son nouveau roman, Saisons russes (Stock, 151 pages, 15 €), elle continue de creuser un sillon entamé en 2004 avec la publication de son premier livre, L’Amour conjugué.
Son thème de prédilection ? L’histoire d’une femme quadragénaire habitant une grande ville de province, active, sensuelle, libre d’esprit, confrontée à la vie et, surtout, à elle-même. Une femme dont l’horizon des désirs n’est jamais bouché (bien que sa liberté, parfois, la tétanise) et qui, probablement, lui ressemble un peu. D’autres qu’elle se sont livrées à un tel exercice, au point de rendre ce sujet assez banal, voire indigeste, mais Florence Ehnuel a su se garder de tous les travers (et Dieu sait qu’ils sont nombreux et agaçants !) de l’autofiction et du « tout à l’ego ». Pour exprimer autrement ce sentiment, je dirais que son écriture, si elle en vient à évoquer le quotidien de ses héroïnes, entre enfants, amies, amant(s), obligations sociales, professionnelles et domestiques, me fait davantage penser à Georges Perec qu’à Christine Angot…
Dans Saisons russes, la narratrice raconte une expérience qui s’étend sur une année, une expérience singulière, celle de l’apprentissage d’une langue étrangère. Aucun but utilitaire ne vient justifier son choix :
« Vers l’âge de quarante ans, j’ai eu envie de reprendre l’apprentissage d’une langue. J’avais quitté cette activité depuis que j’avais terminé mes études. Je percevais que mon cerveau en était endolori, qu’il me signalait une menace de nécrose. […] Enfin ! pour être tout à fait honnête, ce n’était pas seulement mon cerveau, non ! Mais tous mon corps. Et ma pensée. Toute ma personne, qui voulait connaître à nouveau cette expérience de sentir l’expression depuis sa naissance. Ma personne entière recherchait cet effort. »

Durant quatre saisons, la narratrice se rendra chez lui, à bicyclette, en dépit de la distance et des aléas climatiques, à raison de deux séances mensuelles, puis d’un cours hebdomadaire. Ce rythme n’est pas sans faire penser à une psychanalyse ou au rituel amoureux. L’auteur décrit ses progrès, la métamorphose que le russe – langue tonale, rendue moins facilement abordable que d’autres par ses déclinaisons et l’alphabet cyrillique, mais pour laquelle elle s’enthousiasme – produit en elle. Les mots et leur musicalité l’imprègnent en profondeur au point qu’ils contribuent à modifier sa vision du monde et de sa propre vie. Mots et phrases agissent, tels des fils invisibles et jusque dans les silences, pour tisser entre maître et élève une relation complexe dont le lecteur jugera la nature ; un jeu tout en subtilité, parfois déroutant, dominé par la cérébralité des deux protagonistes.

« Je m’enfonce en moi-même, j’ai pleinement le droit de sentir ce que je sens et d’affirmer que la morosité et l’angoisse sont les deux couleurs majeures de mon paysage psychique. Iouri le confirme puisqu’il le dit aussi. Le russe me valide. Je suis estampillée. J’existe avec mes peines. Ce ne sont même pas des confidences, des secrets qu’il faut dire en douce, en catimini, ce sont de denses réalités, que l’on reconnait au grand jour, car elles peuvent s’exprimer aussi dans la langue d’un autre peuple et d’une autre littérature. »
Ce en quoi son roman se rapproche d’un proverbe russe dont la traduction, à double sens, nous dit : « Ce n’est pas le champ qui nourrit, c’est la culture. »
Illustrations : Vélo © D.R. - Vue de Saint Petersbourg © D.R.

