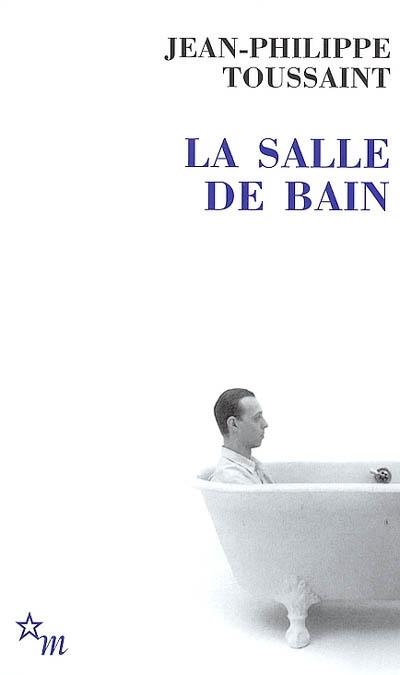
On savait déjà, grâce à Xavier de Maistre et son fameux Voyage autour de ma chambre, qu'un espace clôt et personnel pouvait devenir le « personnage » principal d'un livre. Quiconque a eu en mains Sur la lecture de Marcel Proust se souvient de l'écrivain évoquant les moments passés dans sa chambre, refuge indispensable pour pouvoir savourer la chose écrite.
Jean-Philippe Toussaint campe son premier roman non pas dans une chambre à coucher ni dans une cuisine, à l'instar de la romancière japonaise Banana Yoshimoto – Kitchen -, mais dans une salle de bain. Le narrateur y passe ses après-midi et y reçoit ses proches sans que personne ne manifeste une surprise ou une émotion démesurées devant un tel choix.
« Maman m'apporta des gâteaux. Assise sur le bidet, le carton grand ouvert posé entre ses jambes, elle disposait les pâtisseries dans une assiette à soupe. Je la trouvais soucieuse, depuis son arrivée elle évitait les regards. Elle releva la tête avec une lasse tristesse, voulut dire quelque chose, mais se tut, choisissant un éclair dans lequel elle croqua. Tu devrais te distraire, me dit-elle, faire du sport, je ne sais pas moi. Elle s'essuya le coin des lèvres avec son gant. Je répondis que le besoin de divertissement me paraissait suspect. Lorsque, en souriant presque, j'ajoutais que je ne craignais rien moins que les diversions, elle vit bien que l'on ne pouvait pas discuter avec moi et, machinalement, me tendit un mille-feuilles. »
J'aime beaucoup ce passage situé au début du livre parce qu'on comprend d'où vient le narrateur et les raisons qui l'ont poussé à se retirer dans cette pièce. Mais il me semble qu'il dit aussi l'impossibilité, finalement, de se couper totalement du monde extérieur, de la communication avec autrui, fût-elle réduite à sa plus absurde expression. On se parle mais il n'est pas question d'intimité, ce qui est paradoxal dans un tel endroit. Ce court dialogue s'achève vite. La mère tend un gâteau comme pour obliger son fils à se taire. Merveilleuse scène que n'importe quel psy « dégusterait » en dressant un parallèle entre nourriture et mère nourricière.
Outre sa mère, le narrateur reçoit la visite d'Edmondsson. Curieuse identité que celle-ci, sans prénom. C'est d'autant plus surprenant que ce personnage fait partie des proches. Le lecteur apprendra plus tard qui est Edmondsson : la copine du locataire de la salle de bain.
« Assis sur le rebord de la baignoire, j'expliquais à Edmondsson qu'il n'était peut-être sain, à vingt-sept ans, bientôt vingt-neuf, de vivre plus ou moins reclus dans une baignoire. Je devais prendre un risque, disais-je les yeux baissés, en caressant l'émail de la baignoire, le risque de compromettre la quiétude de ma vie abstraire pour. Je ne terminai pas ma phrase. »
Outre Edmondsson qui officie dans une galerie d'art, on croise des peintres, fauchés, qui travaillent dans l'appartement. Il s'agit de Polonais qui, progressivement, semblent s'installer, prendre leurs aises. En témoigne cette scène avec le dénommé Kabrowinski. Il prend un soin tout particulier à s'occuper de calamars. Jean-Philippe Toussaint excelle dans la description de détails insignifiants. Description qui pose, outre la question du regard, celle du temps.
« La trotteuse tournait autour du cadran. Immobile. A chaque tour, une minute s'écoulait. C'était lent et agréable. »
Plus loin :
« C'est l'écoulement du temps qui, une fois de plus, m'avait horrifié. »
On rit beaucoup en lisant La salle de bain. On rit par exemple lorsque le narrateur confie être invité à une soirée à l'ambassade d'Autriche dont le représentant s'appelle Eigenschaften. Si vous n'êtes pas germaniste, sachez que ce mot signifie « propriété, caractère propre, qualité ». Une référence, peut-être, à l'Ulrich chez Musil dans son Mann ohne Eigenschaften, L'Homme sans qualités ?
Homme sans qualité mais aussi, donc, sans caractère, sans identité vraiment définie, semble-t-il. L'autre Polonais est lui aussi introduit par son nom, Kovalskazinski, puis par son prénom, Jean-Marie. Inversion identitaire, monde à l'envers marqué par des situations absurdes et des dialogues où certaines phrases semblent tomber comme un cheveu sur la soupe :
« L'hypothénuse fait référence à la citation introductive de Pythagore : « le carré de l'hypothénuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. »
Dans la deuxième partie du roman, le narrateur s'en va. Il prend le train pour l'Italie. Décor différent : une chambre d'hôtel, mais banalité identique des situations. L'empathie que j'avais jusqu'à présent pour le narrateur s'est progressivement transformée. On sent à présent monter une colère, une violence chez notre personnage principal. Ainsi, quand il se moque de deux autres touristes.
« leurs raisonnements me semblaient d'une suave pertinence. »
Et puis il y a ce jeu de fléchettes auquel il s'adonne avant de téléphoner à Edmondsson.
Il est curieux de noter que ce livre explore un espace médian. Jean-Philippe Toussaint n'évoque jamais vraiment le décor extérieur – dans cette partie, on n'apprend que tardivement, que l'action se déroule à Venise – ni le monde intérieur. Point de descriptions ou si peu. Peu d'intime. Comme s'il s'agissait avant de tout regarder avec froideur et distance. Distance parfois toute scientifique :
« A raison d'un enfoncement de la ville de trente centimètres par siècle, expliquais-je, donc de trois millimètres par an, donc de zéro virgule zéro zéro quatre-vingt-deux millimètres par jour, donc de zéro virgule zéro zéro zéro zéro zéro zéro un millimètre par seconde, on pouvait raisonnablement, en appuyant bien fort nos pas sur le trottoir, escompter être pour quelque chose dans l'engloutissement de la ville. »
Plus loin :
« Mes cauchemars étaient rigides, géométriques. »
Cette distanciation passe par l'utilisation tout aussi subite que surprenante d'une langue étrangère, l'anglais, dans ce passage des Pensées de Pascal que le narrateur se met à lire. On notera ici une plongée dans l’intime. Comme s’il était impossible de parler de sentiments profonds dans son propre idiome. Qu’il faille donc trouver un intermédiaire.
« But when I thought more deeply, and after I had found the cause for all our distress, I wanted to discover its reason, I found out there was a valid one, which consists in the natural distress of our weak and mortal condition, and so miserable, that nothing can console us, when we think it over. »
Ce recours à la philosophie ne s'accompagne pas d'une passion immodérée pour la sagesse chez le narrateur. En témoigne la fléchette qu'il lancera sur le font d'Edmondsson. Cela ne l'empêchera pas de poursuivre une vie comme si de rien n'était où il sera question de parties de tennis avec un médecin et sa femme.
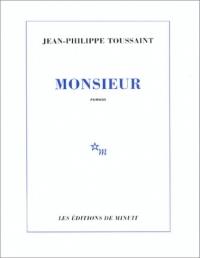
Cet opus, qui a été adapté à l’écran par Jean-Philippe Toussaint lui-même – il est assez rare qu’un écrivain se lance dans ce genre d’aventure en tant que réalisateur -, forme à mon sens une belle unité avec La salle de bain. Même caractère anonyme du personnage, réduit ici à son une partie infime de son état civil : « Monsieur », même absence d’horizon, même absurdité des situations,…
Le roman commence dans un bureau. Pardon : le bureau personnel de cet homme sans nom :
« Ensuite, méthodiquement, triant au fur et à mesure les vieux papiers, il commença d'entreposer sur le palier, derrière sa porte, des sacs en plastique remplis de vieux journaux, des piles entières de revues. »
Les personnages mis en scène par Jean-Philippe Toussaint ont un côté mécanique dans un monde absurde. Une pincée de Charlie Chaplin, une autre de Dario Fo, une dernière enfin de Samuel Becket.
Et dans cet environnement mécanique, modernisé, pas de place pour la réflexion. L’action, encore l’action, toujours l’action. Mais une action quotidiennement répétitive, banale dont il est difficile de s’échapper, ne serait-ce que mentalement. Tout recours à la culture par exemple semble sinon impossible, du moins superflu. Et quand Jean-Philippe Toussaint évoque le nom de Léonard de Vinci, c’est pour parler de la tour où travaille Monsieur.
Un travail dont on apprend tardivement la nature. Monsieur est directeur commercial chez Fiat. Et cette annonce tardive donne l’impression que tout cela est secondaire. A la rigueur, Monsieur pourrait bien faire autre chose, ce serait pareil. L’important est de remplir une tâche, d’occuper une fonction, un espace peut-être aussi.
Si la sphère professionnelle est aussi sclérosante, que reste-t-il alors pour la sphère privée ? Peu de chose à vrai dire. La fiancée de Monsieur le quitte pour un autre homme. Mais l’amant délaissé reste tout de même dans l’appartement, avec sa belle-famille. Absence d’horizon encore et toujours. Et pourtant, tout cela ne pousse pas au soulèvement. Monsieur n’est pas un révolutionnaire. Et s’il se rebelle c’est comme ça, à la cantonade, sans jamais viser qui que ce soit en particulier.
« Les gens tout de même. »
Heureusement qu’il y a le voisin de palier, Kaltz, géologue, attaché de recherches au CNRS qui, au bout de quelques minutes engage Monsieur; Il a besoin de lui pour la rédaction d'un traité de minéralogie. Monsieur devra copier les propos du maître, travail encore une fois mécanique :
« Monsieur ne savait rien refuser. »
Ce roman ainsi que le précédent m’ont parfois fait penser à L'homme dé de Luke Rheinhardt. Le personnage principal de ce roman ne veut plus rien décider de lui-même – si tant est que nous ayons vraiment un libre-arbitre -. Il laisse les dés déterminer à quoi va ressembler le restant de sa vie.
Ainsi va la vie de Monsieur au cours de laquelle nous rencontrons aussi Simone Dubois-Lacour qui l'aide à chercher un autre appartement, M. Leguen qui dit louer une chambre à un étudiant, ou encore un secrétaire d'état jouant au ping-pong dans une maison de campagne.
J'aime que Jean-Philippe Toussaint souligne la banalité du quotidien par de forts contrastes – l'auteur parlera plus tard de roman infinitésimaliste (infiniment grand et infiniment petit) -. L'un d'entre eux consiste à faire prononcer des phrases emberlificotées par des personnages fades, sans grande substance mais qui veulent paraître conséquents. L'effet comique n'est est que plus grand.
« A partir de ces quelques données fondamentales, il est maintenant nécessaire de revenir à la symétrie d'orientation du cristal qui, étant celle que l'on peut déduire à l'échelle de la maille, est également celle d'une figure formée par l'ensemble des demi-droites issues d'un même point arbitraire qui sont parallèles aux directions suivant lesquelles une propriété donnée du milieu est identique, ceci se vérifiant pour toutes les propriétés, la symétrie du milieu étant la symétrie commune à toutes les propriétés. »
Effet comique aussi lorsque Monsieur emménage chez les Leguen et fait réciter ses leçons au fils dont il quitte progressivement la chambre pour se retrouver dans la rue, face à un étudiant dépourvu de stylo qui pose des questions dans le cadre d'un travail universitaire.
Et l'amour dans tout ça, me direz-vous ? Il a pour nom Anna Bruckhardt – tiens, un nom complet, dans le bon ordre – et arrive en toute fin du roman. Comme si tout cela, encore une fois, n'était que secondaire.
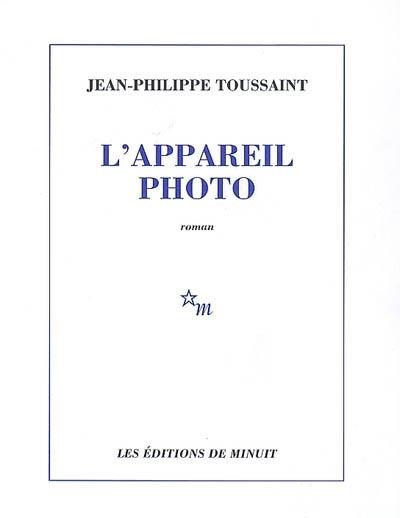
Ambiance moins « légère » ici dans ce roman où il me semble que les personnages se livrent davantage. En témoigne ce début :
« C'est à peu près à la même époque de ma vie, vie calme où d'ordinaire rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent deux événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt, et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux. Je venais en effet de prendre la décision d'apprendre à conduire, et j'avais à peine commencé de m'habituer à cette idée qu'une nouvelle me parvint par courrier : un ami perdu de vue, dans une lettre tapée à la machine, une assez vieille machine, me faisait part de son mariage. Or, s'il y a une chose dont j'ai horreur, personnellement, c'est bien les amis perdus de vue. »
Cette fille de l'auto-école s'appelle Pascale Palougaïevski. Ce nom, bien sûr, le lecteur ne l'apprendra bien plus tard – voir fin de la chronique précédente -. Car, comme souvent chez cet auteur, c'est le reste qui prime. Tout semble obéir à un ordre. Le narrateur a d'abord pour objectif de montrer à cette jeune femme des photos de lui, petit. Puis de prendre possession du lieu – l'auto-école -.
En prendre possession jusqu'à se rendre odieux avec un jeune homme, « vilain comme tout en plus, qui portait une manière d'imper vert et des chaussettes blanches dans des mocassins ». L'intrus veut apprendre à conduire. Il a beau justifier ses dix-huit ans. Qu'importe. « C'est fermé, dis-je. Mais je suis déjà venu hier ajouta-t-il, je voudrais juste déposer le dossier. Ne soyez pas buté, voyons, dis-je en baissant doucement les paupières. Je refermai la porte. »
Dans les dernières interviews – y compris celle qu'il m'a accordé -, Jean-Philippe Toussaint dit être en recherche de mouvement. Personnellement, je trouve qu'il y en a toujours eu. Ici, par exemple la relation entre le personnage principal va vite, peut-être même trop vite. La relation avec l'autre semble se consommer bien davantage qu'elle ne se savoure. Ainsi, le personnage principal ne semble connaître Pascale Palougaïevski que depuis quelque temps. Il va pourtant chercher son fils à l'école. Et que dire de cette scène mémorable. Nous ne sommes même pas au premier tiers du roman :
« Elle sortit, puis revint aussitôt, se penchant à ma vitre pour me demander de lui donner les clefs de l'école qui se trouvaient dans un sac à main. J'ouvris le sac sur mes genoux et commençai à chercher. C'est quoi ça, dis-je en sortant une grande enveloppe. Laissez, c'est rien, dit-elle, c'est un frottis. Un petit frottis, dis-je, tout attendri. Mais vous devriez le poster, voyons, dis-je, il faut le poster. Vous êtes gentil, dit-elle. Ah oui, oui, dis-je, ça se poste, un frottis. Et il est là-dedans, dis-je rêveur, en secouant l'enveloppe à côté de mon oreille. »
En fait, les personnages masculins chez Jean-Philippe Toussaint semblent obéir à une sorte de pulsion. Quelque chose se passe dans la tête et, nécessité faisant loi, il faut alors obéir à cette pulsion. Il s'agit de suivre la mouvement de la pensée : entreprise fatiguante, usante.
« La pensée, me semblait-il, est un flux auquel il est bon de foutre la paix pour qu'il puisse s'épanouir dans l'ignorance de son propre écoulement et continuer d'affleurer naturellement en d'innombrables et merveilleuses ramifications qui finissent par converger mystérieusement vers un point immobile et fuyant. Que l'on désire au passage, si cela nous chante, isoler une pensée, une seule, et, l'ayant considérée et retournée dans tous les sens pour la contempler, que l'envie nous prenne de la travailler dans son esprit comme de la pâte à modeler, pourquoi pas, mais vouloir ensuite essayer de la formuler est aussi décevant, in fine, que le résultat d'une précipitation, où, autant la floculation peut paraître miraculeuse, autant le précipité chimique semble pauvre et pitoyable, petit dépôt poudreux vers une lamelle d'expérimentation. Non, mieux vaut laisser la pensée vaquer en paix à ses sereines occupations et, faisant mine de s'en désintéresser, se laisser doucement bercer par son murmure pour tendre sans bruit vers la connaissance de ce qui est. Telle était en tout cas, pour l'heure, ma ligne de conduite. »
On notera au passage le double sens du mot conduite, en tant qu'actions de se conduire et d'être aux commandes d'un véhicule.
L'apprentissage de cette dernière technique devient un moment de bonheur sous la plume de Jean-Philippe Toussaint, en particulier lorsque le narrateur potasse dans ce « manuel coloré agrémenté d'un choix de photos à l'esthétique télévisuelle de comédie policière, où le coupable invisible, toujours le même, dont nous était offert sous différents cadrages l'inquiétant point de vue subjectif, se tenait au volant dans différentes agglomérations, au soleil ou sous la pluie, parfois sur des routes de campagne désertes, où quelque cyclomotoriste en K-way et casque rouge, le porte-bagages cerné de sacoches beiges, paraissait comme la victime désignée. »
Description drolatique encore accentuée quand on sait que, plus tard, le narrateur va boire des coups avec son moniteur Fulmar qui s'endormira ensuite durant les cours.
Je vous disais au début de la chronique consacrée à L'appareil-photo que ce roman introduisait une prise de conscience. La voici qui éclot un peu plus. Soudain, le narrateur réalise l'importance de lâcher prise. Et voilà que le rythme, tant recherché par l'auteur, s'apaise. Mais pour combien de temps ?
« Et tandis que je continuais de m'attarder dans cette cabine en suivant tranquillement le cours de mes pensées, je sentais confusément que la réalité à laquelle je me heurtais commençait peu à peu à manifester quelques signes de lassitude ; elle commençait à fatiguer et à mollir oui, et je ne doutais pas que mes assauts répétés, dans leur tranquille ténacité, finiraient peu à peu par épuiser la réalité, comme on peut épuiser une olive avec une fourchette, si vous voulez, en appuyant très légèrement de temps à autre, et que lorsque, exténuée, la réalité n'offrirait plus de résistance, je savais que plus rien ne pourrait alors arrêter mon élan, l'élan furieux que je savais en moi depuis toujours, fort de tous les accomplissements. »
La pause sera de courte durée. Si l'approche de Pascale Palougaïevski s'était faite à un train d'enfer, il en est de même lorsque ces deux là s'octroient une petite excursion. Le moteur s'emballe à nouveau :
« Nous n'avions passé qu'une nuit à Londres, en réalité, Pascale et moi, c'est le seul petit reproche que je ferais à l'Angleterre. »
C'est d'ailleurs au retour d'Angleterre par bateau – véhicule de la lenteur par excellence – qu'est trouvé un appareil-photo instamatic noir et blanc sur une banquette. Le narrateur prend des clichés avant de le jeter à l'eau après cette phrase : « Parfois, oui, la mort me manquait ».
« (...) si j'avais gardé l'appareil-photo, j'aurais pu prendre quelques photos du ciel à présent, cadrer de longs rectangles uniformément bleus, translucides et presque transparents, de cette transparence que j'avais tant recherchée quelques années plus tôt quand j'avais voulu essayer de faire une photo, une seule photo, quelque chose comme un portrait, un autoportrait peut-être, mais sans moi et sans personne, seulement une présence, entière et nue, douloureuse et simple, sans arrière-plan et presque sans lumière. »
L'appareil a peut-être été jeté dans la mer mais pas la pellicule. Le narrateur va la faire développer mais ne trouvera aucun cliché qu'il a réalisé.
Il me semble que l'appareil-photo peut être compris comme le symbole d'une découverte pour le narrateur : qu'il n'en peut plus de cette course effrénée vers le toujours plus.
« Je pensais, oui et, lorsque je pensais, les yeux fermés et le corps à l'abri, je simulais une autre vie, identique à la vie dans ses formes et son souffle, sa respiration et son rythme, une vie en tous points comparable à la vie, mais sans blessure imaginable, sans agression et sans douleur possible, lointaine, une vie détachée qui s'épanouissait dans les décombres exténués de la réalité extérieure, et où une réalité tout autre, intérieure et docile, prenait la mesure de la douceur de chaque instant qui passait, et ce n'était guère des mots qui me venaient alors, ni des images, peu de sons, si ce n'est le même murmure familier, mais des formes en mouvement qui suivaient leur cours dans mon esprit comme le mouvement même du temps, avec la même évidence infinie et sereine, formes tremblantes aux contours insaisissables que le laissais s'écouler en moi en silence dans le calme et la douceur d'un flux inutile et grandiose. »
Il s'agirait ici d'un retour au cogito cartésien : je pense donc je suis, je réfléchis à autre chose qui me rappelle ma condition de « vivant ». C'est d'ailleurs le dernier mot du livre.
Dans un entretien avec Laurent Demoulin, Jean-Philippe Toussaint dit qu'il n'y a « jamais un tel écart entre d'un côté l'aspect provocateur et je-m'en-foutiste du narrateur et, d'autre part les réflexions philosophiques. »
Plus loin :
« On passe progressivement de la difficulté de vivre au désespoir d'être. »
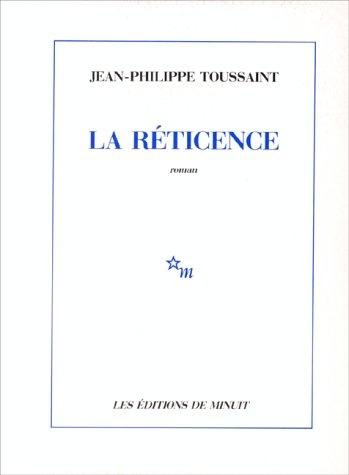
C'est sans nul doute le livre de Jean-Philippe Toussaint que je préfère. Et l'entendre dire que ce fut aussi le plus difficile, le plus douloureux, ne me surprend guère.
Jamais, avant La réticence, je n'avais lu un livre en ayant une mélodie dans la tête. J'associe clairement ce roman à une oeuvre de musique contemporaine répétitive mais avec, pourtant, une composante mélodique très forte.
Dans cet opus, il pourrait – le conditionnel sera ici de rigueur – s'agir, selon moi, d'une allusion constante au cycle des prédateurs comme je le lis déjà au début de l'histoire :
« Ce matin il y avait un chat mort dans le port, un chat noir qui flottait à la surface de l'eau, il était droit et raide, et il décrivait lentement le long d'une barque Hors de sa gueule pendait une tête de poisson décomposée de laquelle dépassait un fil de pêche cassé d'une longueur de trois ou quatre centimètres. Sur le moment, j'avais simplement imaginé que cette tête de poisson était ce qui restait d'un appât de ligne morte, le chat avait dû se pencher dans l'eau pour attraper le poisson, et, au moment de s'en saisir, l'hameçon accroché dans la gueule, il avait perdu l'équilibre et était tombé. »
Le narrateur débarque dans une localité corse, Sasuelo. Pas la peine de chercher, elle n'existe pas. Il vient ici avec son fils. Est-il vraiment venu voir la famille Biaggi ? Pas si sûr.
Le fils, le chat mort, les Biaggi : trois éléments qui reviennent sans cesse dans le roman. On pourrait presque dire : trois pièces d'un jeu d'échecs avec lequel le narrateur semble jouer contre lui-même. Car rien n'est sûr ici. On ne sait pas où est la réalité, le rêve, le fantasme. L'atmosphère est étouffante. Ce que le narrateur voit est potentiellement dangereux. L'extérieur n'est plus à prendre par-dessus la jambe. On ne le traverse plus, insouciant.
« La route, plus étroite à présent, continuait de descendre en lacets entre deux rangées de sous-bois touffus et mouillée de pluie, et je regardais distraitement par la vitre, apercevant parfois le profil familier de quelque champignon qui avait poussé en bordure d'un talus dans un nid putride de feuilles mortes, une jeune coulemelle peut-être, ou quelque amanite, qui disparaissait aussitôt de mon champ de vision et dont je gardais une image fugitive à l'esprit alors que le taxi s'était déjà éloigné de plus d'une centaine de mètres du champignon qui m'avait assez intrigué un instant. »
Intrigué aussi par cette impression constante d'être suivi. De se sentir épié quand il pénètre dans la demeure des Biaggi alors qu'il n'y a personne. Et d'ailleurs, qui est donc ce Corse ? Ça, évidemment, vous ne l'apprendrez pas.
Dans ce roman, Jean-Philippe Toussaint rapproche les éléments de sa trilogie et joue avec. C'est ce mélange, cette juxtaposition qui crée une histoire. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un exercice de gamme se transformant progressivement en concerto.
Mais le cadavre du chat, la mort de Biaggi, le fils en bas-âge ne parlent-ils pas, finalement, d'un changement de peau amorcé par Jean-Philippe Toussaint qui s'est amorcé dans le livre précédent ?
« Moi, cela faisait trente-trois ans maintenant que je ne me leurrais plus sur ma nature, car je venais d'avoir trente-trois ans oui, c'est l'âge où finit l'adolescence. »
Ce roman qui aurait tout aussi bien pu s'appeler « En attendant Biaggi » peut être aussi compris comme une métaphore sur le travail de l'écrivain sur le chemin duquel se dresseraient quantité d'obstacles. Une sorte de mise à l'épreuve, en somme, qui devient ainsi, un essai littéraire, un roman work-in-progress.
Un chef d'œuvre !

