
Ça commence par une belle image. Deux adultes, trois enfants. C'est l'été. Le premier jour des vacances. Tout ce joli monde roule en voiture, entre Toulouse et Bayonne. On croirait une famille unie. Les apparences sont parfois trompeuses. D'abord, il ne s'agit pas d'une seule et même tribu. Mais d'un ensemble qu'on qualifie parfois de recomposé. Comme si l'on pouvait reconstruire ce qui n'a jamais été fait.
Il fait beau donc, mais ce que nous voyons est-il la réalité ? Non. Et pour s'en convaincre, il faut écouter Linda, la narratrice, mère des petites Dorothée et Émilie quand elle parle de son compagnon, le père de Vincent, adolescent de quatorze ans.
Bien sûr, tout le monde semblait lésé, toi y compris qui me soupçonnait de privilégier mes filles.
Cette première faille dans le décor va en appeler d'autres. De nombreuses autres, créant une tension dans ce nouveau huis-clos. Tout se fissure, lentement, les masques vont progressivement tomber. Par petites touches. Comme si Brigitte Giraud se transformait ici en peintre impressionniste du quotidien. Ce qui aurait pu être une banale histoire de vacances devient un lieu d'affrontement où chacun semble poussé à fourbir ses armes :
Nos regards se sont croisés et j'ai décidé de ne plus avoir peur.
A quoi est-ce dû ? A la disparition des anciens conjoints ? Il n'importe pas ici de le savoir. Tout ce que l'on voit ce sont ces plaies toujours à vif. Il suffit d'un rien pour qu'une étincelle mette le fin au fragile édifice. Dans ce roman, l'auteure, comme d'habitude, ne juge pas. Elle montre. Elle décortique. La mort, la disparition ne sont pas vraiment digérées – mais cela est-il seulement possible ? -. On peut vivre avec cela. Tout seul. Ou accompagné. Mais dans ce cas-là, il y a un risque. C'est de cela dont il s'agit ici.
On s'épie, on se jauge. L'étincelle s'appelle Vincent. Il se dresse entre son père et sa belle-mère. Dans l'entre-deux tout le temps.
Un problème entre toi et moi
Dans la maison louée, il y a des essaims d'abeilles – elles piquent, comme certains humains – qui polluent encore l'atmosphère. Polluent oui. Comme ce pétrolier qui fait naufrage au loin. Les images se suivent, le couple prend l'eau de toute part. Jusqu'à l'épilogue que je ne raconterai pas ici.
C'est par des menus détails de la vie quotidienne que Brigitte Giraud parvient, encore une fois, à tenir les lecteurs en haleine. Exemple lorsque le compagnon de Linda – il n'est jamais nommé, comme si ce n'était pas la peine – va acheter des cigarettes alors qu'il a arrêté de fumer. Plus loin, ce sera au tour de Vincent d'arracher des mains de Linda une lettre qui lui est adressé sans que son père ne lui dise quoi que ce soit.
J'ai souligné, dans la chronique précédente que Brigitte Giraud n'est pas tendre avec ses narrateurs. Elle les rend aussi responsable de l'état de fait. Linda n'est donc sans doute pas pour rien dans l'échec du couple :
Tu ne voulais pas te laisser attraper et je n'avais de cesse de te capturer, te ligoter, te disséquer, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
On remarquera au passage deux termes très importants : disséquer et intérieur. Quand je vous dis que cette auteure a quelque chose de chirurgical.
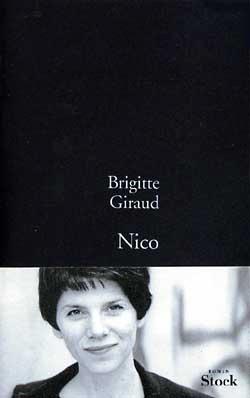
J'ai déjà relevé que la musique est toujours présente dans les romans de Brigitte Giraud. En voici une nouvelle preuve. Cet opus commence par un extrait d'une chanson de Dominique A., sur un père disparu.
Le père serait-il donc au centre de cette histoire ? Oui même si Nico fait référence au frère de la narratrice, Laura. Nico est un fugueur. Nico, ce garçon qui a fait pipi au lit jusqu’à dix ans. Nico, ce fils d’un père colérique, un père aujourd’hui disparu :
Mon père, j'ai du mal à en parler. Surtout depuis qu'il est chauve et aussi depuis qu'il est parti. Chauve, ce n'est pas grave, mais chez lui c'est une calvitie indécente, qui met à nu ce qu'il a de plus étriqué, le crâne.
Il est donc parti, le tyran. Et pourtant, Laura n’est pas soulagée. C’est peut-être parce que le venin de la violence a été inoculé à un membre de la famille. Nico ? Oui. Nico que l’on voit donc gangrené lui aussi par la violence. Comme lorsqu’il tue des petits chatons selon une méthode froide. Glaciale. Chirurgicale, on en revient toujours là.
Laura est témoin de cette évolution. Il n’y a pas qu’elle. Sa mère aussi assiste au « spectacle », à cette descente aux enfers. Mais peut-on compter sur elle ? A priori oui puisqu’elle est médecin. Qu’elle pourra peut-être aider à soigner cette maladie évolutive. Mais c’est faire fausse route tant cette mère semble ailleurs.
Ma mère nous regardait environ une heure par jour.
C’est un livre qui fait froid dans le dos. Il pourrait avoir pour sous-titre « Chroniques de la violence ordinaire » tant les scènes qui se déroulent dans ce nouvel espace clôt semblent être extraites d’un récit. Mais un récit remarquablement écrit.
On se prend soi-même à avoir des envies de règlements de compte, à voir ainsi cette caricature de père, ce vendeur de voitures japonaises qui fait preuve d’un sadisme renversant. Ainsi, quand il envoie son fils à la « niche », sous la table, en guise de punition. Ou quand, une fois parti du domicile conjugal, il renvoie à son fils ses lettres. Corrigées cette fois.
Triste tableau que cette maison où rien ne va plus. Qui semble vivre au rythme des fugues de Nico. Et cette mère incapable d'empêcher la dérive. Oui, on dirait du Ken Loach. Le stylo de Brigitte Giraud est bien plus que cela : une caméra qui englobe son, image, odeur. Un très grand tour de force, je trouve.
Malgré tout cela, la narratrice trouve encore la force de poser des questions, de faire fonctionner son cerveau.
La paternité telle que la pratiqua mon père, n'était-elle qu'une vaste entreprise de correction, une parole sans cesse coupée ?
Car il s’agit de privilégier l’esprit par rapport aux muscles. Laura poursuit sa vie, malgré tout cela. Elle entre en première année de médecine. Nico, lui, se fait exclure de l’école. Et voilà qu’il se radicalise, qu’il devient de plus en plus raciste. L’échec, semble nous dire l’auteure n'excuse pas, ne permet pas toutes les dérives.
Et puis tout va s’accélérer. La mère rencontre un nouvel homme. Il ne sait pas comment procéder avec Nico qui, lui, tombera toujours plus bas jusqu’à ce que…
Mais je vous laisse le soin de découvrir par vous-même.
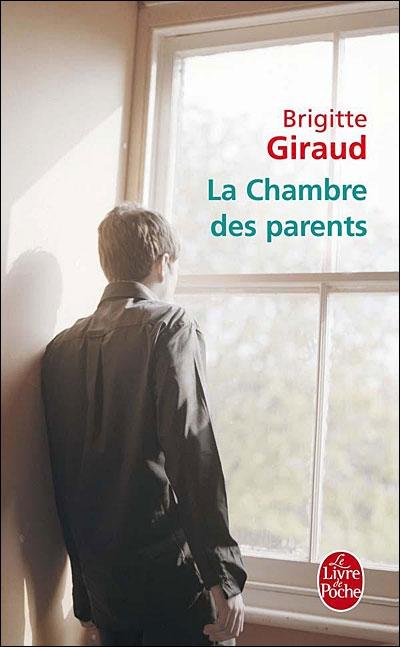
Je suis toujours stupéfait de la façon dont Brigitte Giraud campe le décor en deux temps trois mouvements et nous pose une problématique que le roman va ensuite chercher à développer. Je parlerais volontiers d’angle pour utiliser un vocabulaire journalistique.
Point de narratrice ici. Mais un narrateur qui envisage le retour dans sa maison d'enfance.
La seule chose que j'entendrai sera « normal » et me sautera à la gorge tout ce que signifie ce petit mot mal fichu (qui se termine tout de même par « mal »). J'avais eu envie de devenir quelqu'un de normal pendant douze ans. Et à présent que la voie est libre, j'avais compris que je n'étais capable de rien.
C’est de sa prison qu’écrit le narrateur. Encore un lieu étroit où il purge une peine pour l’assassinat de son père.
Je vais sortir bientôt. J'ai peur. Je savais que le moment venu serait une épreuve bien plus difficile que les douze années pendant lesquelles je n'ai pas lutté contre l'engourdissement. Je me suis laissé faire, à la taule, je me suis fondu dans le confort de la soumission, j'ai accepté d'être lâche.
Après avoir lu ce livre, je me suis demandé si l’auteure avait rencontré des prisonniers – j’ai oublié de lui poser la question dans l’interview qu’elle m’a accordé – tant la description qui est faite de cet univers me semble proche de ce qu’en disent les détenus dans des documentaires.
Je n'ai pas su grandir en prison. Je n'ai rien appris si ce n'est le dégoût des autres et de moi-même. J'ai regardé le corps des autres se balancer dans l'ouverture d'une porte d'avant en arrière, j'ai vu mon corps se balancer. Franchir une porte est une douleur parce qu'aucune raison ne pousse jamais à la franchir. Et tu fais comme si tu n'y pensais pas, tu prends un air détaché. Ici ou là est la même chose, le temps qui prend toute la place, qui t'écrase si fort que tu deviens le temps, tu le bouffes puis le digères ou bien tu suffoques, tu vomis. Tu succombes avec une pensée pour les torturés à qui le bourreau fait avaler des litres et des litres d'eau. Toi, tu bois du temps et tu es saoul. Rien n'existe autour, tu es le cratère sur la face sombre de la lune. Immobile. Tu ne vieillis pas en prison. Tu n'y demeures vraiment qu'un jour, le même jour, lisse et vide.
Le temps est propice au questionnement et au flash-back – les opposants à cet anglicisme préféreront sans doute le terme d’analepse -. Et dans ce film de la vie passée il y a un père à l'origine de ta vie et de ta perte. Il y a la violence. Il y a la banalité d’un quotidien dans un petit pavillon de banlieue tenu par des parents pieds-noirs.
Le narrateur passe tout cela en revue. D’abord de façon presque distante, je trouve. Jusqu’à ce que tout se recentre autour de la figure du patriarche dont on ne peut d’ailleurs s’échapper aussi facilement :
Pendant des années, je n'ai pu avoir une pensée pour mon père, il avait disparu le jour où je l'avais tué. Je pensais l'avoir enterré, l'avoir chassé de ma vie pour toujours. Mais il rôdait autour de moi. C'est en me rasant, un matin de la dixième année, que j'aperçus, dans le petit miroir au dessus du lavabo, une expression que je n'avais pas remarquée jusqu'alors sur mon visage. Juste avant d'appliquer la mousse à raser, je passai ma main sur la barbe poussée la nuit quand me vient la sensation oubliée de la barbe de trois jours de Papa ; je l'avais effleurée sans doute une ou deux fois seulement quand j'étais enfant. Je me dévorai des yeux et découvris deux rides en train de creuser mes joues. Je reconnus aussitôt ces rides. Je fermai les yeux mais c'était trop tard, mon père se tenait face à moi. Je cherchai à me dégager su piège où je me trouvais désormais enfermé. La prison sans l'image de mon père fut une épreuve supportable mais, à partir du moment où il décida de me rejoindre, je commençai à purger ma véritable peine.
J’avais déjà souligné ce courage des narrateurs à vouloir comprendre, à saisir le moment où tout bascule. C’est bien de courage en effet dont il s’agit car cette entreprise est faite par des gens qui n’ont pour toute perspective que leur petit monde, leur petite vie. Ne vous méprenez pas sur les termes employés ici. Il ne s’agit nullement de les ridiculiser. Bien au contraire.
Mon père se sentait dépassé, incapable. Pour ne pas à avoir essuyer nos réactions et à admettre son échec, il se tenait à distance. Il lui aurait fallu un brin de courage pour remonter la pente, si peu de chose. Nous ne lui aurions pas fait payer le prix de son absence, pas exprès en tout cas. Nous aurions quand même bien aimé faire la bagarre avec lui ou grimper sur son dos. Mais il n'a pas pu rassembler cette dose d'énergie, à cause de l'alcool peut-être, à cause de son incapacité à admettre qu'il avait une vie entre les mains et qu'il avait le pouvoir d'en faire quelque chose. Nous nous sommes tournés vers notre mère, sans oublier qu'il existait. Nous allions d'ailleurs bientôt vérifier que son existence avait plus de poids que nous le croyions.
Plus loin :
Papa buvait en silence. Il travaillait parfois, rarement plus de quinze jours, ramenait un peu d'argent. Maman savait qu'il ne fallait rien lui dire, ne pas se plaindre et prendre l'argent. Il n'avait jamais été capable d'ouvrir un compte à la banque. Il avait peut d'avoir à se justifier face à des hommes en costume forcément plus importants que lui. Il ne voulait pas se mesurer aux autres, à ceux qui ne lui ressemblaient pas. Les seuls hommes qu'il fréquentait étaient ceux des chantiers, des hommes bronzés aux larges épaules qui parlent peu et se contentent d'un rien. Il n'avait rien à leur prouver. Je ne comprenais pas comment mon père pouvait rester des jours entiers à ne rien faire. Il souffrait se nous savoir près de lui, à quelques mètres, mais si loin déjà, inaccessibles. Nous nous gênions les uns les autres et avions appris à devenir silencieux. Nous cultivions l'art de nous éviter. Nous glissions comme des ombres, tout était affaire de trajectoire.
Et dans ce petit monde, les cafés ont pour nom « Au Tout Va Bien » qui a des chaises de métal rouge en terrasse et « Au Tout Va Mieux » avec des tables et des chaises de métal jaune installées à même la rue.
Il y a dans les livres de Brigitte Giraud beaucoup d’élégance dans ce désespoir. Quelque chose qui fait que les personnages restent debout. Ils ont de la rectitude morale.
Je mesure à quel point je suis loin de la plupart de ces hommes qui déploient un degré d'acharnement hors du commun.
Je ne saurai conclure sans mentionner l’importance de deux autres personnages : Mario et surtout Marianne. On notera la presque homophonie de ces deux prénoms. Comme si, dans ce décor tout, décidemment, se ressemblait.
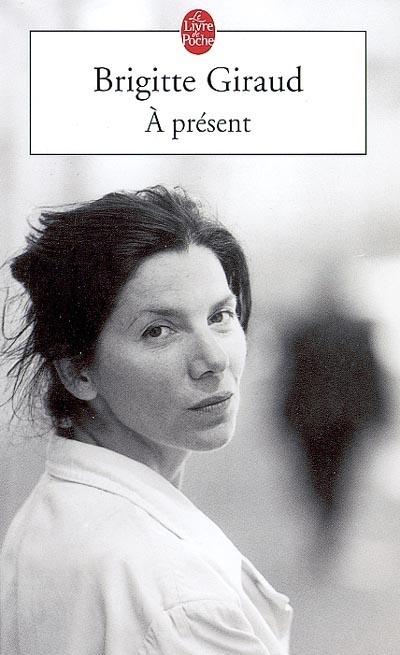
En lisant ce roman de Brigitte Giraud j'ai repensé au célèbre poème de W.H Auden :
Arrêtez toutes les pendules, coupez le téléphone
Donnez un os au chien pour l'empêcher d'aboyer
Faites taire les pianos et dans un roulement assourdi
Sortez le cercueil et que les pleureuses pleurent
Que les avions qui tournent en gémissant
Dessinent sur le ciel ce message : Il Est Mort
Nouez du crêpe au cou blanc des pigeons,
Gantez de coton noir les agents de police
Il était mon Nord, mon Sud, mon Est et Ouest
Ma semaine de travail, mon repos du dimanche,
Mon midi, mon minuit, ma parole, mon chant ;
Je pensais que l'amour durerait toujours : j'avais tort
N'importe les étoiles à présent : éteignez les toutes ;
Emballez la lune et démontez le soleil
Videz l'océan et balayez la forêt
Car rien de bon désormais ne peut plus advenir
Vous l'aurez compris, il est question de mort dans ce livre. Ce roman s'ouvre d'ailleurs là-dessus :
Ce soir, Claude est mort. Je l’aimais. Ma vie s’arrête et commence en même temps. Pour éviter de nommer l’événement, je dis avant et à présent… avant, comme il s’agissait d’un pays, vaste territoire luxuriant, mon continent. Avant, bien sûr, c’était blanc, lumineux, léger, évident. Avant, c’était lisse, excitant parfois, nous étions immortels et cyniques. Nous étions vivants. La mort des autres ne nous bouleversait pas, nous employions des verbes comme clamser, nous étions des héros. Nous étions spirituels et énervés. Nous avions le sens du détail, nous étions souvent insatisfaits, impatients. Nous exigions de la vie qu’elle soit parfaite. Nous avions nos critères, en toute innocence. Nous mettions en scène notre arrogance ordinaire. Nous organisions nos drames quotidiens, nous faisions des reproches à l’autre quand il n’avait pas pris le pain. C’était avant, c’était ailleurs. C’était nous.
Je pense qu'on ne peut pas mesurer la force de cet opus si l'on n'a pas, soi-même, été confronté à un décès. Un monde disparaît emportant ainsi une partie de soi-même. C'est donc tout naturellement que l'on se retrouve confronté, indirectement, à notre propre fin.
Cet enchaînement est déboussolant et plonge, encore une fois, dans un stade intermédiaire qui n'est plus la vie habituelle, telle que nous la connaissions jusqu'alors. Dans ce nouvel espace-temps, plus rien ne ressemble à ce que nous voyions encore la veille. Pour pouvoir entrer complètement dans cette zone de l'entre-deux, il faut voir la mort en face et la verbaliser.
A la maison, tout le monde débarque. Mes parents, mon frère, les amis déjà avertis. Le téléphone sonne sans arrêt. Je répète des dizaines de fois la même chose. J’ai besoin de dire et de dire encore qu’il est mort, c’est moi qui demande aux amis d’appeler, je fais passer le message, appelez, n’importe quand, appelez-moi. Je mâche et remâche sa mort, comme pour m’en convaincre et plus je répète, plus je m’éloigne, je suis déjà loin, ailleurs, ce n’est plus moi, c’est une autre qui prend la relève, moi j’ai disparu en même temps que lui.
Dans ce livre, Brigitte Giraud tape en plein dans le mille. Elle excelle, je trouve, dans la description de la dépossession. La mort de Claude, dans un accident de moto, oblige la narratrice à naviguer à vue. Ainsi quand elle doit annoncer la nouvelle à T., son petit.
Mais dans cette dépossession, paradoxalement, il y a du mouvement. La crainte qu'a la narratrice, c'est celle du rien :
Tout sauf le vide.
Plus loin :
(…) vous ne voyez pas une raison de vous lever le matin. Vous vous levez quand même, vous enchaînez les minutes, votre seule ambition es d’arriver au matin. Vous n’êtes plus qu’une unité de temps, obnubilée par l’action.
Mais il ne faut pas que cette action soit incontrôlée. Même si les raisons de la laisser s'exprimer, sans frein, est tentante. Surtout quand la narratrice se heurte à des semblables qui veulent « récupérer » cette mort, confisquer les derniers instants où défunt et proche sont encore réunis.
Il y a ici des pages merveilleuses qui disent avec quelle horreur l'organiste, insupportable, fait tout pour ne pas jouer Les sept dernières paroles du Christ de Haydn, lors des obsèques. Mais il y a aussi des lignes d'une infinie beauté sur les porches, toujours présents, là et bien là. Qui ne cherchent rien, qui ne commentent pas. Qui sont dans l'ombre. Toujours ce souci chez l'auteure de ne pas déranger.
Pas de lyrisme, pas de sentimentalisme sirupeux. Brigitte Giraud parle cru, brut. Ça frappe, ça cogne mais sans aucune brutalité. Elle n'est pas dans le jeu. Elle n'est pas dans l'excès. Mais combien de temps passe-t-elle donc à façonner les mots pour que rien ne dépasse ? Pour qu'aucune fioriture ne mette en branle l'édifice aussi savamment construit ?
Je m’enivre de chaque mot, confusément, tente d’en percer le sens caché. Je m’arrime à la chair des mots, m’y accroche comme à un radeau. Je les remâche, les essore, les maltraite, les accuse. Je les déforme, les confonds, les sanctifie quand ils parlent d’amour, les méprise quand ils ne sont que des signes désincarnés. Ils sont tout ce qui me reste, une tempête de mots déposés chaque jour dans la boîte aux lettres, qui me donnent de ses nouvelles, me confient ce que j’ignore parfois, les moments partagés, les sentiments demeurés enfouis, les souvenirs oubliés.
La référence en début de chronique à W. H Auden n'est pas fortuite. Ici, Brigitte Giraud s'inscrit dans cette lignée naturaliste. Un naturalisme tellement poussé qu'on serait tenté de le classer dans le genre des récits de vie. Il ne m'appartient pas de savoir si tel ou tel ouvrage est une biographie ou une autobiographie. Respectons cette zone grise. De toute façon c'est avant tout une magnifique œuvre littéraire qui se savoure. Et nous, lecteurs, nous dégustons aussi, dans tous les sens du terme. Comme quoi l'échange fonctionne ici à merveille.
Brigitte Giraud, c'est donc la vie.

