 De tous les auteurs espagnols apparus ces quinze dernières années, Germán Sierra a sans aucun doute le profil le plus interpellant. Né à La Corogne en 1960, auteur de quatre romans (nous avions évoqué son dernier l'an passé) et d'un recueil de nouvelles, Sierra est un spécialiste du cerveau qui donne des cours de biochimie et dirige des recherches sur l'épilepsie à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Observateur éclairé des nouvelles technologies, il a écrit de nombreux articles [1] à propos de leur l'impact sur le monde du livre ainsi que de leurs liens avec la culture en générale ("tout culture est technologie", dit-il). C'est pour ces trois casquettes (écrivain de fiction, critique culturel et scientifique) que nous avons décidé de le soumettre à la question. La deuxième partie de cet entretien suivra jeudi.
De tous les auteurs espagnols apparus ces quinze dernières années, Germán Sierra a sans aucun doute le profil le plus interpellant. Né à La Corogne en 1960, auteur de quatre romans (nous avions évoqué son dernier l'an passé) et d'un recueil de nouvelles, Sierra est un spécialiste du cerveau qui donne des cours de biochimie et dirige des recherches sur l'épilepsie à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Observateur éclairé des nouvelles technologies, il a écrit de nombreux articles [1] à propos de leur l'impact sur le monde du livre ainsi que de leurs liens avec la culture en générale ("tout culture est technologie", dit-il). C'est pour ces trois casquettes (écrivain de fiction, critique culturel et scientifique) que nous avons décidé de le soumettre à la question. La deuxième partie de cet entretien suivra jeudi.
 El espacio aparamente perdido (1996), ton premier livre, est considéré comme un roman important mais il est totalement épuisé. On dit aussi qu'y apparaissent déjà les grands thèmes de ton travail. Presque 15 ans plus tard, quel regard jettes-tu dessus ?
Ça fait longtemps que je n'ai pas relu El espacio… Je ne reviens presque jamais à ce que j'ai déjà publié, en partie parce que je pense y trouver beaucoup de chose que je voudrais réécrire… D'après ce que me disent certains lecteurs qui le lisent pour la première fois, bien souvent après avoir lu mes autres livres, je crois qu'il continue à conserver une certaine fraîcheur. El espacio… a été publié à un moment littéraire très différent de l'actuel, et il est possible qu'il y ait des références que les lecteurs plus jeunes interprètent mieux.
El espacio aparamente perdido (1996), ton premier livre, est considéré comme un roman important mais il est totalement épuisé. On dit aussi qu'y apparaissent déjà les grands thèmes de ton travail. Presque 15 ans plus tard, quel regard jettes-tu dessus ?
Ça fait longtemps que je n'ai pas relu El espacio… Je ne reviens presque jamais à ce que j'ai déjà publié, en partie parce que je pense y trouver beaucoup de chose que je voudrais réécrire… D'après ce que me disent certains lecteurs qui le lisent pour la première fois, bien souvent après avoir lu mes autres livres, je crois qu'il continue à conserver une certaine fraîcheur. El espacio… a été publié à un moment littéraire très différent de l'actuel, et il est possible qu'il y ait des références que les lecteurs plus jeunes interprètent mieux.J'ai commencé à écrire ce roman vers 1993, à peine revenu d'un séjour de plus de trois ans à L.A. dans le cadre d'une bourse postdoctorale. Au cours des années antérieures, et surtout pendant ma période étasunienne, j'avais pris énormément de notes (ce n'était pas un journal, mais plutôt une façon de réfléchir à toute une série de choses qui m'intéressaient, qu'il s'agisse des relations personnelles, d'idées scientifiques ou des livres que je lisais), de sorte qu'à mon retour en Espagne, je disposais d'un matériel très ample sur lequel travailler, et j'ai voulu en faire un roman. Une de mes intentions était de raconter les changements qui se produisaient vers la fin du XXe siècle, et donc les thèmes que j'ai développés dans mes livres postérieurs pointent déjà le bout de leur nez : l'importance de la science et de la technologie dans la perception du monde, l'utilisation de métaphores scientifiques, le dialogue avec la philosophie contemporaine, ou encore le rôle des nouveaux moyens de communication.
Un autre aspect important de El espacio…, qui est aussi présent dans mon travail postérieur, c'est la présence des villes presque en tant que personnages du récit qui, d'une certaine façon, déterminent la structure narrative du livre.
L'écriture de ce premier roman (ou, en tout cas, du matériel qui en était à la base) coïncide aussi avec ma découverte d'une série de nouveaux auteurs nord-américains (Acker, Vollmann, Wallace ou DeLillo par exemple) qui, sans aucun doute, ont eu une influence définitive sur sa conception ainsi que sur ce que j'ai écrit ensuite. Tu dis que le “moment littéraire” n'était pas le même. De fait, à l'époque, de ceux qu'on a appelé les mutants, seuls Ferré et Javier Fernández publient (et de manière confidentielle, en plus). Quel était le contexte de l'époque ? En fait, j'ai toujours gardé mes distances avec le monde littéraire, et, à la publication de El espacio…, j'en étais encore plus éloigné. Peu de choses de ce qui se publiait alors m'intéressaient (Ríos, Goytisolo et le Cela des années 70 et 80 me semblaient nettement plus intéressants que la majorité des auteurs de mon âge). Je ne connaissais ni Ferré ni Javier Fernández, mais parmi les auteurs qui commencèrent à publier en même temps que moi, je lisais avec intérêt Josan Hatero, Antonio Orejudo ou Luis Magrinyá. Quelques écrivains plus jeunes que moi (Mañas ou Loriga, par exemple) étaient assez populaires et représentaient les tendances « branchées » et « pop » de la littérature espagnole. Cette littérature pop du début des années 90, en large mesure héritière de la movida des années 80 et du dirty realism américain, m'intéressait nettement moins que le postmodernisme ou l'avant-pop, bien plus expérimentaux et complexes, mais à l'époque, ces écrivains était très peu connus par ici. Les choses n'ont commencé à changer qu'à la fin des années 90, lorsque des gens très jeunes, comme Eloy Fernández Porta ou Javier Calvo, se sont mis à publier des articles sur David Foster Wallace ou Mark Amerika. On a dit que certains écrivains espagnol, et singulièrement les « mutants », n'apprécient pas assez leur propre histoire littéraire et qu'il se cache, derrière votre cosmopolitisme, une acceptation de la culture imposée par la « Nation-Empire » — les Yankees, pour utiliser un vocable de la gauche espagnole. Je n'ai jamais cru en l'idée de traditions littéraires nationales ni aux mythes progressistes nationaux. Parmi la majorité des écrivains et des gens du monde littéraire, on continue à considérer que des opinions comme les miennes sont des aberrations, et je leur donne toujours l'exemple de la science : ça fait un siècle qu'il est absurde de parler de « biochimie nationale ».
L'idée de nation-empire est une bêtise. Il y a une culture globale qui, effectivement, se fait de manière prédominante en anglais et qui, effectivement, utilise beaucoup de références nord-américaines, mais elle est de moins en moins faite par des nord-américains et de plus en plus par des Indiens, des Brésiliens, des Japonais et des Chinois. Le problème de l'Espagne, c'est qu'elle n'apporte presque rien à cette culture globale, ce qui la rend de plus en plus insignifiante. Une des choses qu'on ne nous pardonne pas, aux « mutants », c'est que nous écrivons ici des romans qu'on aurait pu écrire n'importe où ailleurs.
Moi, je ne vis plus dans ce pays. J'adore le mot « délocalisation ». Je crois que les référents territoriaux ont disparu il y a un bout de temps. Je lis plus de presse en anglais qu'en espagnol, mes travaux de recherche sont publiés dans des revues étrangères, j'achète tout (sauf la nourriture) sur des pages web étrangères, je suis en contact permanent avec des amis du monde entier par email, je regarde des séries TV et des films étrangers, etc. Je prends connaissance immédiatement de ce qui se passe dans les domaines qui m'intéressent à Tokyo, Moscou ou Buenos Aires alors qu'il me faut des semaines pour apprendre ce qui se passe dans ma ville, si je l'apprends un jour. C'est comme ça que je vis, ça m'est naturel.
Néanmoins, on ne peut m'accuser, ni moi ni les « mutants », de cosmoplouquisme. Au contraire, je crois que peu de gens ont fait autant d'efforts à partir de soutiens si faibles pour défendre la culture espagnole contemporaine (seule celle qui mérite d'être défendue bien sûr, sans jamais utiliser un critère national absurde…)
Enfin, la littérature nord-américaine de la seconde moitié du XXe siècle m'intéresse pour les mêmes raisons que l'européenne de la première moitié (bien sûr, c'est une généralisation très exagérée, et il y a beaucoup d'auteurs européens récents qui m'intéressent autant voire plus que beaucoup de nord-américains) : elle a été la plus profonde, la plus créative, la plus risquée de son époque. Précisément parce qu'elle a cessé d'être locale et provinciale et qu'elle a assumé les grands défis artistiques et intellectuels de son temps. Ce sont ceux qui ont raconté ce qui se passait quand ça se passait, parce que le monde dans lequel nous vivons s'est transformé en ces réseaux délocalisés que les progressistes voient comme un empire. Parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Parce qu'il est incontrôlable. Parce qu'il est devenu évident qu'il s'agit d'un système complexe qui s'auto-organise. L'empire de la science, la technologie, la médecine, l'image, les arts contemporains, les voyages dans l'espace, Internet, les marchés globaux avec leurs zones d'ombre mais aussi leurs zones de lumière. Ce sont des auteurs qui n'ont rien refusé, qui sont allés au cœur des choses afin de signaler ce qu'il y a de fascinant, de terrible et de comique dans notre monde. Exactement ce qu'ont fait à leur époque les grands auteurs que nous respectons aujourd'hui, des gens comme Rabelais, Cervantès, Sterne, Swift, Dostoïevski, Kafka… Et ça, c'est nettement plus classe que s'asseoir à la terrasse d'un café et se vanter d'être progressiste. Tu parles de contrôle, et j'ai l'impression que dans tes romans, il y a beaucoup de gens qui veulent tout contrôler ou qui le désirent. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce thème ?
Tu as tout à fait raison : le thème du contrôle (ou peut-être plutôt l'illusion du contrôle ou la fiction du contrôle) est une des constantes de mon œuvre. D'une certaine façon, c'est une conséquence d'une autre de mes plus grandes préoccupations philosophiques : la construction de causalités. La fiction du contrôle vient de la fiction de la causalité, parce que nous croyons en des relations univoques cause – effet, ce qui nous fait penser que nous pouvons contrôler tous les effets en modifiant toutes les causes. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie (par exemple, en médecine et santé, ça crée d'authentiques mythologies sanitaires qui survivent des décennies à leur falsification scientifique) et ça a été renforcé par certains succès technologiques, mais ça vient de croyances profondément enracinées qui sont à l'origine de la civilisation occidentale ; du platonisme, de l'aristotélisme, et de la façon dont Platon, Aristote et leurs épigones ont été interprétés par la culture chrétienne d'abord et les philosophes idéalistes ensuite.
Une bonne part des mythologies contemporaines sont dues aux contradictions qui surgissent de notre désir de contrôle (contrôler notre vie, notre image, notre temps, notre apparence, etc.) et de notre peur d'être contrôlés (par l'Etat, les corporations, la science, la publicité, la famille, par nos propres limitations physiques en tant qu'êtres humains). Mes livres tentent d'explorer et de fictionnaliser ces mythologies, à tel point que l'un des axes de Intente usar otras palabras est l'hybridation de ces deux tendances dans ce que le livre dénomme la « panoptophilie » ou le désir d'être continuellement observé.
Un autre aspect qui se répète dans mes romans (c'est un des thèmes récurrents de la fiction contemporaine), et qui est directement lié au précédent, c'est celui des attentes qui ne se réalisent pas (je suis moins intéressé par l'idée du « loser » social que par l'idée de l'échec individuel) : le personnage commence à pressentir que la vie ne peut pas être comprise comme une promesse (ou une « dette », un autre concept qui semble tout envahir actuellement), mais bien comme un processus. Narrativement, je m'intéresse à l'instant où une personne devient consciente de ce qu'elle ne peut contrôler et commence à délimiter un domaine d'action, laissant d'autres choses au hasard. En ce sens, les personnages de Efecto Secundario ou de Intente usar otras palabras apparaissent au moment de choisir quel va être leur domaine de contrôle (par exemple, la possibilité de réécrire sa vie).
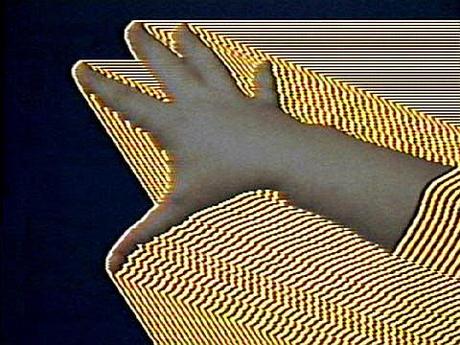
Il y a dans tes livres des écrivains, mais tu n'utilise pas vraiment le thème classique de l'écrivain en train d'écrire ; tu semble lui préférer des figures d'écrivains dans le monde de la culture. On sait que le pouvoir se sert de la culture à des fins politiques (contrôle encore et toujours), mais je crois que tu diriges aussi notre attention vers la culture en tant que pouvoir en soi. D'ailleurs, tu n'écris pas d'articles de critique littéraire, mais bien de critique culturelle, voire, pour être plus spécifique, de culture liée à la technologie. Je ne veux pas refléter l'image de l'écrivain romantique et isolé n'ayant rien avoir ni avec la réalité, ni avec la fiction que je veux composer. J'imagine que de par ma formation et mon travail, je n'ai jamais vu la littérature comme indépendante et autonome. Dans l'Espagne d'il y a quelques années, ça choquait. De nos jours, ça devrait bien moins nous surprendre, puisque la littérature apparait fréquemment hybridée avec d'autres médias et d'autres arts, mais ça continue à attirer l'attention parce que la formation universitaire espagnole est très peu multidisciplinaire et les critiques littéraires sortent des facs convaincus que la littérature est un monde à part, qui peut traiter de sujets technologiques ou visuels mais qui ne doit pas se laisser contaminer par ceux-ci. Puisque je crois qu'elle ne peut qu'être contaminée par la science, la technologie, les autres arts ou le marché, je me sens incapable d'écrire un livre sans explorer tout ces autres aspects qui, de mon point de vue, en font partie. En ce qui concerne les articles que j'écris pour Quimera, mon intention est de parler spécifiquement de littérature et de technologie. Mais même quand je me rapproche le plus de la critique littéraire je finis par parler de la façon dont le livre s'inscrit dans un contexte plus large.
À cause de mon héritage postmoderne, je vois toujours la culture comme une machine de guerre, comme une stratégie de pouvoir. Nous participons tous en plus ou moins large mesure à ces stratégies de pouvoir, que ça nous plaise ou non. Je m'intéresse aux œuvres d'art qui examinent les contradictions que cela suppose, et ça se reflète dans tous mes articles et mes livres. L'économie actuelle (et la politique n'est rien d'autre qu'une partie, toujours plus petite, de l'économie) se base sur la culture, il est presque impossible d'échanger quelque chose qui ne soit pas associé à un style de vie construit culturellement. Une entreprise actuelle produit surtout des clients (ou une audience), et tout ça se fait à travers d'une infiltration culturelle. Ce n'est ni bien ni mal en soi, c'est la façon dont les choses fonctionnent, et ça a des avantages énormes qui valent la peine d'être soulignés ainsi que des inconvénients considérables qu'il est bon de mettre au jour. L'ignorer ne donne pas lieu à un art plus « pur », mais bien à des formes basiques de divertissement qui sont très respectables mais qui, personnellement, m'intéressent très peu.
Quelque chose de semblable se passe avec la technologie. Pour d'absurdes raisons académiques, il y en a qui pensent que la culture et la technologie sont des choses différentes. Naturellement, toute technologie est culture, et toute culture est technologie. Une culture « non technologique » n'a jamais existé, pas plus qu'une technologie « non culturelle ». Si toute culture est technologique, quelle est la technologie du roman aujourd'hui, ou que devrait-elle être à ton avis ?
Les arts (et les sciences) sont des interprétations technologiques de la connaissance (puisque la connaissance est un processus ; quelque chose qui se fait, qui n'est pas déjà là ou qui s'inscrit dans le cerveau de façon passive). Ce qui a permis l'évolution de la culture, c'est précisément la capacité de transmettre une information biologique (en forme de gènes ou de réseaux neuronaux) vers des supports non biologiques (dessins, inscriptions, mots…) permettant sa transmission dans l'espace et le temps. En ce sens donc, toute culture est technologique et toute technologie est culturelle.
Quand on parle des arts en général, il existe des technologies de production et des technologies de diffusion (bien qu'on tende à prêter plus d'attention à ces dernières). Traditionnellement, on pourrait considérer comme technologies littéraires de production toutes celles qui permettent la genèse de textes (ce n'est pas la même chose de réciter, écrire au stylo, à la machine ou à l'ordinateur), et technologies de diffusion celles qui permettent de transmettre des textes (papyrus, livres, internet…). Tant les technologies de production que celles de diffusion utilisées par différents arts et sciences se sont hybridées entre elles au long de l'histoire, et il est difficile de parler de technologies propres ou exclusives à la littérature, tout comme il est difficile de réduire la littérature au textuel exclusivement.
Même si nous parlons spécifiquement du roman, le champ ne se réduit pas beaucoup car le roman a absorbé des formes et des modèles de presque toutes les autres interprétations technologiques de la connaissance, et donc il est impossible de définir une technologie spécifique au roman contemporain.
Par contre (et à ce sujet, je suis d'accord avec Katherine Hayles), les romans les plus intéressants d'une époque sont souvent ceux qui remettent en question (ou explorent les limites) des technologies avec lesquelles elles ont été produites ou transmises. D'un point de vue narratif, les œuvres essentielles sont celles qui questionnent la façon dont une narration se construit à un moment historique déterminé (Cervantés le fait d'une façon magistrale, ou Proust qui explore et dissèque avec succès la technologie discursive construite à travers l'interprétations des souvenirs personnels, ou Joyce qui pousse à ses limites la technologie du monologue intérieur – une façon de comprendre le moi en dissolution de Nietzsche et Freud – développée précédemment par Dostoïevski et les Suédois, ou Danielewski appliquant au format livre imprimé la technologie digitale / visuelle…). Mais ça ne signifie pas que pour écrire un grand roman contemporain il faille se concentrer exclusivement sur des technologies récentes. Un romancier d'aujourd'hui peut faire appel à Gongora et tenter de développer des aspects du “comment raconter” qui furent abandonnés au XVIIe siècle et dont presque personne ne s'est occupé à ce jour…
En plus des questions littéraires techniques et formelles, il y a la question de « comment raconter une société très technicisée ». C'est peut-être un aspect secondaire auquel on donne souvent trop d'importance (un roman n'est pas plus contemporain parce qu'il parle d'Internet ou d'êtres humains clonés, ou parce que l'auteur a un blog), mais on ne peut pas l'ignorer complètement car un roman n'est jamais ce que l'auteur voudrait qu'il soit : c'est aussi le résultat qu'il produit sur les lecteurs. Si l'auteur prétend simplement divertir, le fait que la réalité représentée dans le roman soit très simplifiée importe peu. Mais je pense qu'une œuvre d'art doit aussi essayer d'explorer les aspects les plus cachés, évanescents, contradictoires et conflictuels de la réalité. A cause du grand développement technologique récent, beaucoup de ces aspects ne sont pas tant liés aux technologies en elles-mêmes qu'à la façon dont elles sont utilisées, comprises (ou mal interprétées), acceptées ou rejetées, surtout par les non spécialistes. Comme je te le disais plus tôt, la majeure partie des mythologies contemporaines surgissent d'une mauvaise interprétation de la science et des processus technologiques, et je m'intéresse aux romans qui explorent à fond ces thèmes, parce qu'ils affectent tous les aspects de la vie (bizarrement, les grands sujets qui préoccupent les écrivains plus traditionnels ou métaphysiques – l'amour, le mal, la mort – sont aujourd'hui complètement liés au jour le jour avec des connaissances et des technologies très spécialisées).

Chaque fois qu'on parle d'innovation, on est pratiquement certain qu'on va te parler d'un Grec de l'Antiquité qui a tout dit. Eloy Fernández Porta parlait en novembre dernier à Madrid d'un roman dont le texte est une conversation, un chat online entre deux amants homosexuels. Les fans du Grec parleront d'une version Choderlos de Laclos pour petits branchés qui se croient malins, mais Eloy semblait considérer que les circonstances changent tout. De fait, ne pas les considérer, c'est tout réduire aux traits communs pour ignorer ce qu'il y a de neuf, ce qui change par exemple à un niveau de représentation. Peut-on vraiment parler de l'Amour, du Mal, de la Mort comme quelque chose qui ne change pas ? C'est une question compliquée, mais comment définir une littérature innovante à un gars qui te parle de Grecs très sages et très barbus ? De fait, il s'agit d'une question très compliquée. Certains critiques, lorsqu'ils parlent d'innovation littéraire, me font penser à cette anecdote que Freud utilise pour expliquer comment fonctionne l'inconscient : un homme demande à son voisin de lui prêter un seau, et quelques jours plus tard, il le lui rend troué. Quand le voisin vient se plaindre, l'homme lui répond que le seau n'est pas troué, qu'il était déjà troué quand il lui a prêté et qu'en plus il ne lui a jamais demandé de lui prêter un seau. Ainsi, le raisonnement de certains critiques est souvent que, même si la littérature ne doit pas être innovante, le livre X n'innove pas parce qu'on avait déjà fait avant ce que l'auteur a fait ici.
Eloy a raison. Bien sûr, il est toujours possible de localiser des antécédents historiques à tout recours artistique ainsi qu'à toute méthodologie scientifique, mais ça n'affecte en rien sa contemporanéité. Les circonstances changent, ce qui affecte autant ce qui se raconte que la façon de le raconter. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens capables de disséquer historiquement une technologie moléculaire, par exemple, qu'une technique artistique, et ça produit l'impression erronée que la science change tout d'un coup alors que la littérature n'est que répétition.
Je trouve que le terme « innovateur » est souvent mal compris (je préfère « expérimental », mais on ne le comprend pas mieux) parce qu'il est confondu avec l'avant-gardisme de l'époque moderne, et on imagine que seul est innovateur ce qui n'a jamais été fait avant. C'est une conception de l'innovation qui ne s'applique pas à d'autres formes de création, mais c'est vrai que c'est un des aspects les plus visibles de l'avant-gardisme moderne. Pourtant, ça fait plus de cinquante ans que l'innovation, c'est plus que ça. Il ne s'agit pas de toujours faire ce qui n'a jamais été fait, mais bien d'expérimenter à l'aide de tous les ressources à notre portée, et d'offrir des formes et des idées qui modifient notre idée de la réalité (si on se débarrasse de la distorsion induite par l'identification de l'innovation artistique avec les avant-gardes modernes, je crois que n'importe quel Grec barbu le comprendra, car il existe une tradition de littérature « innovante » depuis les Grecs).
Je pense que l'innovation n'est pas une qualité mais plutôt un dialogue en cours avec les œuvres du passé et les circonstances du présent (Ron Sukenick, dont je partage largement l'idée qu'il se faisait de la littérature innovatrice, parle d'une « tradition rivale » qui remonte aux discussions de Socrate – le grand mainstream – avec les Sophistes, et il soutient que cette tradition a survécu tout au long de l'histoire de l'art). Il y a eu un moment historique, la modernité, au cours duquel ce dialogue s'est développé surtout en adoptant dans l'art des formes et des techniques qui, jusque là, n'avaient pas été considérées artistiques, mais aujourd'hui, c'est déjà une manœuvre traditionnelle, une parmi d'autres. Les arts plastiques ou la musique ont assimilé ce fait sans aucun problème (c'est peut-être pour ça que, comme le dit Eloy Fernández Porta, il y a plus d'artistes plastiques qui citent ses livres que d'écrivains), et à n'importe quelle foire artistique, dans n'importe quel musée d'art moderne, on peut voir un portrait réaliste, une pièce conceptuelle et une vidéo dans la même salle sans que cela semble étrange à personne.
Les critiques littéraires et les critiques artistiques ont une vision historique des avant-gardes complètement différentes. Pour la majorité des critiques littéraires, quelque œuvre ou mouvement avant-gardiste que ce soit, de quelque époque que ce soit, est un évènement fermé, qui se complète lui-même (peu importe qu'il s'agisse du cultéranisme [2] du XVIIe ou du dadaïsme du début du XXe) et qu'il ne vaut pratiquement jamais la peine de reprendre dans une optique créative. Par contre, pour les critiques d'art, les avant-gardes se transforment en nouveaux chemins sur lesquels circuler et qui peuvent être encore parcourus à des époques postérieures. Je suppose que le public auquel s'adressent ces œuvres et les critiques ont beaucoup d'influence là-dessus : en général, les critiques d'art écrivent pour une élite « in the know », souvent assez snob, qui apprécie beaucoup la nouveauté et l'extravagant, alors que les critiques littéraires (et la plupart des écrivains) le font pour une audience bien plus conservatrice (une public très large et hétéroclite dans le cas de la presse, ou le monde académique dans le cas des revues universitaires). C'est pour ça que, par un simple processus de sélection naturelle, les critiques d'art les plus appréciés sont ceux qui font le plus ressortir l'innovation – les « découvreurs » – alors que les critiques littéraires les plus prestigieux sont les plus « canoniques » (le modèle Harold Bloom). Tout ça a un sens commercial évident : pour un artiste plastique, il suffit de convaincre une demi-douzaine de riches collectionneurs afin de rentabiliser son travail à vie, alors qu'un romancier devrait convaincre des millions de lecteurs pour gagner autant d'argent. Je suis peut-être un peu cynique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de critiques qui défendent la littérature innovatrice (ou qui font ressortir ce qu'il y a d'innovation dans une certaine littérature) parce qu'ils sont convaincus que parler de ça n'est pas rentable pour leur carrière. (à suivre)
[1] nous en avions publié un il y a quelques temps.
[2] Style littéraire baroque espagnol, surchargé de métaphores et de structures complexes.
