 L’ignorance pratique, volontaire ou non, des cultures s’inscrit comme une spécificité assez française qu’illustre autant le monde des affaires que la sphère intellectuelle. Etant conduit à enseigner le management interculturel, je mesure chaque année combien mes étudiants (de niveau Master ou MBA) se passionnent pour ce domaine qu’ils n’avaient, pour la plupart, jamais abordé auparavant dans leur cursus. Etant aussi conduit à conseiller des entreprises dans leurs démarches internationales, j’observe combien il est difficile de convaincre les décideurs de l’importance de maîtriser la culture de leurs partenaires étrangers pour négocier ou collaborer plus efficacement avec eux. Le vieux mythe ethnocentrique, que l’on pourrait résumer à « les affaires se traitent de la même manière partout » reste profondément ancré dans les esprits, autant que le sont les préjugés et les stéréotypes. Voilà pourquoi il résulte des statistiques que 60% des échecs internationaux (commerciaux, fusions-acquisitions, etc.) restent dus à des incompréhensions et malentendus interculturels. Les piètres performances de notre commerce extérieur trouvent là, qu’on le veuille ou non, une partie de leur origine.
L’ignorance pratique, volontaire ou non, des cultures s’inscrit comme une spécificité assez française qu’illustre autant le monde des affaires que la sphère intellectuelle. Etant conduit à enseigner le management interculturel, je mesure chaque année combien mes étudiants (de niveau Master ou MBA) se passionnent pour ce domaine qu’ils n’avaient, pour la plupart, jamais abordé auparavant dans leur cursus. Etant aussi conduit à conseiller des entreprises dans leurs démarches internationales, j’observe combien il est difficile de convaincre les décideurs de l’importance de maîtriser la culture de leurs partenaires étrangers pour négocier ou collaborer plus efficacement avec eux. Le vieux mythe ethnocentrique, que l’on pourrait résumer à « les affaires se traitent de la même manière partout » reste profondément ancré dans les esprits, autant que le sont les préjugés et les stéréotypes. Voilà pourquoi il résulte des statistiques que 60% des échecs internationaux (commerciaux, fusions-acquisitions, etc.) restent dus à des incompréhensions et malentendus interculturels. Les piètres performances de notre commerce extérieur trouvent là, qu’on le veuille ou non, une partie de leur origine.
S’agissant de la sphère intellectuelle et du pouvoir politique, la situation se révèle plus inquiétante encore. Car la conscience de ce que représentent les cultures existe, mais tout est délibérément mis en œuvre pour nier l’influence que celles-ci exercent sur les individus. Par un aveuglement tenace, on se trompe d’argument en laissant croire que « tous les hommes sont pareils » au lieu d’affirmer tout simplement qu’ils sont égaux. Nuance capitale ! Le principe d’égalité ne saurait être discuté ; en revanche, la réalité nous confronte à des groupes humains dont les valeurs, les comportements et la vision du monde diffèrent en raison, précisément, de leurs cultures d’origine.
Les motivations de ce déni sont, naturellement, politiques. Schématiquement, pour la gauche, il s’agit de ne pas stigmatiser telle ou telle communauté, quitte à inventer un monde digne des Bisounours et pour la droite, de préserver à tout prix l’ordre social. Ces deux attitudes s’opposent cependant à toute logique, surtout lorsque les uns et les autres exhortent à la tolérance. Car prôner la tolérance tout en niant les cultures est un non-sens : tolérer les comportements et les pratiques de « l’autre » implique que ceux-ci diffèrent de ceux du groupe dominant ; or, cette différence ne saurait trouver de justification que culturelle ou socioculturelle.
Par ailleurs, croire que la mise en lumière des cultures reviendrait à encourager les préjugés racistes de l’extrême droite est une erreur. Ce qui fait le lit de l’extrême droite, c’est le déni par certaines élites du réel vécu par le citoyen lambda au quotidien. C’est la peur plus ou moins inconsciente de l’altérité en tant que différence constatée, mais inexpliquée. Avec, en perspective, la crainte de conflits de cultures qui, s’ils venaient à éclater, feraient le jeu de ceux qui en agitent l’épouvantail. En d’autres termes, tolérer pour tolérer n’est pas une fin en soi que l’on pourrait imposer au nom d’un humanisme qui dépasse souvent ceux auxquels ce message s’adresse ; pour tolérer l’effet (un comportement), il faut d’abord en comprendre la cause (un système de valeurs culturel).
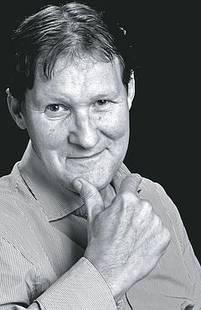
Enfin, l’auteur pense que le comportement des jeunes délinquants n’est pas dû à un manque d’autorité parental, mais à un excès d’autoritarisme allié à une disqualification des femmes (les mères étant souvent bien plus jeunes que les pères et reléguées à un rang « inférieur ») dans des familles polygames ou à large fratrie – un schéma typique des cultures patriarcales, hypertrophié par un exil dont les mauvaises conditions sont mal vécues. Par son approche scientifique rigoureuse, Hugues Lagrange examine en détail la situation des banlieues, le statut des femmes, les chiffres de la réussite scolaire, la tentation intégriste, le chômage, la démographie, l’exacerbation de la tradition, la quête d’identité et la précarité. Il se livre en outre à une intéressante mise en perspective avec des pays gérant, comme la France, de forts flux migratoires et propose des éléments de réponse pour sortir de l’impasse.
Hugues Lagrange n’a rien d’un provocateur, pas plus que d’un idéologue d’extrême droite que l’on pourrait soupçonner de racisme ; ses propos sont tranchés, mais présentés avec beaucoup de nuances, une rigueur et une honnêteté intellectuelle sans faille. Cependant, l’ouvrage par lequel il enfreint le tabou culturel lui vaut d’être le centre d’une vive polémique. Les bonnes âmes ne lui pardonnent pas de mettre à jour leur soumission au culte du politiquement correct – et rien n’est plus féroce qu’un bien-pensant contrarié… Chacun rivalise donc de mises en cause gratuites, quant à sa méthode, la grille de lecture de ses travaux ; on traque les éventuelles contradictions de l’auteur quitte à se référer à ses ouvrages les plus anciens et, naturellement, on l’accuse d’avoir créé un argumentaire pour nourrir les thèses de l’extrême droite. Bref, faute de se situer sur le terrain du débat, on tente de le décrédibiliser.

Le débat qui pourrait s’ouvrir autour d’un tel thème serait à l’évidence bien plus enrichissant que toutes les attaques gratuites dont Hugues Lagrange a, jusqu’à présent, été victime.
Illustrations : Hugues Lagrange - Banlieue (photos D.R.).

