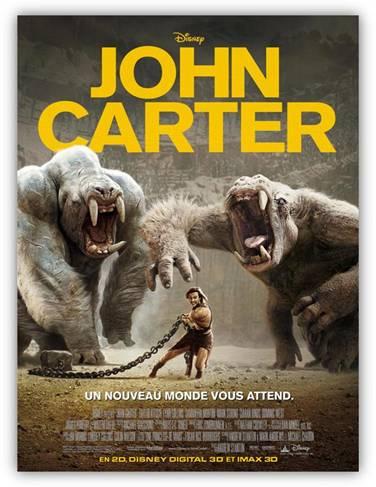
John Carter était un fantasme. Œuvre littéraire monstre, référence première pour des films aussi ambitieux que le Avatar de James Cameron, la saga d’Edgar Rice Burroughs fut longtemps une chimère. Nombre de grands réalisateurs (John McTiernan par exemple) et d’acteurs célèbres (Tom Cruise pour ne citer que lui) s’étaient cassé les dents sur le projet. Alors quand Disney décidait de confier le bébé à Andrew Stanton, les adorateurs des romans ne pouvaient qu’exulter.
Le coup de studio est simple. Donner les clés du camion à Andrew Stanton est dans la logique du récent Mission Impossible : Protocole fantôme. Il fallait du sang neuf pour sortir des projets grippés du marasme. Tom Cruise avait désigné Brad Bird pour diriger MI 4. Comme ce dernier, Andrew Stanton sort du film d’animation (Wall-E). Le choix de ces deux réalisateurs a un dénominateur commun. Les décideurs voulaient des dynamiteurs de formes qui soient surtout capable de transcender un matériau galvaudé. Si Brad Bird avait brillamment réussi son coup, Andrew Stanton a pêché. Il avait pourtant les pleins pouvoirs mais le projet était trop lourd pour lui. La première faute lui échappe et en revient au genre de l’heroic fantasy. Il est dur de passer derrière les maîtres étalons tels que Peter Jackson (la trilogie du Seigneur des Anneaux) et James Cameron (Avatar, donc). Andrew Stanton, s’il a du talent, n’est pas non plus un génie comme ces deux cinéastes. Pourtant, John Carter peut être passionnant dans le mélange de mise en scène. C’est sa plus belle qualité. La première partie, réaliste, joue sur les codes du western et du film d’époque. A ce titre, la production design est parfaite et les décors et costumes rendent un bel hommage. Ces partis pris donnent au film un aspect mélancolique au projet. Surtout, ils collent parfaitement avec la destinée du héros en perpétuelle logique de rachat constant. Le réalisateur, qui fait ses premières armes dans la prise de vue réelle, s’en sort donc bien. Lorsque John Carter arrive sur Mars, le film change de rapport à l’image. Le spectateur entre dans les effets spéciaux, dans l’image numérique, dans la caméra assistée à l’ordinateur. A ce petit jeu, Andrew Stanton sait y faire. Certains plans sont de toute beauté quand des mouvements impressionnent par leur ampleur. S’il ne faut pas faire la fine bouche devant le spectaculaire, on peut néanmoins émettre quelques regrets. Certaines envolées ne sont pas toujours très lisibles et cette mise en scène ne permet pas de rentrer parfaitement dans les conditions des personnages. A vouloir en mettre plein la vue, l’intime est parfois sacrifié. Néanmoins, il faut féliciter Andrew Stanton de provoquer le choc des cultures cinématographiques donnant à John Carter un aspect prototype, hybride et moderne.
Hélas, si le film peut donner de l’intérêt dans la forme, le fond ne suit pas forcément. La saga d’Edgar Rice Burroughs proposait pourtant des enjeux intéressants. Le problème est que le cinéaste, qui a aussi co-écrit le scénario, cède à la facilité en restant dans une pure logique d’amusement et en survolant des problématiques adultes. Le film, en effet, aurait gagné à toucher des interprétations à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le film souffre de faiblesses d’écriture qui mettent en exergue les raccourcis scénaristiques. Ainsi, des scènes arrivent comme un cheveu sur la soupe de manière bien trop évidente quand d’autres n’expliquent pas assez les situations. Pire, elles convoquent un certain sens de la naïveté qui laisse clairement sur sa faim. Le métrage entre dans cette même problématique le traitement des variables politiques. Cela aurait pu être, pourtant, passionnant, surtout que sont abordés des enjeux intéressants. Des jeux de pouvoir, des querelles de familles haut placées, des placements stratégiques de personnes pantins et plus généralement la soumission d’une civilisation par une autre sont au cœur du récit. En évoquant plus qu’en plongeant, Andrew Stanton manque sa cible réflexive. Tout cela est bien dommage car John Carter arrive à rendre quelques éléments justes. On peut penser surtout au degré d’empathie qu’il propose dans la relation entre un père (Tars Tarkas) et sa fille (Sola) ou dans la logique de rédemption du héros. Ancien capitaine Sudiste durant la Guerre de Sécession, il sait qu’il a perdu plus qu’un combat durant son passé militaire. En s’engageant et en livrant bataille, il a laissé une famille à l’abandon. Cet acte aura des conséquences terribles car John Carter vivra avec ces regrets. Son aventure sur Mars pourra lui permettre de réparer ses erreurs. Le spectateur comprend alors sa lutte que le réalisateur arrivera surtout à matérialiser au cours d’une superbe scène de combat en montage parallèle entre actions présentes et remords passés. Ce ne sont cependant que les deux points essentiels, les autres personnages étant relégués à l’arrière-plan alors qu’ils ont, eux aussi, des choses à dire. Cela est bien dommage car la distribution est convaincante et propose des têtes qu’il est bon de retrouver. Si elles sont quasi inconnues au cinéma, elles feront le bonheur des amateurs de série puisque l’on retrouve Taylor Kitsch (Friday Night Lights) et Dominic West (The Wire) dans les rôles importants.
John Carter est un film purement bancal. Proposant des choses intéressantes et d’autres plutôt moins réussies, il est constamment entre deux chaises. Surtout, malgré un budget conséquent, les pleins pouvoirs du réalisateur et une démarche sincère, le film se dirige vers un échec public. De bancal, John Carter passe au statut de maudit. La saga littéraire en appelait une cinématographique. Le spectateur aurait pu saisir toute la complexité de l’œuvre et le réalisateur gommer les erreurs du premier opus. Elle ne verra, peut-être, jamais le jour.

