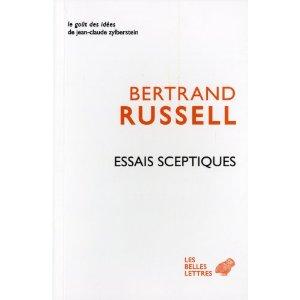 Après la conquête du
bonheur, beaucoup apprécié, j'ai lu les Essais sceptiques. J'en ai tout récemment déjà utilisé quelques citations que j'avais envie de mettre en avant ou d'utiliser, sans pour autant alourdir
la note ci-dessous.
Après la conquête du
bonheur, beaucoup apprécié, j'ai lu les Essais sceptiques. J'en ai tout récemment déjà utilisé quelques citations que j'avais envie de mettre en avant ou d'utiliser, sans pour autant alourdir
la note ci-dessous.
Russell est extrêmement cutivé et fin. Pour réussir à rendre compte de sa pensée, trois lectures successives n'y suffiraient pas. J'ai donc ci-dessous, comme dans d'autres notes de lecture, adopté un format un peu scolaire, qui commente chapitre après chapitre.
Il reste que la pensée de Russell mérite un petit commentaire introductif.
Ce qui apparaît, tout au long de la lecture de ce livre et de celui précédemment commenté, c'est un personnage entier, cultivé, subtil et cohérent, à la fois théoricien et conservant un esprit pratique.
J'ai beaucoup apprécié nombre de ses idées ou intuitions, sur le caractère néfaste de la bien-pensance , le rôle de la science et de la raison, limité mais essentiel, sur l'éducation ou d'autres thèmes comme celui du caractère massif de la propagande dans les sociétés occidentales.
Raison de plus pour regretter quelques points moins enthousiasmants.
Je passe sur l'eugénisme évoqué en fin d'ouvrage, c'est une passion de l'époque antérieure à la seconde guerre mondiale (les Essais ont été publiés en 1928), qui a aussi, je crois, captivé Keynes.
J'ai beaucoup plus de mal avec les considérations sur l'instauration d'une sorte de gouvernement mondial. Précisément, si je souscris bien volontiers à la nécessité d'internationaliser certaines question précises (sur le mode qu'invoque Russell en son chapitre IX), j'ai plus de mal avec l'autorité mondiale évoquée au chapitre XVII.
Pour deux raisons, l'une de fond, l'autre de forme.
Raison de fond : comme Russell semble le croire au chapitre IX, la concentration de pouvoirs généraux dans les mains d'une autorité mondiale créerait un monstre technocratique et un pouvoir sinon absolu du moins difficile à contrôler. Raison de forme : Russell a l'air de légitimer la construction non démocratique d'un tel gouvernement mondial, avec un raisonnement qui ressemble fort à une forme de ruse de la raison hégelienne. Un cartel financier, ou un état superpuissant, créerait un gouvernement mondial en croyant suivre son intérêt, mais ouvrirait ce faisant les conditions d'une démocratisation ultérieure.
Ce type d'argument, de la part de Russell le rationaliste qui rejette Hegel, me semble incongru. Il faut reconnaître à Russell qu'il modère rapidement son propos, n'écartant pas l'idée qu'un pouvoir mondial global parvienne à rester non démocratique, mais aussi qu'un pouvoir mondial puisse se scléroser.
Dans tous les cas, ce livre est un stimulant puissant pour la réflexion et reste lisible et pertinent près d'un siècle après sa parution. Il donne envie de suivre les idées ultérieures de Russell, qui a été longtemps pacifiste même en face de Hitler, et qui, fort probablement, à beaucoup affimer sur des sujets divers, a pu se tromper lourdement sur de nombreux thèmes. Reste la vertu du débat et le plaisir d'une pensée attentive à la complexité des situations.
Bonne lecture.
I - Introduction : de la valeur du scepticisme
Russell plaide là pour le rationalisme, la discussion étant le seul moyen d'établir des consensus partiels sur des sujets pratiques. Sachant que, pour lui, il est extrêmement rare de pouvoir aboutir à un résultat certain.
De façon générale, Russell estime que le nationalisme et les passions négatives priment bien trop souvent sur l'amour du prochain et les passions positives.
II - Rêves et faits
Précisant son propos introductif, il avance que les rivalités entre nations détournent de l'avancement du progrés scientifique seule occupation, en réalité, louable. Prendre aux autres est trop souvent jugé plus facile que d'apprendre à obtenir plus de la nature.
III - La science est-elle superstitieuse ?
De Whitehead, il tire l'idée que la tragédie grecque permet la science : pas de respect pour les régularités des lois de la nature sans une crainte préalable de l'implacabilité du destin. Pourtant, il estime que Hume a ravalé la science au rang de croyance - l'idée que le monde obéit à des lois reste à prouver.
Par ailleurs, même en oubliant ce premier point, Russell prête à la science un double visage : en positif, elle permet d'obtenir des résultats, en négatif, elle ravale l'homme au rang d'objet calculable.
De ces trois premiers chapitres, on peut conclure que si seule la science vaut, sa valeur est bien faible.
IV - L'homme peut-il être raisonnable ?
Pour diverses raisons, il peut l'être et doit l'être. Russell valorise par exemple la psychanalyse ; qui libère, selon lui, de croyances fausses, d'idées inadéquates qui obèrent le jugement (plus tard, il reconnaît qu'elle est balbutiante : "la psychanalyse orthodoxe a simplifié à l'excès nos buts inconscients qui sont nombreux et qui différent d'une personne à l'autre").
Selon Russell, l'égoïsme éclairé, qui tient compte des intérêts de l'individu mais aussi de la communauté, est un idéal pratique viable : "bien que je ne prétende pas que l'égoïsme éclairé soit la morale la plus haute, j'affirme que s'il devenait commun, il rendrait le monde meilleur qu'il n'est".
Les contempteurs de Russell auront beau jeu de déplorer cet appel à l'égoïsme. Ils auraient tort de minimiser l'aspect "éclairé" qui va avec. Le chapitre se termine ainsi : "C'est à l'intelligence, de plus en plus répandue, que nous devons nous adresser pour trouver la solution des maux dont notre monde souffre".
Je suis très partisan de ce rationalisme. C'est d'ailleurs ce qui m'a fâché avec Mélenchon. Il a fait appel, à partir de son discours de Marseille par exemple, à l'enthousiasme, au goût de la gagne de ses partisans. Dans le même temps, lui qui a joué un rôle important d'élucidation des questions économiques, se plongeant dans les questions monétaires et financières, a raconté n'importe quoi sur l'euro ("nécessaire à la création d'un smic européen").
Retour à Russell.
V - La philosophie au XXème siècle
Russell s'attaque à Bergson, dont la théorie de "l'intuition" nie la raison. Même rejet du pragmatisme, qui, avec des arguments différents de Bergson, aboutit à rejeter l'importance du raisonnement à partir de faits admis comme vrais. Les pragmatiques remplacent le critère du vrai par l'utile. Russell tient, lui, que la philosophie doit se rapprocher des mathématiques et, en tout cas, ne doit pas considérer qu'elle échappe aux exigences de la logique (chapitre assez technique). A mon sens, il ne faut pas estimer que nul ne peut rien affirmer s'il n'est géomètre, selon Russell. Simplement qu'il n'est pas souhaitable de s'exprimer contre la raison et la logique.
VI - La machine et les sentiments
Russell est bien conscient des conséquences possibles du rationalisme : l'ennui.
Il reconnaît à la théorie de "l'élan vital" de Bergson une capacité à justifier l'action propice à tirer l'homme moderne de l'assoupissement. Russell estime que la première guerre mondiale est intégralement due à la réticence de l'homme de la rue à vivre une vie d'ouvrier d'usine.
Cela amène Russell à des conclusions telles que : "beaucoup d'hommes cesseraient de désirer la guerre s'ils avaient l'opportunité de risquer leur vie dans l'alpinisme".
De nos jours on dirait que les islamistes seraient moins agressifs s'ils bénéficiaient des 35 heures et d'un accès à la contraception dès 16 ans. Pas faux. Mais que faudra-t-il pour calmer les intégristes protestants américains, qui ont déjà beaucoup ? La sécurité sociale universelle ou d'autres apports du progrès, ils le rejettent...
Russell en appelle à un progrès des connaissances sur la nature humaine afin que la science apporte "dans nos vies un bonheur que les machines et les sciences physiques n'ont pas réussi à créer".
VII - Le behaviourisme et les valeurs
Russell bataille là avec les behaviouristes (Watson), soupçonnés de ne croire en rien, c'est à dire de rejeter la contemplation et les valeurs esthétiques, auxquelles Russell est attaché.
L'argumentation de détail importe peu, tant le behaviourisme ne semble pas une menace actuelle. Ce qui est plus intéressant peut-être, est que Russell semble établir que l'on ne peut fonder une éthique sur une métaphysique. Même, toute métaphysique qui prétendrait fonder une éthique se détruirait selon lui ("une métaphysique ne peut jamais avoir de conséquence éthique qu'en vertu de sa fausseté"). Je n'ai pas compris en réalité l'argument, exposé sous forme fulgurante, j'en retiens une preuve supplémentaire de son scepticisme absolu.
Autre point intéressant, une métaphysique peut être fausse mais utile. Russell rejette ainsi l'éthique du behaviourisme watsonien (juger un homme à ses revenus par exemple), mais note que les préceptes éducatifs de Watson sont par exemple très justes - ils ont une efficacité pratique en raison de la justesse des conceptions éducatives de Watson.
Russell conclut de ce paragraphe qu'il importe de cultiver la logique pour apprendre à ne pas fonder les jugements utiles, que l'on peut avoir acquis comme bagage culturel par diverses voies, sur une métaphysique erronée.
VIII - Idéals du bonheur en orient et en occident
Russell présente le confucianisme chinois comme un exemple de doctrine pratique ayant été appliquée avec succès. Pour lui le confucianisme s'apparente à l'idéal du gentleman : équilibre, dignité, pondération caractérisent l'attitude correcte.
Il oppose cette doctrine au christianisme qui, presque officiellement, entretient deux niveaux de discours : un idéal théorique, que l'on hésite assez peu à caractériser comme irréaliste (que l'on juge par l'utilisation très libre qui est faite de l'impératif "tu ne tueras point" par de très nombreux chrétiens), et une attitude courante qui relève de la morale.
Pour Russell, la philosophie chinoise traditionnelle est plus pacifique. Elle érige en vertus la pondération, le fait de savoir jouir de choses simples - le thé, la peinture, la connaissance. L'occidental est préoccupé, lui, de son pouvoir. Il s'occupe à combattre le pêché, pour assurer sa rédemption, là où le chinois naît innocent et ne doit se soucier que d'être prévenant avec ses proches - sans besoin aucun de convertir à sa conception du bien le reste de la planète.
"il n'y a qu'un seul défaut sérieux, et rien qu'un seul, dans le système chinois : c'est qu'il ne rend pas la Chine capable de résister aux nations plus batailleuses. Si le monde entier était comme la Chine, le monde entier pourrait être heureux ; mais tant que les autres sont énergiques et amoureux de la guerre, les Chinois, maintenant qu'ils ne sont plus isolés, seront obligés d'imiter nos vices jusqu'à un certain point, s'ils veulent conserver leur indépendance nationale."
Interessante remarque, encore en 2012.
IX - Le mal que font les hommes de bien
Eloge de bentham, dont la morale, minimaliste ("il définissait un homme de bien comme un homme qui faisait du bien"), eut un effet positif indéniable en inspirant nombre de lois sociales victoriennes. Russell moque les bien-pensants et souligne que la bien-pensance est l'ennemie d'une pensée intéressante - Spinoza, Descartes furent des réprouvés écrit-il.
La conception religieuse de la vertu consiste plutôt à s'abstenir de pêcher, pas à faire le bien. Elle repose sur la notion irrationnelle de tabou (il cite Frazer). Pour lui la morale est positive, pas répressive (cf. cette citation).
X - La recrudescence du puritanisme
Techniquement, les bien-pensants sont des puritains. C'est à dire que l'importance d'un pêché doit, selon eux, se juger indépendamment des conséquences de l'acte - cf. la définition de Russell. Si les Puritains, historiquement, ont porté la démocratie, ils ont exercé un pouvoir excessif au Royaume-Uni, puis, chassés, ont conquis les Etats-Unis en restant puritains, jusqu'à la prohibition de l'alcool mentionnée par Russell.
Pour Russell, les puritains s'empoisonnent la vie et celle de leurs congénères à coups d'interdictions, si bien qu'il ne leur reste, comme dérivatif, que le goût du pouvoir pour le pouvoir, qui est bien plus nuisible que la vertu d'abstention : "Nous devons apprendre à respecter la vie privée de chacun et à ne pas nous imposer nos idéals moraux l'un à l'autre. Le Puritain s'imagine que son idéal moral est l'idéal moral ; il ne se rend pas compte que d'autres époques et d'autres pays et même d'autres groupes dans son propre pays ont des idéals moraux différents du sien"... Je ne sais pas si Russell appliquerait cette maxime au cas de la Syrie par exemple, en tout cas, formulée telle quelle, elle incite à le penser.
XI - Le besoin de scepticisme en politique
Arguments techniques pour distinguer d'abord l'expert et le politique. Ensuite, plaidoyer pour un socialisme concret. Marx, selon Russell, crée les conditions d'un conflit de classes tout autant qu'il le décrit.
Russell préfère le socialisme pratique théorisé par Salter à partir de l'exéprience de l'Allied Shipping Control (contrôle de la production par la France et le Royaume-Uni lors de la première guerre mondiale).
Pour Russell, Salter tire la conclusion du Shipping control que "l'internationalisme efficace devra organiser séparément chaque fonction et non se borner à créer un organisme international suprême pour accorder les exigences des organismes purement nationaux en conflit les uns avec les autres".
Ce passage est fondamental aujourd'hui.
Salter était l'alter ego, pour la partie britannique, de... Jean Monnet. On peut donc voir dans l'allied shipping une préfiguration de la méthode Monnet, qui consiste à faire échapper au dialogue international classique des thématiques conflictuelles.
Dans ses Mémoires, Monnet explique ainsi comment il fit échapper aux querelles entre états la question des achats de blé au coeur de la première guerre (cf. ma note de lecture des Mémoires).
Je souligne, dans mon commentaire des Mémoires, à quel point Monnet se trompe en considérant que la souveraineté nationale est l'obstacle principal à une solution des problèmes.
On voit bien, avec l'impasse européenne, qu'au mieux l'Union européenne ne sera qu'un état supplémentaire sur l'échiquier mondial, tout aussi égoïste qu'un autre. Alors qu'une réflexion active sur l'efficacité des grandes agences internationales serait probablement plus intéressante et novatrice.
Russell voit mieux le point : un organisme international suprême (qui est la solution Monnet pour régler le problème des égoïsmes européens) ne sert qu'à fixer un cadre plus grand à des conflits qui demeurent. Russell, suivant Salter, esquisse une solution qui réside plutôt dans l'internationalisation séparée de différentes thématiques (sur un modèle qui voit cohabiter des organisations internationales thématiques : FAO, OMS, OIT...) : "je crois, par exemple, que la Finance internationale et le Travail international, s'ils pouvaient triompher de leur méfiance mutuelle, pourraient actuellement se mettre d'accord sur un programme que les parlements nationaux mettraient plusieurs années à réaliser".
C'est cette forme d'internationalisme qui représente, pour Russell, la voie du progrès.
XII - Pensée libre et propagande officielle
Conférence dans laquelle Russell plaide pour une liberté totale des consciences en dehors du travail : nul ne peut être empêché de travailler pour ses opinions. Ce point l'amène à rejeter le socialisme soviétique, qui empêche les bons patrons de travailler.
Autres considération sur un paradoxe : c'est l'intelligence qui amène au progrès sinon moral, du moins des moeurs. Mais le problème que voit bien Russell est aussi que l'éducation des masses est un moyen, pour l'Etat, de véhiculer une propagande également de masse.
XIII - La liberté et la société
Russell refuse la liberté telle que définie par Hegel, qui repose dans le fait de participer à la réalisation de la "loi morale". Il adopte une définition plus libérale, et classique, qui consiste à voir dans la liberté "l'absence d'obstacle extérieur dans la réalisation des désirs". Il précise que la liberté peut croître donc soit par une plus grande puissance, soit par la diminution des désirs.
Il note que c'est l'organisation sociale qui procure souvent la puissance, donc la liberté, mais qui, également, conditionne les désirs. La liberté est donc irrémédiablement individuelle et collective.
Russell justifie la contrainte publique par le besoin d'établir des libertés réelles minimales : "nourriture, santé, abri, vêtement, sexualité et paternité".
La contrainte vise à atteindre la justice, c'est à dire "l'arrangement qui produit le moins d'envie". Russell note que la société tolère un certain niveau d'inégalités, qu'il n'est pas rationnel de chercher à supprimer.
Enfin, il relève que la liberté croît dans des sociétés où les attentes sont homogènes. Il est plus facile de se mettre d'accord sur des règles communes si les objectifs sont communs. Cela condamne notamment le colonialisme mais aujourd'hui, permet également de pondérer les avantages du multiculturalisme.
XIV - La liberté contre l'autorité dans l'éducation
On retrouve le Russell des leçons sur le bonheur. Il développe des conceptions ouvertes et modérées de l'éducation. Pour employer le jargon moderne, un peu de "pédagogisme" ("il est plus facile de punir un garçon qui a montré de l'ennui que d'être intéressant soi-même"), un peu de traditionnalisme : à une femme qui est (déjà) partisane de ne rien interdire aux enfants, il rétorque quid d'un enfant qui voudrait avaler des épingles ?
A ces considérations pédagogiques, il ajoute des questions sociologiques. Par exemple, il est pour lui évident que les élites ont intérêt à ne pas accroître, via l'éducation, la concurrence susceptible d'être faite à leur progéniture par des rejetons des classes populaires.
Tout en rejetant le marxisme, Russell sait donc prendre en compte des questions "de classe", sans pour autant leur conférer la force d'explications globales.
Il se pose la question de la nature des justifications de l'autorité en matière d'éducation. De fait, ses développements montrent qu'il est partisan d'une école intelligente. C'est à dire que les élèves ne devraient apprendre que ce à quoi on arrive à les intéresser. Et on ne devrait leur proposer que des moyens intelligents d'apprendre - il donne l'exemple d'un enseignant faisant construire des machines à ses élèves pour leur apprendre les mathématiques - une sorte de "main à la pâte" avant l'heure.
Russell sait que cela est difficile. Mais il prend le problème par toutes ses facettes. Par exemple il souhaite des classes homogènes, les niveaux trop différents entre élèves conduisant à une perte de temps.
XV - Psychologie et politique
Un court chapitre où Russell s'interroge sur l'apport de la psychologie à la politique. La psychologie peut servir aux gouvernants à manipuler les masses. Elle peut aussi servir à pacifier la société en facilitant la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun : même si cela n'est pas le fondement de toute action humaine, ces besoins fondamentaux, après les plus évidents, sont la satisfation sexuelle et la possibilité de procréer.
C'est assez banal aujourd'hui en France, mais à l'époque ses positions libérales en matière de moeurs valurent à Russell la perte d'un poste d'enseignant à New York.
XVI - Le danger des guerres de religion
Russell sous ce titre vise en réalité la guerre de religion de son temps, celle qui oppose les USA à l'URSS. Pour lui, qui n'est pas marxiste, la différence entre ces deux sociétés ne doit pas être absolutisée. La propagande notamment est, dans le monde occidental, aussi fortement développée que chez les soviets ("un enseignement supérieur financé par des millionnaires...)
Préfigurant Aron, il trouve notamment que ces deux pôles sont l'un comme l'autre voués au développement industriel.
Peu soucieux des chapelles existantes, l'enjeu politique le plus concret qu'il soulève est celui de la propriété des matières premières. Il est pour lui ridicule que ces matières premières puissent être prétendues appartenir au pays qui les contient. Les matières premières devraient être des biens publics internationaux.
Avec de telles idées, la rente pétrolière serait peut-être aujourd'hui mieux répartie et mieux utilisée.
Russell peut flirter avec l'idéalisme, il n'est jamais niais.
Il reconnaît que la famille est une organisation utile et même admet une dose de grégarisme plus vaste, en écrivcant que "le nationalisme aussi a peut-être sa place, bien qu'il soit évident que les armées et les flottes n'en sont pas une expression désirable et que son domaine propre soit plutôt culturel que politique". Il reconnaît donc à la biologie, à l'ordre "naturel" (la famille, la nation), un rôle modérateur nécessaire par rapport notamment à la logique du tout-économique. Ailleurs, il quantifie cette part du biologique, du génétique, dans la nature humaine ("la nature humaine n'est nature que pour un dixième tout au plus, les autres neuf dixièmes ressortissent de l'éducation").
XVII - Quelques perspectives gaies et autres
"si notre civilisation doit se développer, il y aura nécessairement une autorité centrale qui contrôlera le monde entier. Car, dans le cas contraire, les causes de querelles se multiplieront et les guerres deviendront plus intenses à cause du développement de l'esprit public. Il se peut que l'autorité centrale ne soit pas un gouvernement formel ; je pense que probablement elle n'en sera pas un. Beaucoup plus sûrement elle sera une combinaison de financiers convaincus que la paix leur est avantageuse, car l'argent prêté à des états belligérants est souvent perdu."
Russell plaide pour une autorité mondiale qui traiterait de trois questions :
- les conflits de frontières,
- les mouvements de population,
- la gestion des matières premières.
Il accorde une confiance impressionnante dans les pouvoirs de la rationalité, avec même quelques aspects eugénistes ("l'autorité internationale insistera sur la liberté de limiter les naissances chez les races arriérées et dans les classes inférieures").
Russell, préfigurant probablement les thèses de Négri et Hardt sur l'Empire (de façon moins jargonnante), estime que cette autorité internationale s'imposera par le contrôle économique qu'elle établira, mais sera ensuite obligée de se démocratiser.
Comme les rois ont unifié des territoires qui se sont ensuite démocratisés, le gouvernement mondial s'imposera par le monopole économique puis par l'assentiment. La colonisation, d'une certaine façon, n'est qu'une prémisse de ce mouvement ("en Afrique même, les français, (qui à cet égard nous sont supérieurs) accomplissent des choses remarquables").
J'ai du mal à suivre Russell sur ce terrain. Si, en effet, l'usage de la raison, l'accroissement du niveau intellectuel du public et son éducation sont les moyens de pacifier la société, je vois mal comment on peut justifier un passage en force pour instaurer une puissance publique mondiale. Je trouve notamment plus pertinente l'idée de Russell de diviser les fonctions d'une telle autorité en secteurs, l'ensemble restant plus facile à contrôler.
Russell n'écarte pas un scénario moins rose, où le monde se diviserait en un pouvoir central fort, maintenant des minorités dans un état de dépendance et de subordination.
Autre écueil : pour organiser un monde rationnel, il faut donner à l'autroité centrale un pouvoir tel qu'elle ne pourra plus laisser la place nécessaire à l'aléa, à "une certaine dose d'anarchisme suffisante pour empêcher l'immobilité qui conduit au dépérissement mais insuffisante à provoquer la rupture".

