 Alors que la traduction allemande des Bienveillantes de Jonathan Littell connaît depuis le 23 février un succès considérable outre-Rhin, tout en suscitant de nombreuses polémiques, France 3 diffusait le 12 mars, dans le cadre de l’émission Pièces à conviction, un documentaire de Romain Icard intitulé Shoah par balles, l’Histoire oubliée. Reportage intéressant, sérieux, souvent poignant, avec pour fil conducteur le travail, important pour le devoir d’histoire et pour les familles des victimes, du père Patrick Desbois. La noblesse de cette action n’aurait-elle pas toutefois pu se passer de l’argument des producteurs qui consiste à présenter les crimes des Einsatzgruppen (commandos SS chargés de l’extermination des Juifs dont l’action commença bien avant la conférence de Wansee) comme une découverte ? C’est faire bien peu de cas des travaux de l’historien Christopher Browning qui avait déjà abordé le sujet en 1994 (Des hommes ordinaires, Les Belles Lettres) ainsi que d’un autre, Robert Rhodes (Extermination, la machine nazie, Autrement, 2004). Enfin, un long documentaire réalisé en 2005 par Laurence Rees, le directeur du département historique de la BBC, Auschwitz, la Solution finale (diffusé sur la chaîne « Histoire »), avait, lui aussi, dénoncé cette forme de génocide sans chambre à gaz ni industrialisation. De ce dernier film, il ressortait d’ailleurs que les camps de la mort avaient été mis en place, notamment, pour privilégier un mode de tuerie plus impersonnel et « ménager le moral » des troupes engagées dans les Einsatzgruppen. Il ne s’agit pas ici d’épingler Elise Lucet, animatrice du débat plein de dignité qui suivit, auquel participait Simone Veil, mais plutôt d’insister sur le rôle des historiens dont les livres ne font pas appel à la même charge émotionnelle qu’un documentaire.
Alors que la traduction allemande des Bienveillantes de Jonathan Littell connaît depuis le 23 février un succès considérable outre-Rhin, tout en suscitant de nombreuses polémiques, France 3 diffusait le 12 mars, dans le cadre de l’émission Pièces à conviction, un documentaire de Romain Icard intitulé Shoah par balles, l’Histoire oubliée. Reportage intéressant, sérieux, souvent poignant, avec pour fil conducteur le travail, important pour le devoir d’histoire et pour les familles des victimes, du père Patrick Desbois. La noblesse de cette action n’aurait-elle pas toutefois pu se passer de l’argument des producteurs qui consiste à présenter les crimes des Einsatzgruppen (commandos SS chargés de l’extermination des Juifs dont l’action commença bien avant la conférence de Wansee) comme une découverte ? C’est faire bien peu de cas des travaux de l’historien Christopher Browning qui avait déjà abordé le sujet en 1994 (Des hommes ordinaires, Les Belles Lettres) ainsi que d’un autre, Robert Rhodes (Extermination, la machine nazie, Autrement, 2004). Enfin, un long documentaire réalisé en 2005 par Laurence Rees, le directeur du département historique de la BBC, Auschwitz, la Solution finale (diffusé sur la chaîne « Histoire »), avait, lui aussi, dénoncé cette forme de génocide sans chambre à gaz ni industrialisation. De ce dernier film, il ressortait d’ailleurs que les camps de la mort avaient été mis en place, notamment, pour privilégier un mode de tuerie plus impersonnel et « ménager le moral » des troupes engagées dans les Einsatzgruppen. Il ne s’agit pas ici d’épingler Elise Lucet, animatrice du débat plein de dignité qui suivit, auquel participait Simone Veil, mais plutôt d’insister sur le rôle des historiens dont les livres ne font pas appel à la même charge émotionnelle qu’un documentaire.
Un autre ouvrage avait consacré plusieurs chapitres aux exécutions 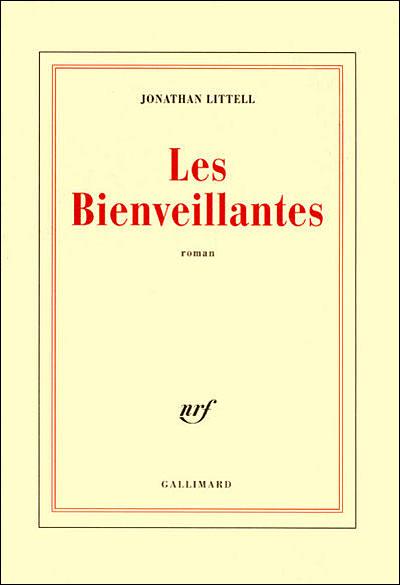
N’étant pas spécialiste du Pakistan, j’avoue mon incapacité à juger ce qui, dans le livre de BHL, peut relever de la vérité ou de l’imposture. On peut toujours lui accorder le bénéfice du doute. En revanche, je peux témoigner que la lecture de son roman Les Derniers jours de Charles Baudelaire (Grasset, 1988), présenté par l’éditeur comme « aussi fidèle aux exigences de la vérité qu’à celles de l’imagination », avait suscité l’hilarité des universitaires baudelairiens. Le chapitre 4 à lui seul, constitue un florilège d’inexactitudes. Il y est notamment question de la fameuse scène du fiasco dont aurait été victime Baudelaire le jour où Madame Sabatier – présentée par l’auteur comme une parfaite imbécile – s’était donnée à lui. Ce fiasco n’a jamais existé, c’est une invention de deux plumitifs du début du XIXe siècle, comme je crois l’avoir démontré dans la biographie que j’ai consacrée à la Présidente en 2003. En 1988, BHL ne pouvait donc le savoir, on ne peut lui faire grief d’avoir traité cet épisode. Ce n’était toutefois pas une raison pour affubler la « Muse et la Madone » du poète d’un pied déformé à la peau « presque morte » qui aurait soudain éveillé son excitation… « Les exigences de la vérité », en l’occurrence, s’étaient effacées devant une lecture trop rapide d’un article de Gustave Planche qui, dans son Salon de 1847, avait rendu compte de la Femme piquée par un serpent, marbre que Clésinger exposait et pour lequel Apollonie Sabatier avait posé. Ce n’est pas le seul point sur lequel la documentation de l’écrivain fait défaut ; au fil des 346 pages du roman, qui obtint le prix Interallié, le lecteur pourra se livrer à un amusant jeu des sept erreurs (il y en a bien davantage). Soyons clairs: le romancier a le droit d’écrire ce qu’il veut, de jouer avec la vérité historique et de s’en jouer, car la liberté du créateur est un principe avec lequel on ne saurait transiger, mais il lui faut alors jouer carte sur table et ne pas revendiquer une exigence de vérité qui, forcément, trompe quelque part ses lecteurs.
Le roman de Jonathan Littell se présente comme un contre-exemple des Derniers jours. On peut débattre du thème, du parti pris de l’auteur d’avoir donné la parole à un bourreau. Ce qu’on ne peut, en revanche, lui reprocher, c’est l’étonnante exactitude historique de ses sources. Ainsi, pour avoir longuement étudié l’histoire de l’occupation de Budapest par les Nazis, et en le lisant avec attention, je n’ai pu trouver la moindre erreur historique dans les chapitres des Bienveillantes consacrés à ce sujet. Il serait surprenant que les sources de l’auteur, s’agissant des crimes des Einsatzgruppen, soient moins fiables, d’un point de vue historique, que celles se rapportant à la Hongrie. Rien, d’ailleurs, dans Shoah par balles, ne vient le contredire.
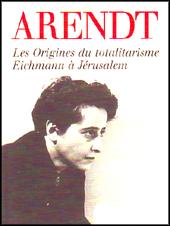
Au moment où Hannah Arendt essuyait les attaques les plus indignes, le professeur Stanley Milgram réalisait une expérience qui apporte sans doute des éléments de réponse. Celle-ci éclaire impitoyablement sur les comportements humains. Elle est connue, mais il n’est pas inutile d’en rappeler le principe. Dans son luxueux laboratoire de l’Université de Yale, il demandait à un sujet recruté par petites annonces de jouer le rôle de « professeur ». Celui-ci consistait, sous la responsabilité d’un scientifique en blouse blanche, à faire apprendre à un « élève » des couples de mots, et à infliger à celui-ci une punition sous forme de décharges électriques progressives, s’il venait à se tromper en en restituant les associations. L’élève, qui faisait partie du laboratoire (ce que le sujet ignorait) simulait la douleur de chocs électriques croissants et naturellement fictif. Milgram voulait étudier le conflit intérieur qui secouait le « professeur » conduit à torturer un inconnu qui ne lui avait jamais rien fait. Son Etude sur la soumission à l’autorité mit en lumière que, sur 600 sujets – des gens tout à fait ordinaires ne manifestant aucune pulsion agressive – 65% allaient jusqu’au choc final et mortel de 450 volts, en dépit des supplications de l’élève. Hannah Arendt n’eut pu rêver une étude scientifique plus pertinente en appui de sa théorie.

