Dans une entrevue accordé à Thierry Bayle et publiée dans le Magazine littéraire. No 353, Pierre Michon parlait ainsi de son livre, Les mythologies d’hiver:
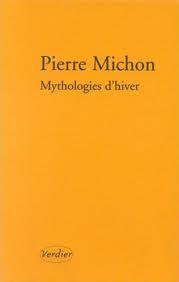
« Et puis il y a une quatrième série qui est en train d’apparaître, dont je publie le premier morceau avec ces Mythologies d’hiver, mais dont j’ai bien du mal à parler parce que je n’ai pas de recul, et je ne sais pas du tout comment ça va être reçu. Ce sont des récits très brefs, dans les trois ou quatre pages, où je dirais bien que j’essaye de brasser l’histoire, c’est-à-dire tout ce qui a été écrit, par des moines, des chroniqueurs ou des notaires, donc à des fins extralittéraires, et de faire passer tout ça dans le giron de la littérature. ça paraît très ambitieux dit comme ça, l’autobiographie du genre humain, etc., mais c’est très simple : je cherche des hommes dans l’archive, j’en trouve, et j’essaye de leur redonner vie. J’ai ainsi en train tout un ensemble, sur Saint-Denis, l’ossuaire de l’histoire, l’image d’Épinal de cet ossuaire, les Rois, etc. Et il y a encore une quatrième manière, où prendraient place mon « roman » en cours sur la Terreur, et La Grande Beune.
Quant à vous dire si j’entends la grande voix despotique de la littérature... Non, sûrement pas, c’est une image, c’est un cinéma que je me fais pour m’obliger à écrire – pour oser, tout simplement. C’est une croyance que je pose a priori, un dispositif qui me permet quand j’écris de m’efforcer vers plus que ce que je suis. Vers ce que je ne suis pas, dans un sens.
Et bien sûr que je voudrais ne pas écrire, que « j’aimerais mieux pas », comme dit Bartleby !
Ceux qui importent, ce sont ceux qui mettent leur briquette comme si c’était de la dynamite, en se disant : cette fois l’édifice va péter.
Ce qui vous semble commun à celles-ci (Vies Minuscules) et à Mythologies d’hiver c’est peut-être l’accent mis sur l’anonyme, ces noms propres bizarres qui apparaissent dans la table des matières. C’est qu’ici et là j’ai cherché à redonner vie, volume physique et volonté d’être, à des noms évanouis et à peine perceptibles, mais qui existèrent dans le réel. Avec quelques autres concepts de la grande panoplie catholique, celui de la résurrection des corps est un de ceux qui me sont le plus chers, et j’essaye de le mimer en littérature, peut-être de l’appeler, de le faire venir. Il y a tout de même une petite différence : les noms des Vies minuscules sont attestés sur les dalles de cimetières du Limousin, je les ai entendus dans la bouche de ma grand-mère, et j’ai connu en chair et en os certains des hommes provisoires qui ont habité ces noms plus durables. Les autres noms que vous citez, qui viennent de Neuf passages du Causse, m’ont été donnés par l’archive, et encore par de l’archive déjà exemplifiée, légendaire, ils sont de l’écrit qui vient de l’écrit, et tenter de mettre un peu de vie là-dedans a quelque chose de très exaltant mais aussi de presque blasphématoire.
Les gens dont il était question dans les Vies minuscules m’étaient consubstantiels en quelque sorte, je les ai vus de mes yeux souffrir, rire et mourir, ils étaient la chair de ma chair. Ceux des Mythologies d’hiver sont des abstractions d’archive auxquelles je prête un volume physique, des désirs, une existence et une mort.
J’avoue tout de même que j’ai du goût pour les histoires en costume, les siècles classiques ou le Moyen Âge ».
***
Et au quatrième de couverture de son livre, Michon s’exprime ainsi :
« Il importe peu que le Gévaudan et l’Irlande soient les scènes où se jouent ces drames brefs. Ce qui importe, c’est qu‘avec le monde on fasse des pays et des langues, avec le chaos du sens, avec les prés des champs de bataille, avec nos actes des légendes et cette forme sophistiquée de la légende qu’est l’histoire, avec les noms communs du nom propre. Que les choses de l’été, l’amour, la foi et l’ardeur, gèlent pour finir dans l’hiver impeccable des livres. Et que pourtant dans cette glace un peu de vie reste prise, fraîche, garante de notre existence et de notre liberté. Ce peu de vérité mortelle qui brûle dans le cœur froid de l’écrit, la beauté chétive de l’une et la splendeur impassible de l’autre, voilà ce que je me suis efforcé de dire ici ».
***
Maintenant, moi, qu’ai-je à dire de ce dire ? Je ne sais pas, j’essaie de dire quelque chose qui tienne, qui fait sens pour moi ?
Le texte des Mythologies d’hiver comprend 12 courts textes dont trois ont l’Irlande comme fond de scène, et 9 le Gévaudan, ma région toute proche, autour de Ste-Énimie.
J’essaie de passer là-dessus à la vitesse de mes doigts sur le clavier... et je retiens...
Toutes trois, elles courent dans l’aube du printemps, elles ont la chair excessive, « des chairs lactées, rouillées, cent fois nues les chairs d’Irlande et de paganisme ». Elles sont les filles d’un roi, - Leary, roi de Leinster -, que l’archevêque d’Armagh va tenter de convertir, d’embobeliner, avec des formules abracadabrantes et druidiques. Ce sont pourtant les filles qui demandent à voir dieu, Le Dieu, comme elles en ont entendu parler par les bonnes. Elles veulent le connaître, elles veulent recevoir dans leur corps, le corps du fiancé, sous la forme d’une petite galette de pain ; elles en mourront. L’archevêque le leur avait dit – qui parle de « vérité aride, grecque et juive » : « Tu le verras quand tu seras morte ». Le roi a l’air d’un roi, « tunique de lin, le manteau, l’or à l’agrafe », les filles ont l’air de communiantes, elles portent « les robes de lin blanc, la fibule d’or ». Lorsqu’elles sortent dans le soleil, après la communion, elles mourront l’une après l’autre, la prophétie-vérité-de-Dieu est réalisée.
Columbkill, homme d’épée, est aussi un moine, comme il seyait à ces monastères-châteaux de l’époque. Lorsqu’il lit : « Je hais les équivoques et j’aime ta loi », un texte de grande louange où l’on voit apparaître le roi David « dans ses diverses fonctions de tuerie et de musique », il le veut, ce texte, pour lui. Il loue son hôte, Finian, de posséder un tel trésor. Homme de guerre, chantant les psaumes du texte, il lève ses armées, six cents chevaux, et va écraser le roi Diarmait, – qui avait pris la part de Finian dans une querelle pour la propriété du texte - et ses milles chevaux, et ses jeunes hommes combattants, qui se couchent dans « l’étable de la mort ». « On les entend mourir et on entend se réjouir les corneilles ». Columbkill, quand il s’empare du texte, ne le voit plus comme il l’était, il ne trouve plus ce qu’il a lu, ni ne voit ce qu’il voyait... il s’est fourvoyé, il n’entend plus que les corneilles, au-dessus de l’étable de la mort, qui se rient de son malheur ; il prend la bure, prend la mer, fuit, cherche le désert qui seul pourra lui donner la liberté d’être libre et nu...
Suibhne, roi de Kildare, guerroie, mange et rit ; c’est un homme simple, il arbore une plume blanche. Fin Barr, l’abbé, l’aime; le frère de Fin Barr est roi lui aussi, il arbore une plume de corbeau. La guerre est inévitable, pas besoin de prétexte, plume blanche contre plume de corbeau. Suibhne passe son épée à travers le corps du frère de Fin Barr et l’achève à la hache. « Devant le corps son ivresse tombe. L’âme de Suibhne le rejoint ». Suibhne s’enfuit dans la forêt, poursuivi par la malédiction de Fin Barr ; il a trouvé son désert à lui. Neuf années passent. Quand il réapparaît, Fin Barr voit le corbeau sur l’épaule du roi, le roi qui n’a que le sabir des corbeaux pour exprimer sa joie. Oui, il chante et semble prodigieusement heureux. On raconte qu’il est devenu un oiseau. « Fin Barr est ému, il caresse cette boule de gui et de plumes noires qui fut un roi ». Est-il saint ou fou ? Est-il une bête ? Mais, être ainsi, est-ce « être en proie à l’âme ou en pâture au corps » ? Dieu le sait.
« Barthélémy Prunières est sur le Causse Méjean. Il y cherche des hommes morts ». L’anthropologue des morceaux de morts retrouvés – un puzzle chaque jour recomposé – comprend que « tous ces os avaient été blanchis par la pluie, la rosée et la neige ».
« L’évêque Hilère a laissé tomber la mitre ». Il fonde alors une communauté de frères et se fait un petit ermitage où il arrive que le diable vienne. « Il prend pendant des journées entières la forme bénigne de filles toutes nues » quand il n’est pas Hilère, ou un peu de vent, ou un beau soleil, ou une belle feuille neuve. Le Causse est son siège épiscopal, il trône, il croise le diable ; mais il sait, ou ne sait pas, si « un homme est tous les hommes, un lieu tous les lieux ».
« Énimie est la petite fille de Frédégonde, qui faisait attacher ses rivales aux queues des chevaux ». Et fille de Clotaire II qui avec la complicité de Gondevald, maire du palais de Paris, se fait remettre titres et biens du roi de Metz. Ils attribuent à Énimie le rôle d’abbesse pour un monastère de filles. Gondevald sourit... Énimie est belle et pâle... elle fait des mines à Gondevald... Gondevald regarde sa poitrine... elle couche avec Gondevald... elle est bientôt malade... elle meurt à Soissons. Mais elle a connu « le plaisir dans le corps d’une abbesse ».
Plus tard, une poignée de moine vont réhabiliter le monastère d’Énimie. Mais on devra fonder sa légitimité, en langue noble. Le frère Simon en est chargé. Il charge à son tour son jeune collègue, frère Pallade, de retrouver – il l’envoie sur les routes - dans les archives monastiques le « nom » la femme dont il vient d’exhumer le corps sous les dalles du plancher de l’abbaye. Un jour, frère Pallade réapparaît et crie « Énimia ». C’est le nom. Frère Simon taille des plumes et prépare un beau parchemin, subit les attaques de Satan, implore Énimia « Sainte, ne permets pas qu’il t’arrête. Ne permets pas qu’il m’arrête » ; puis compose en langue noble, légitimant ainsi l’abbaye, la « Victa sancta Enimia ».
On a écrit ainsi l’histoire de Sancta Enimia : « Énimia est belle et pâle... les hommes l’aiment et la convoitent... elle croit qu’elle aime Dieu... elle devra marier Gondevald, les noces sont pour demain... c’est la nuit, les palefreniers rient dans la cour... Puis, dans son miroir, Énimia voit à la place de son beau visage, un masque livide et boursouflé, l’empreinte de la lèpre. C’est un leurre mis là par Dieu qui veut l’éloigner de Gondevald. Mais elle doit encore confronter Satan lorsqu’elle reviendra avec son autre visage, celui de sainte – tous se réjouissent, les tentures du grand char lui sont ouvertes – elle parle à Dieu qui l’aime, elle rit haut et souvent ». Mais elle est belle pour Dieu,... et elle régente l’abbaye, elle s’y enfouit, pour exister à peine, pour trembler, et pour mourir longtemps. Au dehors « la vie est une lèpre. L’heure présente est une lèpre ».
Bertran de Marseille est « commis aux choses écrites qui règlent l’advenue de choses réelles ». Mais tellement de paroles lui passent entre les mains et ne lui appartiennent pas. Un jour, son évêque lui demande de réécrire le « Victa sancta Enimia ». Il le veut pour qu’on le dise et l’entende chez tous les hommes, il le veut visible et clair, absolu comme le serait la description d’un plat de lentilles qu’on voudrait sur le tas déguster. Mais, ajoute-t-il, pour que « ces rustres t’entendent, tu vas devoir dire le vrai et cependant mentir ». Tout l’hiver Bertran de Marseille va composer le « poème » - deux mille vers octosyllabes à rimes plates – en langue vulgaire, la Vie de sainte Énimie » et le présenter à l’évêque. Dans son texte, tout y est : l’absolu et le visible, le Causse Méjan, chaque pierre du Tarn... et, derrière cet apparat, le bien et le mal, les miracles et les cadavres, « une femme qui se déshabille et qu’on voit toute nue ». Son évêque voit que Dieu est dans cette chair. « Il se réjouit et pleure comme le feront les vilains dans les foires, quand les jongleurs diront la Vie de sainte Énimie ».
Seguin de Badefol vient de prendre Mende. « Tout le jour ils ont tué, pris des vaisselles, des filles et des pelisses. Toute la nuit ils ont bu ». Le lendemain, ça ne finit plus, on va voir un autre monastère s’il veut bien s’ouvrir ou brûler, et « si les femmes des jacques sont de belle humeur, si le diable y est ». Mais Seguin de Badefol, tout à coup s’arrête... et se met à parler de Dieu – « il parlerait bien de remords s’il avait l’usage, l’emploi et même le souvenir de ce mot », - et, lorsque son frère d’armes s’oppose à lui, il lui tranche la gorge. « Seguin soupire. Il essuie sa lame à la crinière de son cheval ». Continuons, ajoute-t-il.
Le 9 juin 1793, Robespierre régnant, Antoine Pergsegol marche sur le causse de Sauveterre, avec ses gars, ils ont des armes, ils sont ivres. Il pense à sa mère, il a un penchant pour la République, - mais on lui a dit que la misère noire du peuple était de source républicaine – il va donc se battre contre les bleus avec « sa faux qu’il a montée en pique, la pointe du fer dans le prolongement du manche ». Mais les bleus ont de la cavalerie, il doit se soumettre. Il le sait, il aime la République, il se doute bien que, sans le vin, la République n’est pas responsable de la misère des gens ; mais les bleus ne savent pas qu’il se doute... - sa mère l’attend, elle l’attendra - « la grande machine à biseau rapide est dressée sur la place de la Florac ». Sa tête, séparée de son corps « vérifie violemment la loi de la chute des corps ».
Édouard Martel est tout près de réussir sa vie. Il a fondé la spéléologie, il est réputé. Quand une pierre jetée dans un puits est avalée sans un bruit, on le lui dit. C’est ainsi qu’il entreprend l’exploration d’une caverne que le serrurier Louis Armand lui présente ainsi: « Les pierres qu’on y jette descendent au diable ». « Eh bien, allons au diable », lui dit en riant Martel. Dans cette grotte Martel goûte un pur bonheur. Quand ses esquisses confirmeront l’ampleur de la découverte, il écrira: « Dans la grande salle, Notre-Dame de Paris sans peine entrerait toute entière ».
***
« un homme est tous les hommes, un lieu tous les lieux ».
« la vie est une lèpre. L’heure présente est une lèpre ».
« être en proie à l’âme ou en pâture au corps »
Prophéties, ou image du réel ? Mal ou bien ? Vérité ou entourloupe ? Dieu ou diable ? Est-il légitime - ou pas - de réécrire ces textes de cette façon ? Dans quel dessein ? Michon ose le mot « blasphème ».
Michon est toujours mystérieux à mes yeux, je dois relire ses textes plusieurs fois, je dois m’y retrouver avant tout, je cherche du sens, ou du moins, ce qui fait sens à mes yeux et je ne suis pas certain d’y arriver. Michon nous dit « j’ai cherché à redonner vie, volume physique et volonté d’être, à des noms évanouis et à peine perceptibles, mais qui existèrent dans le réel ». Oui, mais ensuite? Et il ajoute vouloir faire passer tout ça dans le giron de la littérature. Et il le dit lui-même que cela paraît très ambitieux dit comme ça, « l’autobiographie du genre humain ».
Montrer l’histoire autrement, faire revivre des pans oubliés – sinon occultés - de cette histoire, de notre histoire, est-ce là le dessein ? Je ne crois pas. Je crois que cela va beaucoup plus loin.
Ainsi, je m’interroge sur des textes que mon fils a écrits et qui ont comme trame de fond ce qu’on appelle la littérature de « fantasy » (origine américaine ?). Jamais auparavant je n’ai lu de textes comme ceux de Michon qui ont cette apparence de notre HISTOIRE revisitée grâce à des textes pourtant réels et qui semblent sortir tout droit de ce monde de « fantasy » dans la littérature d’aujourd’hui. Ainsi, les textes de mon fils m’apparaissent sous un nouveau jour, je crois y retrouver cet exercice de Michon, dans « Mythologies d’hiver » ; je crois y déceler un regard neuf sur notre monde (léprosé, pourquoi pas ?), un regard qui m’échappait encore il y a peu de temps. Ses textes ne sont pas des textes anciens revisités, ils sont des textes neufs, dont les fondements font appel à des histoires passées, réelles ou imaginaires, et même à des histoires futures dans ce sens où ils tentent de projeter en avant un monde ancien redécouvert – des pans entiers réels de ce monde ancien : les chevaliers de la table ronde, les druides, la recherche de l’arche perdue - et mis au goût du jour (l’expression n’est pas très belle, je sais). Le film « Avatar » est-il un bon exemple de ce futur antérieur? Je ne sais pas.
Dans le dernier numéro du Magazine Littéraire No 526, où l’on trouve le dossier « Ce que la littérature sait de l’autre », on trouve dans l’introduction de ce dossier, sous la plume d’Alexandre Gefen, un texte brillant – d’une force rare, je devrais dire d’une grande intelligence – qui nous rappelle que « la littérature n’est pas qu’un divertissement mais qu’elle produit un savoir – et donc une forme d’action sur le monde ».
Pour moi, les littéraires n’ont pas à produire des preuves de ce qu’ils avancent, ils « énoncent », ils nous donnent avec des mots, des yeux pour voir mieux l’homme, les corps, l’âme. À nous de voir, et d’entendre ce que les mots nous disent, et surtout, nous disent d’autrui. Cet autre qui n’est pas moi, et qu’il n’est jamais simple de bien voir et de comprendre. Comment comprendre des textes – ceux de mon fils – qui me sont à priori étrangers, et leurs protagonistes qui me semblent sortir des histoires de Barbe Bleu et de Blanche Neige ? Je crois qu’il faut, un peu comme entrer, s’immerger dans la tête de ces protagonistes, les identifier tout en nous « désidentifiant à nous-mêmes » (Gefen) On doit alors changer notre position (presque sociale), du moins changer notre posture intellectuelle, et, pour un temps, le temps de la lecture de ces textes (qui nous semblent étrangers) « emprunter le corps et l’âme d’autrui ». Nous nous autorisons alors à incorporer, « concrètement et émotivement », autrui à notre identité.
« La valeur esthétique d’une œuvre ne tient-elle pas à son aptitude à nous faire échapper à nous même » ? écrit Gefen. Nous pouvons alors imaginer que nous pourrions briser une partie de notre enfermement dans notre identité personnelle. Et si je vais plus loin, cela pourrait nous donner accès à une communauté humaine plus large, et possiblement générer en nous « un altruisme indispensable au fonctionnement de toute relation intersubjective, et politiquement essentiel à toute démocratie, qui nous impose à la fois de reconnaître l’autre comme différent et comme notre égal formel » (Gefen) Cela est d’autant plus vrai – et plus grand comme dessein - quand je considère que la littérature est une porte d’entrée indiscutable vers les « autres cultures » et cela, même si leurs langues sont traduites.
Quand j’écris cela, je pleure – ça va me passer - de voir massacrée tous les jours cette prétendue démocratie des UMPistes Coppé et Fillion, les deux Guignols de l'info depuis 15 jours.
Gefen cite le poète latin Térence : « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain, je crois, ne m’est étranger ».
La différence est grande entre nos singularités ; mais nous sommes tous parties d’une communauté d’hommes. Notre intelligence pour comprendre ces deux aspects doit demeurer en éveil.
Pour paraphraser Michon, c’est tout un cinéma que je me fais quand je rédige un article comme celui-ci. Mais pour l’écrire, et comme il le dit, je le fais sans doute « pour m’obliger à écrire – pour oser, tout simplement. C’est une croyance que je pose a priori, un dispositif qui me permet quand j’écris de m’efforcer vers plus que ce que je suis. Vers ce que je ne suis pas, dans un sens ».
