Jérome Ferrari
« Le sermon sur la chute de Rome »
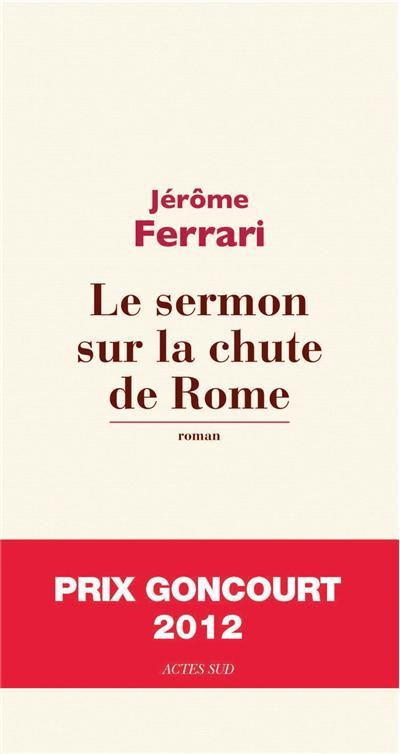
Je ne savais pas trop à quoi m’attendre avec le livre de Ferrari. J’avais lu une bonne critique de ce livre dans Le Monde des Livres, mais quelque chose me chicotait ; je venais de lire le Goncourt des Lycéens et j’étais très déçu. Bien sûr, si mon fils les avait lus, il m'aurait dit « y a pas rapport » entre ces deux Goncourt. Et il aurait eu raison.
Dès l’entrée dans le livre de Ferrari, je suis captivé par cette image, cette photo prise en 1918 et que Marcel Antonetti s‘est obstiné à regarder toute sa vie « pour y déchiffrer l’énigme de l’absence ». Sinon l’énigme de la vie sur terre. Déjà le philosophe Ferrari nous amenait sur son terrain, celui de la question ??
Je me l’imaginais cette image, - je me faisais mon cinéma - cette photo...

...un peu vieillotte, un peu grise, un peu fanée, quoi ! où les personnages apparaissent plus ombre que lumière, avec des airs graves, l’époque était assez triste, une guerre avait marqué ces gens, et ces autres gens qui n’apparaissent pas parce que « morts au combat », comme on disait, laissant des familles sans père, sans frère, sans oncle ou pis, sans fils ; la guerre est cruelle et mortelle, elle laisse peu de joie dans son sillage, elle culbute des valeurs, elle produit des horreurs, cette photo laissait-t-elle apparaître des stigmates ? des visages sans fard ? des têtes sur des corps évanescents ? des regards vides ? Sans doute. Et voilà, j’en étais là, à toujours m’imaginer voir cette photo, et je me suis arrêté de lire, j’attendais, mais rien ne vint, alors je poursuivis ma lecture...
L’absent, c’est lui, Marcel.
Il y a donc énigme, et je découvrirai peu à peu que l’énigme est simple, et que bien d’autres histoires, toutes un peu énigmatiques, sinon cruelles, – il s’agit d’histoires corses – viendront s’y ajouter.
J’ai écrit « histoires corses », comme si cela sous-entendait quelque chose ; mais je n’ai aucune idée de ce pays, à part ce que rapportent les media, ni non plus des histoires qui racontent ce pays, j’y suis allé une fois, j’étais touriste, et j’ai beaucoup aimé ses paysages, plus qu’autres choses. La Corse touristique ne me disait rien de plus que ce qu’offrent d’autres destinations touristiques: bon ciel, bonne chaleur, bons restos, bonnes plages, bonnes gens, bonnes ambiances, bonne nature à découvrir. Nous avons marché les calandres corses du nord-ouest, des randonnées sublimes dans l’ocre des levers et des couchers de soleil, nous nous y sommes plus, plus que je ne peux l'écrire. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir parler avec des gens au hasard des routes et sentiers, cafés et place publiques, tous un peu dingues, parfois curieux de nous, - nous ne sommes pas français, – loufoques aussi si vous aimez mieux, ou encore mystérieux, dans leurs histoires qu’ils racontent et qui ne tiennent pas la route de la réalité ni non plus celle de la franchise. Oui, nous avons cherché, nous cherchions à nous immiscer un peu dans la vie locale, mais nous ne pouvions rien y trouver, nous n’y arrivions pas. Le Corse, se peut-il, parle peu avec l’étranger, nous l’étions, et de plus, touristes, et il frime, c’est notre sentiment. Que faire d’autre avec des touristes qui viennent du continent ?
1918
Je reviens à cette photo de 1918 : il y a sa mère, et lui, Marcel, n’est pas là, on ne le connaît pas, il n’est pas encore né, mais on le devine dans l’ombre de la photo, dans la tête, non, dans le regard de la mère. Elle sait qu’il viendra. « Marcel contemple d’abord le spectacle de sa propre absence ». Pourquoi, le narrateur en fait-il un mystère ? La mère a l’air de le regarder mais il n’en est rien, croit-il, elle regarde tristement au-delà de l’obturateur de l’appareil photo, le mari parti à la guerre et qui ne revient pas. Il sera là en 1919, à temps pour la naissance de Marcel. Pour ma part je remarquai Jeanne-Marie, sa toute petite sœur, pieds nus et en haillons, gênée. Mais c’est la photo qui est le mystère, cette photo que Marcel garde cachée, et qu’il retrouve de temps en temps de peur que les images ne s’effacent et que les personnages disparaissent, et avec eux, la vie, le monde, le monde ancien, crois-je. Au moment du récit qui nous occupe, Marcel est le seul survivant de cette famille. Que s’est-il passé ?
Marcel ne naîtra pas comme les autres, il attendra même quelques minutes – est-il mort, se disait-on ? – avant de lancer son premier cri, à peine audible. Toute sa vie, il aura la fièvre, toute sa vie il aura la nausée, toute sa vie, à chaque quinte de toux, on croira que c’est sa dernière. « Mais Marcel ne cessait pas de guérir et il vivait ». C’était son destin, c’était écrit, et il le savait : jamais le méchant, le diable, ou quiconque, ne pourraient le vaincre. Ça, Marcel en était convaincu.
39-45
Puis nous voici plongé à la fin de la guerre 39-45...

...où, « après avoir payé le prix de la chair et du sang, il fallait maintenant offrir à un monde disparu le tribut de symboles qu’il réclamait pour s’effacer définitivement et laisser enfin sa place à un monde nouveau ». Mais voilà, ce monde ne vint pas, et la comédie du monde ancien - des hommes abandonnés, privés de monde – se poursuivit. Souffrance et désarroi étaient au programme du monde, et prolongeaient l’inexistence de ses hommes. Un monde était disparu sans que l’on ne s’en aperçoive, et aucun monde n’était venu le remplacer. « Nous ne savons pas, en vérité, ce que sont les mondes ni de quoi dépend leur existence », écrit Ferrari. Voilà ! ce premier chapitre, qui questionne l’existence des mondes, – l’auteur l’intitule : « Peut-être Rome n’a-t-elle pas péri si les Romains ne périssent pas » - est clos.
Le deuxième chapitre, lui, s’intitule : « N’éprouvez donc pas de réticences, frères, pour les châtiments de dieu ». Où cela va-t-il nous mener ? C’est l’aventure de ce livre qui commence.
Le BAR
Un BAR au « village », un village corse... comme bien d'autres BARs...

...va bientôt se trouver sans personne pour le gérer, l’occuper, et servir... Hayet, gérante-serveuse-amie-de-tous, c’était l’âme de ce BAR, vient de le quitter, sans un mot d’adieu, et sans remords. La place est vide, vidée et propre comme un sous neuf. Virgile Ordioni et sa grosse carcasse de Corse habitant ce village – le « village » – ne le sait pas encore ; il revient d’une chasse au sanglier, il en a tué trois à lui seul, sur les cinq abattus, et ne pourra pas obtenir son apéritif d’assoiffé joyeux et survolté. Marie-Angèle, la propriétaire du BAR ne le savait pas non plus, Hayet est partie sans l’avertir, elle devra le rouvrir pour que les chasseurs puissent finir leur chasse, telle que cela doit être, dans une ambiance anisée et nauséeuse.
Claudie Antonetti habitait Paris, et elle avait un fils, Matthieu, qu’elle confia un jour à Gavina Pintus, qui elle aussi avait un fils du même âge, Libero, et habitait au « village » dans l’île. Les deux enfants ne se quittèrent plus, du moins aux vacances d’été lorsque Matthieu venait rejoindre Libero, dans l’île. Marcel, celui qui n’est pas sur la photo de 1918, était le grand-père de Matthieu... qu’il n’aimait pas pour s’être fait un ami d’un Sarde. Mais Matthieu avait quitté un monde qu’il n’aimait pas, la ville, Paris ; le « village » était devenu son monde, avec ses mœurs et coutumes. Virgile Ordioni châtrait toujours les jeunes verrats, et offrait à ses amis le fruit de sa chasse; oui, Matthieu aimait se gaver de couilles de porc grillées au feu de bois et il ne comprenait toujours pas la langue de ces gens quand ils se parlaient entre eux, mais cela n’avait aucune importance à ses yeux, il aimait être de ce monde.
Suite au départ de Hayet, le BAR connu une suite de calamités : entendons des gérances de BAR poisseuses les unes après les autres. C’est à ce moment que nous, lecteurs, à travers des récits débridés, - des cons, des gentils, des nuls, des mecs de tout acabit s’essaient à la gérance du BAR, mais sans résultat qui puisse satisfaire la propriétaire, elle est sur le point d’abandonner, c’est son chemin de croix - pénétrons peu à peu dans l’ambiance corse, dans cette société corse, dans l’île, dans le « village ».
Le déclic
À cette époque Libero et Matthieu s’étaient retrouvés en fac de Philo à Paris. Libero croyait au monde du grand savoir le jour où il fut admis en école préparatoire ; il lisait les quatre sermons sur la chute de Rome, il faisait sa thèse sur Augustin, Matthieu sur Liebniz. Ils furent diplômés. Mais Libero en eu marre rapidement quand il jugea que ses professeurs, tous scribes et philistins, et lui-même, n’étaient que des vaincus, « des êtres inadaptés et bientôt incompréhensibles, les survivants d’une apocalypse sournoise qui avait décimé leurs semblables et mis à bas les temples des divinités qu’ils adoraient, dont la lumière s’était jadis répandue sur le monde ». Son jugement sur la philosophie, sur les misérables exégètes de Liebniz et Augustin, était sévère, il était sans appel, tout lui paraissait dorénavant triste et sale à Paris... il avait besoin d’air avant que le mépris qu’il éprouvait pour lui même ne le saisisse à la gorge. Il proposa à Matthieu qui accepta – celui-ci quitte alors son destin qui a nom Judith et qui l’aime - de prendre, à eux deux, la gérance du BAR au « village ».
C’est le début d’une aventure, mais surtout ce n’est que le prétexte pour Ferrari de montrer ce monde actuel-nouveau-d’aujourd’hui, au « village » et ailleurs, dans lequel évoluent des personnages et se manifestent des phénomènes sociaux, moraux, physiologiques. Ainsi...
1/ Des personnages, des caractères bien trempés, Ferrari les montre avec une langue... toujours très nette, délicate, émotionnée... mais aussi rugueuse, déterminée comme le sont ses héros, dont...
Marcel, celui qui lutta toute sa vie pour survivre, des maladies de son enfance, en passant par un ulcère qu’il avait vaincu, et surtout, par une feuille de route tortueuse comme fonctionnaire-soldat-officier-chef-d’équipe-sans-grade-d’arrière-garde et qui le tue à petit feu, ne se remettra jamais des inconvénients et déconvenues de la vie, il est pourtant présent pour chacun. Ses rêves sont inclassables, irréalisables, il lutte pourtant « de sueur et de sang, contre le temps perdu, contre le regard las de sa mère, contre le silence résigné de son père », en fait il ne demande que le droit d’être là. Pourtant il jouit d’une vitalité sans limite, cela ne lui permettra jamais plus que d’être là. Au fil des pages, Marcel nous apparaît être une sorte de phénix, un oiseau unique, solitaire le plus souvent, séparé du reste de son espèce, soit volontairement, parce qu’il n’aime pas ces mondes où il vit, soit parce qu’il a été mis à l’écart, ainsi nommé fonctionnaire-administrateur au fin fonds de l’Afrique.
Son frère Jean-Batiste, qu’il enviait au départ de pouvoir aller sur les champs de batailles de l’empire colonial français, mais qu’il voit finalement comme un petit minable à grosse carcasse molle et suante des gabegies fourbes et fornications multiples avec des putains, bref, comme un petit paysan misérable, comme il y en a des dizaines tout autour.
Sa petite sœur Jeanne-Marie, toujours rayonnante d’une joie timide, autrefois jeune amoureuse et qui perdit son mari mort au front ; elle porta le deuil et amena cette affreux sentiment de deuil au foyer et au « village », jusqu’à ce qu’elle rencontre son nouvel époux, - elle est usée par le chagrin, mais elle ose encore y croire - lui aussi soldat et que Marcel enviait, parce que, lui, il se battait et tuait sans doute des hommes dans les conquêtes et les vols des terres- sociétés-patrimoine-cultures des autres, jusqu’à ce que surviennent Den Bien Phu, et la fin de la guerre en Algérie.
Marcel avait un faible émouvant pour Aurélie, sœur de Matthieu, un Matthieu qu’elle exècre mais qu’elle aime, qui l’exaspère, un enfant gâté, un petit morveux, dit-elle un jour, sans plus. Aurélie aime bien Marcel, son confident parfois, l’homme en qui elle avait confiance, et qui l’a aidée dans ses décisions, telle celle de quitter l’homme avec qui elle devait vivre pour retrouver un Algérien, chercheur comme elle, avec qui elle voudrait vivre, et qui ne le pourra pas. Marcel et Aurélie se ressemblent : ils n’aiment pas les cons, ont des rêves de partir, sont critiques des gens et des mœurs de l’île, du « village », et ils aiment être ensemble. « Marcel prenait le bras de sa petite fille, ils laissaient derrière eux les rumeurs de la fête, et les lumières, et ils s’asseyaient un moment près de la fontaine »... Tout se passait ainsi entre eux, peu de mots, des regards attendris, des rêves enfouis qu’ils devinaient pour chacun sans qu’il ait été nécessaire de les dire, de les décrire. Chacun prenait ainsi ses décisions sans qu’il n’ait même été question de décisions à prendre.
Tandis que Matthieu réalise, avec cette gérance d’un BAR, son « rêve immémorial, tandis qu’il saccageait avec une joie sauvage les terres de son passé livré aux flammes » (on le trouve un peu con, stupide, quand même), Libero « avait cessé de rêver depuis longtemps déjà. Il reconnaissait sa défaite et donnait son assentiment, un assentiment douloureux, total, désespéré, à la stupidité du monde ». Des associés si dissemblables, ensemble depuis l’enfance, forment un tandem non identifié, non identifiable.
2/ Des événements, des faits de la vie de tous les jours, des faits d’histoires, des faits de société, des faits de culture, mais aussi de la honte, du racisme de bas étage, de l’amour, du mépris, de la révolte, de la parodie, des espoirs, des rêves, de la crasse, de l’obscénité... Ferrari les montre avec une langue, encore là très imagée, très imaginée, très métaphorisée, avec peu de mots inutiles, et beaucoup de longues phrases dans lesquelles on se plonge avec une sorte de délectation, tant la structure porte bien le propos, tant les variations de phrases et ses descriptions se succèdent avec de légers affleurements et aussi des jaillissements inattendus de mots, de couleurs, de lettres dorées, de pensées fines, de sentiments exacerbés... dont...
Ces meurtres insolites restés insolubles, de soldats italiens isolés, jusqu’à ce que Ange-Marie Ordioni revienne de sa bergerie où il menait avec sa femme « une vie sauvage de chasseur néolithique » chaussé de brodequins italiens.
Ces Sardes que l’on n’aime pas... ce BAR que l’on ne veut pas voir devenir un gay Club, mais aussi ces libérateurs, Maures et Nègres, ces barbares qui « offrent d’abord leurs services à l’Empire avant d’en précipiter la chute et de la détruire ».
Ce coup de téléphone et cette arrivée surprise auprès de Libero et Matthieu, d’une Annie, une serveuse expérimentée, qui allait, en un quart d’heure, après une demi-litre de champagne, trouver Mathieu et Libero adorables et leur dire « c’est l’été, si vous n’êtes pas deux cloches, vous aurez du monde » dans votre BAR.
Ce Matthieu qui ne sait pas s’endormir et qui demande à deux de ses serveuses de bien vouloir l’accepter dans leur lit, parce qu’il n’a plus envie de dormir seul. « Quand il se réveilla, sa tête reposait contre les seins d’Izaskun et l’une de ses mains était posée sur les hanches d’Agnès ».
Cette Virginie à qui Mathieu annonce que son père va mourir et qui lui répond : « Je connais bien la mort. Je suis née veuve ».
Cette France qui est maintenant une terre d’exil pour Aurélie qui vient d’appareiller pour l’Algérie afin de rejoindre cet homme, cet autre qui n’est pas celui avec qui elle devait faire sa vie. Elle rejoint cet homme, Massinissa, elle rejoint ce site exploré de la basilique d’Augustin, là où elle fait des fouilles, - mais les fouilles ne permettront pas de trouver la cathédrale d’Augustin – elle rejoint finalement le vide interculturel, celui de deux mondes qui ne peuvent se rejoindre. Elle vit un amour, aujourd’hui connu, qui ne peut vivre. « Les moments qu’ils partageaient étaient maintenant lourds du poids des regards posés sur eux ». Finalement, sans mots, elle ne lui laissa pas autre chose que son absence. Elle capitula, elle rejoignit sa mère, et rentra d’exil en son autre exil, au « village ».
Ces conversations fantômes entre Matthieu et Judith : Matthieu qui aurait voulu se montrer à Judith tel qu’il était, tel qu’il se rêvait depuis toujours, « mais elle ne le voyait pas. Elle lui parlait comme s’il n’avait pas changé, poursuivant d’anciennes conversations dont il ne comprenait plus le sens »...
Cette subdivision perdue, en Afrique, où Marcel sera nommé, où il ira avec une femme qu’il a mariée suite à un mot de trop, une femme qu’il trouve stupide et qui lui fait honte, et où il essaiera sans cesse « de ne pas laisser s’éteindre le feu de la civilisation », quand il sait bien qu’elle est perdue cette civilisation dans cet immense territoire « dont l’humidité n’était peuplée que d’insectes, de Nègres, de plantes sauvages et de fauves », là où « le drapeau français pendouillait au bout d’une hampe comme une guenille détrempée ».
La chute
« Il n’y avait pas de hordes barbares. Pas de cavalier vandale ou wisigoth. Simplement, Libero ne voulait plus garder le BAR ». Plus simple encore, il n’aimait pas celui qu’il était devenu. Matthieu se sentait trahi.
Fini les même pauvres filles de bar, les mêmes enculés de clients au bar, les ivrognes, les cuites. « C’est un boulot de merde », dit Libero ce soir-là. Matthieu ne le voit pas ainsi.
C’est à ce moment que des clients, ivres évidemment, se mettent à harceler Virgile Odioni, cette grosse carcasse de Corse un peu frustre. Mais il y a mal donne.
« Oh ! Putain ! On rigole ! On l’aime bien, Virgile », dit Pierre-Emmanuel.
Non, on ne l’aime pas, on se moque, chacun le sait, on le moque, « il devait bien avoir une fiancée, en montagne, pour se tenir au chaud l’hiver, une grosse bergère bien pleine de graisse, par exemple, qui sentait la chèvre »... renchérit Pierre-Emmanuel.
Bientôt, la nuit s’allonge, puis se fissure. Des cris parviennent du dehors.
Libero sort. Il voit : c’est Le gros Virgile Ordioni, et sa grosse carcasse de Corse habitant ce « village », qui en a eu marre – la moquerie est allée trop loin - qui est assis sur Pierre-Emmanuel, tout en lui pointant agressivement la lame de son couteau dans l’entrejambe. Pierre Emmanuel hurle à mort, à l’aide... Libero tire sur Virgile qui s’effondre. La voix des ténèbres, la voix du sang avaient parlé ; elles allaient mettre fin à un épisode de la vie des deux diplômés en philosophie de la Sorbonne. Elles scellaient un épisode de vie des gens de ce « village ».
Le sermon sur la chute de Rome
« Aurélie est assise près du lit où repose son grand père ». Marcel peut enfin se laisser aller à ses rêves obscurs d’agonisant, il sait qu’Aurélie guette avec lui la mort qui vient, il sait que son pauvre corps n’est plus qu’une chair desséchée. Aurélie ne lâche pas sa main. Marcel sait qu’il ne regardera plus cette photo de 1918, là où il était absent ; il sait aussi qu’il ne sait pas ce que sont en vérité les mondes, mais il sait, comme il a cette sensation maintenant, que l’homme peut guetter les signes de la fin des mondes.
Tout comme Augustin les vit, ces signes, à l’approche de l’invasion de sa ville d’Hippone par les Vandales, lorsque, lui aussi, fit ce sermon sur la chute de Rome à son paroissien...
« Depuis quand crois-tu que les hommes ont le pouvoir de bâtir des choses éternelles ? L’homme bâtit sur du sable ».
Rome était déjà tombée sous les hordes barbares, Hippone suivrait. La course du monde est évidente, elle mène vers la fin de ce monde, mais cette fin n’est pas encore atteinte.
C’est sans doute ce que Marcel, à la fin de son cycle de vie à lui, se disait ; ce monde continue de mourir. Mais Aurélie veillait sur lui, comme sans doute cette femme qu’Augustin, avait entrevue lors de son sermon et qui lui souriait toujours en rêve, vingt ans plu tard, au moment de mourir. C’est ce qu’écrit Ferrari, imaginant qu’Augustin, couché et agonisant, ne revoit que « l’étrange sourire mouillé de larmes que lui a jadis offert la candeur d’une jeune femme inconnue, pour porter devant lui témoignage de la fin, en même temps que des origines, car c’est un seul et même témoignage ».
Je peux imaginer que le message de Ferrari est simple : le monde meurt, et va continuer de mourir. Le voyage que nous faisons à travers ce livre sur la reprise d’un BAR en Corse par deux diplômés en philosophie de la Sorbonne livre aussi un autre message assez simple et qui est transcendant : Ferrari décrit des aspirations humaines assez simples, dans un milieu simple, avec des acteurs simples... mais il livre aussi des aspirations humaines plus complexes, difficiles à déchiffrer, sinon des rêves, des mondes imaginés, des mondes exaltés, parfois noirs, lugubres, des mondes critiqués parce que pervertis par l’argent, le marché, le capital. Comment comprendre, comment élucider où le monde va ? Ferrari présente des acteurs, des faits de vie, des phénomènes qui surviennent au quotidien ; il nous laisse nous imaginer où tout cela nous mène.
L’écriture, la langue de Ferrari, méritent le prix littéraire qui a été accordé à ce livre. Et pour moi, cela va au-delà du fait littéraire, et je crois bien qu’il ne peut en être autrement pour tout livre de qualité, j’entends : ce livre mérite une deuxième lecture, une troisième lecture, et je ne parle pas ici d’une lecture au deuxième degré, mais d’une lecture plus sensible, plus attentive ; et par là, je crois bien que le livre apportera à chaque nouvelle lecture, un nouveau message, sinon un message plus fin, renouvelé.
J’écrivais plus haut que je n’avais aucune idée de ce pays, la Corse. Je ne sais pas si cette lecture m’y a introduit ; j’aime penser que si, mais je ne sais pas pour sûr.
Mais j’ai une idée du monde où je vis, je l’exprime dans mon blog, et celle-ci s’est renforcée. Le philosophe Ferrari la montre bien dans cette histoire de BAR, pourtant banale : le monde continue de mourir et cela ne va pas s’arrêter. Les signes sont là.
Comme à Rome, en 410 de notre ère.

Il n’y a pas – à l’encontre de ce que pense Virgile - d’empire sans fin : Augustin lui opposait la parole évangélique : « Le ciel et la terre passeront » (Mt 24, 35).
Il n’y a pas non plus d’homme sans fin, peut-on imaginer ; il passe, vit et trépasse, certes, mais les passages se renouvellent, d’autres hommes viennent... mais jusque s’à quand ?
