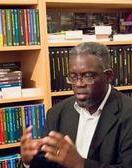A l'occasion de la cérémonie de cloture de la 4ème édition du Festival Nollywood week à Paris, j'ai pu voir un film étonnant, fort au niveau du traitement d'un sujet que je ne connais : la fistule qui frappe de nombreuses femmes dans les pays du Tiers Monde. Dry, un film de la comédienne et actrice nigériane Stéphanie Okéréké-Linus.
A l'occasion de la cérémonie de cloture de la 4ème édition du Festival Nollywood week à Paris, j'ai pu voir un film étonnant, fort au niveau du traitement d'un sujet que je ne connais : la fistule qui frappe de nombreuses femmes dans les pays du Tiers Monde. Dry, un film de la comédienne et actrice nigériane Stéphanie Okéréké-Linus.De Stéphanie Okereke, même pour ceux qui ne sont pas voyeurs, il y a en peu qui ont loupé son mariage grandiose célébré quelque part dans un grand manoir en Grande-Bretagne et mis en ligne sur les réseaux sociaux. A l’époque, pour le francophone que je suis, on expliquait que c’était le mariage d’une grande comédienne de Nollywood. Il est bon de rappeler ce type de détails qui construisent le regard qu’on peut porter sur une œuvre artistique. Dry est un film réalisé par Stéphanie Okereke. Elle y joue en même temps le rôle principal, à savoir celui de Zara, une gynécologue-obstétricienne basée au Pays de Galles. Une femme accomplie, reconnue dans sa profession, impliquée dans un couple mixte heureux. Elle est la fille adoptive d’une britannique très engagée dans les ONG accompagnant de nombreuses femmes dans le Tiers monde sur des problèmes de santé.
Dr Zara se tient à distance de tout ce qui touche à l’Afrique. Elle suit de loin les expéditions de sa mère sur le continent Africain, refuse les propositions des partenaires financiers de l’hôpital où elle travaille pour aller encadrer des programmes d’aide et des projets de santé en Afrique. Tout de suite, le spectateur est placé face à cette rupture entre une africaine et la terre de ses origines. Même si cela est dit en biais, les occidentaux avec lesquels elle travaille, ne comprennent pas son positionnement.
Pourquoi les gens partent ? Pour quelles raisons se tiennent-ils à distance de la terre de départ?Par une succession de flashbacks, Stephanie Okereke entrecoupe l’évolution de son personnage central par une autre histoire qui se déroule au nord du Nigeria, du côté de Katsina. Celle d’Halima, une adolescente à peine pubère mariée sans son contentement à un homme qui pourrait être son grand-père. Un rôle remarquablement joué par Zubaïda Ibrahim. Le choc entre la modernité et des organisations monolithes ancestrales qui sous certains aspects sont choquantes et censées être obsolètes. Ma grand-mère a été mariée entre 13 et 14 ans. Est-ce que cela est aujourd’hui est-il simplement envisageable ? Non ! Pour celui qui pourrait en douter, Stéphanie Okereke met en scène toute la violence et l’ignominie de la chose. En parallèle, disons-le clairement, la réalisatrice dresse un portrait des sociétés féminines de cette région du Nigéria (qui pourra être étendu à une sphère plus large) qui est simplement terrifiant. Si les hommes dans ce modèle patriarcal sont les bénéficiaires absolus de cette mascarade, la posture des femmes est celui de gardiennes de ce modèle social. Elles peuvent se montrer particulièrement cruelles. Entre nous, certaines spectatrices qui regarderont ce film vont détester leurs belles-mères. Halima est enceinte trop tôt et l’accouchement à la maison se passe très mal du fait de l’incompétence dela sage-femme traditionnelle. L’enfant décède et Halima est atteinte d’une fistule vésico-vaginale.Vous avez dit fistule ?Alors que Dr Zara rentre au Nigeria pour accompagner des projets de santé autour des conditions d’accouchement des femmes en milieu rural et périurbain, Halima subit les conséquences de la fistule. Elle est atteinte d’une incontinence chronique qui va être diversement interprétée par l’entourage. C’est l’amorce d’une terrifiante descente aux enfers. Intelligemment, la réalisatrice nigériane souligne comment les croyances magico-religieuses constituent un recours efficace pour justifier l’irresponsabilité collective et se racheter une bonne conscience. Elle révèle aussi une forme d'impuissance de l'entourage d'Halima. On s’attache à cet aspect du film avec tout le malaise qu’il nous impose : Des « Halima » sont nombreuses sur le continent. Et la violence de cette société rurale se traduit par le bannissement manu militari de ce petit bout de femme. Cette violence se construit sur l’ignorance et un refus de questionner les modèles d’organisation.Structurellement parlant, le film est difficile à suivre. Il y a réellement plusieurs lièvres à suivre. L’histoire d’Halima. Celle de la gynécologue obstétricienne. Certaines longueurs auraient pu être épargnées au spectateur sans que le sujet ne perde en densité. Le parcours de ce médecin nous met face à la réalité du terrain, l’insouciance affligeante des pouvoirs publics. Assis dans mon fauteuil, le jugement est facile, mais Stéphanie Okereke met en scène une réalité tellement criarde…Dry et ses à-côtés
Assise à côté de moi, une jeune femme Nigériane pleure en plein film. Derrière moi, certaines scènes font écho et suscitent de bruyantes réactions. Les films nigérians ont cette particularité de toucher leur cible. Je ne peux pas manquer de vous dire que la charmante demoiselle à mes côtés avait entrepris d’enregistrer tout le film avec son smart-phone. Le saint qui régit les droits d’auteurs doit exister puisque sa batterie de son portable est tombée en rade. Ou peut-être a-t-elle eu une crampe… Pour revenir au film, je ne vous révèlerai pas le final. Stéphanie Okereke offre une piste de réflexion très intéressante sur un sujet que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve. La jeune actrice Zubaïda Ibrahim joue remarquablement bien son rôle. Un bon film qui a suscité de très nombreuses réactions dans la salle.