Je ne sais pas si Google nous rend idiots, ou si j’ai changé mes habitudes de lecture avec le temps (et mes goûts ?). Le fait est que je ne termine pas un roman sur deux. Voilà, c’est dit. Je lis environ les deux tiers, et puis je passe à un autre livre. Ça m’arrive même avec des livres qui m’ont plu et que j’ai chroniqué sur le blog, mais… Au bout d’un moment, mon intérêt pour l’histoire n’est plus assez fort pour que je continue à en suivre le fil. Souvent il s’agit d’histoires touffues, avec plein de personnages, et des situations qui se succèdent à un bon rythme. C’est ce que j’appellerais des romans-loukoums, délicieux mais un poil trop sucrés, et écœurants sur la fin. J’avoue cependant que cela m’arrive aussi avec des livres assez exigeants (comme Virginia Woolf, hem). Bref, j’ai décidé d’être honnête sur ce point à partir de maintenant. Comme vous pouvez le deviner, ça m’est arrivé avec « Middlesex » de Jeffrey Eugenides. En même temps, je me demande si je ne l’ai pas lâché parce qu’il fait partie d’un (trop) grand lot de livres tentateurs que j’ai emprunté à la bibliothèque et que je dois rendre pour dans deux semaines (c’est sûr, je n’arriverai pas à tous les lire dans ce laps de temps, mais je crois que j’ai voulu maximiser mes lectures !).
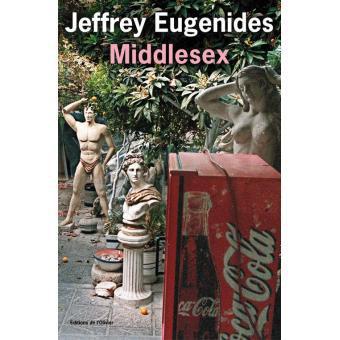
J’ai parfois pensé à cette comédie hollywoodienne que j’avais tellement aimée quand j’étais adolescente « Mariage à la grecque« . La référence au cinéma n’est d’ailleurs pas anodine. Eugenides a un vrai don de la mise en scène et de la formule : avec des images très visuelles et panoramiques il nous fait traverser l’histoire de cette famille qui traverse aussi le XXe siècle américain, depuis l’industrieuse ville de Detroit, la fameuse « Motor Town » et sa ségrégation raciale explosive. Ainsi, la transmission des gènes de la famille de génération en génération ressemble à une formidable course-marathon, avec comme point d’arrivée la naissance de la petite Callie en 1960. Certains passages sur les relations familiales, le rapport à la religion, la vie d’immigré, les situations inénarrables dans lesquelles se retrouvent les personnages (Desdemona travaillant pour la « nation de l’islam » par exemple) m’ont franchement fait glousser. D’autres passages sont beaucoup plus graves : le massacre des Grecs de Smyrne sous les yeux impassibles des Français et des Anglais est d’autant plus tragique qu’il est raconté de façon très extérieure, avec des zooms sur certains personnages par moments, et une grande économie de moyens. L’un des morceaux de bravoure est aussi la description du travail à la chaîne dans les usines Ford : on se croirait projeté dans le film « Les temps modernes » de Chaplin, avec l’emballement des phrases, le regard très mobile suivant les différentes phases de la construction d’une voiture, et la répétition lancinante de la même phrase à intervalles réguliers : « Wierzbicki fraise un palier et Stephanides meule un palier et O’Malley fixe un palier à un arbre à cames ».
Bref, un bon roman, original, fouillé, que j’ai pourtant arrêté au moment de l’entrée dans l’adolescence de Callie. Je crois que le narrateur (Cal, qui parle à la première personne et intervient régulièrement pour donner son avis), insiste tellement sur la transformation qu’il va connaître à la puberté que ma curiosité s’est estompée. J’ai juste lu les 20 pages de fin pour savoir comment tout ça finissait (un peu mollement, faut-il le dire, malgré une course-poursuite complètement barrée).
Je remercie quand même Titine qui m’a donné envie de connaître cet auteur en commençant par ce titre, lors du mois américain. ;-)

