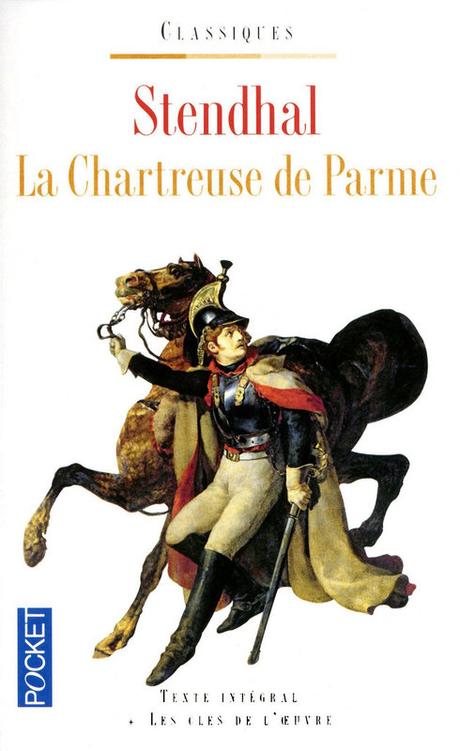
« Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur. »
C’est par cet incipit plein de panache que commence La Chartreuse, et nous savons dès lors que la narration de Stendhal va adopter le rythme entraînant des victoires napoléoniennes et chanter les louanges de la bravoure, la jeunesse et la beauté. Ce sont en effet toutes les valeurs de l’auteur que porte ce grand roman classique : amour, gloire et beauté, mais aussi une certaine idée du bonheur en Italie.
Rendue à la page 200 très exactement (sur les 534 que compte mon édition poche), je vais tenter de résumer l’histoire pleine de tours et de détours que prend le roman jusque là, ce qui n’est pas une mince affaire :
En 1796, la Lombardie conquise par les Français ressemble à une femme sensuelle, longtemps assoupie dans la pesanteur de l’administration autrichienne, qu’un jeune amant fougueux aurait brutalement réveillée. Les victoires militaires et amoureuses sont en effet toutes entrelacées et Stendhal prend clairement parti pour les Français et le peuple italien en plein « réveil », contre les notables réactionnaires symbolisés par le ridicule et engoncé marquis del Dongo.

C’est dans ce contexte de ferveur patriotique et de communion autour de la joie et la liberté (Stendhal aura pris soin d’embellir l’occupation française, qui a l’air de n’être qu’une longue fête du début jusqu’à la fin) que naît le fils cadet du marquis del Dongo, notre héros, Fabriiiiice (OK, je m’égare !). S’il n’a pas l’estime de son père, il jouit en revanche des faveurs de la nature (il est beau et brave contrairement à son frère aîné Ascagne qui est le portrait de son père – ce qui laisse d’ailleurs présumer une naissance illégitime de Fabrice probablement liée aux relations chaleureuses entretenues par la marquise del Dongo avec un officier français, le lieutenant Robert, au début de l’occupation) (ce n’est pas moi qui le dit, c’est Pierre-Louis Rey, le commentateur du texte). Il est donc le chouchou des dames de la maisonnée – sa mère, sa tante, ses sœurs – une maisonnée qui gîte entre Milan et la rive magnifique du lac de Côme (passages extatiques de Stendhal sur cet endroit pour qui c’est le plus beau du monde).
Les choses se corsent, si l’on peut dire, lorsque Fabrice, à l’âge tendre de 16 ans, part à la rescousse du Corse revenu de l’île d’Elbe et confronté à toute l’Europe lors de la bataille de Waterloo. Sacrilège pour papa del Dongo et son fils aîné ! Geste admirable pour toute la gent féminine qui prend le parti exactement inverse du prétendu chef de la maisonnée ! Stendhal montre décidément beaucoup de sympathie pour les dames, qu’il semble considérer comme plus libérales que leurs compagnons.
Bon, il faut le savoir, tout le chapitre sur les aventures de Fabrice à Waterloo est devenu cultissime – du moins à l’échelle des amateurs de Stendhal – car il a marqué l’histoire littéraire : pour la première fois un romancier décrivait la guerre « au ras des pâquerettes » en adoptant le point de vue d’un simple soldat, presque un quidam, qui ne comprend rien aux mouvements des armées et qui s’effraie de l’aspect particulièrement rebutant des cadavres jonchant le champ de bataille. Bienvenue dans la guerre moderne. Mais je dois dire que ce passage m’a aussi souvent fait rire car Stendhal ne se prive pas de souligner la naïveté du jeune Fabrice qui part bille en tête, persuadé qu’il va directement servir l’empereur (en fait il ne le voit même pas) et qui se fait emprisonner par des gendarmes français qui le prennent pour un traître, vu son fâcheux accent italien. Il se fait sans arrêt voler son cheval par des hussards ou autres dragons, voire par un général aux trousses duquel il se met à courir en criant « au voleur ! », ce qui est totalement bouffon, mais il dispose heureusement de l’aide d’une généreuse cantinière (encore une fois, honneur aux dames).
Fabrice arrive à sortir de ce bourbier sans avoir combattu (si, il a quand même abattu « son » Prussien comme s’il était à la chasse sur ses terres) mais son retour à la maison se révèle plus compliqué que prévu : parti sous un faux nom, son départ a quand même été dénoncé aux autorités autrichiennes qui ont repris le contrôle du nord de l’Italie, et son père le désavoue. Clandestinement, son pool de soutien féminin familial le fait « exfiltrer », et voilà notre Fabrice parti faire des études ecclésiastiques à Naples. Ah oui, parce qu’il faut dire qu’entre temps, sa jeune tante Gina, qui l’aime tellement, est devenue veuve (son mari, le comte de Pietranera a été assassiné au retour des Autrichiens car il était pro-français). Quel est le rapport ? Eh bien, pauvre mais très considérée dans la haute société milanaise, d’autant qu’elle est très belle, elle se fait courtiser par de très beaux partis, qu’elle rejette dédaigneusement. Mais arrive le comte Mosca, le super-ministre de la minuscule cour de Parme (ou règne une sorte d’Ubu roi absolutiste) et voici que ce dernier parvient à conquérir la belle. Sauf qu’il ne peut l’épouser car il est déjà marié. Qu’à cela ne tienne, il s’arrange avec le vieux duc de Sanseverina, riche à millions, qui accepte d’épouser Gina tout en la laissant entièrement libre de ses faits et gestes (un bon deal, et fort pratique pour l’histoire qui va suivre).
Bref, nous arrivons enfin à Parme, ce qui justifie la 2e partie du titre du roman. Gina est devenue « la » Sanseverina, et la coqueluche de la cour de Parme même si elle y a quelques ennemis (bizarrement, le clan « libéral »). Elle obtient pour Fabrice une bonne carrière ecclésiastique et la promesse de succéder un jour au vieil archevêque de la ville. Ça ne plaît que moyennement à notre Fabrice de 20 ans, ivre de conquêtes, mais bon, il n’a pas tellement le choix, dans sa condition de persona non grata à Milan. Le hic, c’est que ce vieux beau de comte Mosca, valet de cœur de la Sanseverina mais tout puissant premier ministre, se rend compte que les sentiments de sa maîtresse pour son neveu se font de plus en plus tendre, et il devient… jaloux ! Ouh c’est vilain. Je laisse peser le suspense de savoir s’il arrive à retenir sa fureur ou pas…
Voilà pour l’instant. Je crois que mon résumé donne l’impression d’un vrai feuilleton. Et il y a un peu de ça en effet : il y a d’un côté les « beautiful people » qui malgré les déboires s’en sortent toujours, de l’autre les méchants, les traîtres, il y a le vieux sage (l’abbé Blanés) et puis les faire-valoir… Les relations se nouent et se dénouent, semblent évoluer rapidement. On n’est pas du tout dans le roman bourgeois naturaliste. Pas tellement non plus dans le roman romantique. Les personnages sont peu décrits physiquement et leur portrait psychologique nous échappe en partie. Par exemple, je ne sais trop quoi penser du comte Mosca. On dirait que Stendhal a voulu, à travers lui, tenir ensemble des aspects contradictoires pour les besoins de son histoire : à la fois premier ministre appliquant rigoureusement la loi despotique d’un roi paranoïaque (ce qui explique la position proéminente tenue par sa maîtresse à la cour et toutes les intrigues qui s’ensuivent, mais permet aussi à Stendhal de fustiger l’absolutisme qu’il abhorre mais semble aussi le fasciner), Mosca a néanmoins un esprit libéral (!) et désabusé, prêt à tout laisser tomber pour passer une retraite dorée avec l’amour de sa vie (afin de rendre un minimum crédible sa liaison avec la jeune, belle et libérale Gina). J’ai un peu du mal à croire à son personnage, je l’avoue. Je ne connais pas grand chose à l’histoire littéraire mais j’ai l’impression que Stendhal est encore un peu un homme du XVIIIe siècle, adepte de la mentalité de cour et de ses intrigues, dont les ressorts nous semblent un peu vains, à nous hommes et femmes du XXIe siècle.
J’aime me plonger dans ce classique car la langue est pure, les anecdotes piquantes et les aperçus de l’Italie de l’époque, directement issus des souvenirs de Stendhal, sont savoureux. J’aime aussi le fait que la lecture de la Chartreuse ait donné envie à Proust de visiter Parme (ce qu’il n’a jamais fait) car il trouvait que le nom de Parme était « compact, mauve et doux ». Mais j’avoue que je décroche un peu de l’histoire par moments, notamment pour tout ce qui a trait aux mille et un aléas de la vie de cour. Je n’arrive pas non plus à saisir tout le sens de la cour utilitaire que Fabrice fait à certaines femmes, même si je comprends qu’il s’agit, pour l’une d’entre elle, de faire dévier la jalousie de Mosca, qui le croit prêt à outrepasser la barrière des bonnes mœurs avec sa tante. Pourtant notre Fabrice n’a pas encore connu le grand amour, même s’il aime beaucoup sa tante, et il se croit imperméable à la passion… mais je crois que ça va changer lorsque les choses se compliqueront pour lui à Parme… Donc j’ai hâte qu’il soit emprisonné (oui je m’avance un peu sur la suite) et qu’il sorte de l’hypocrisie de la cour dans tous les sens du terme.
RDV le mois prochain pour la suite !
« La chartreuse de Parme » de Stendhal, Pocket Classiques, édition présentée et commentée par Pierre-Louis Rey, 1998, 570 p.



