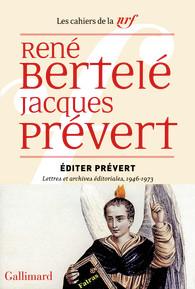 Plus jeune, j’avais tendance à considérer Prévert comme un piètre poète, et comme le pire dialoguiste (avec Michel Audiard) du cinéma français, et je me rappelle m’être déchaîné, comme un jeune homme en colère, lors de la parution en Pléiade de ses Œuvres complètes. Mais le temps passe, on vieillit, on devient moins sévère – et, depuis, la Pléiade, de Boris Vian à Jean d’Ormesson, en passant par Milan Kundera, Tournier, Pérec, en a vu d’autres : Prévert, tout compte fait, a au moins pour lui de « faire partie de la ménagerie » (ainsi qu’aurait dit Jean Anouilh des hommes nés pour le théâtre). Trente ans après, Prévert et sa figure d’anarchiste bonhomme appartiennent au paysage littéraire français du XXe siècle, au même titre que celles de Mac Orlan, ou d’Henri Calet – écrivains indubitablement plus doués, mais auxquels la « postérité » a réservé le même type de niche, discrète, marginale, sympathique, dans l’abside réservée aux bons auteurs de second rayon. On attend simplement que Calet et Mac Orlan le rejoignent sur papier bible.
Plus jeune, j’avais tendance à considérer Prévert comme un piètre poète, et comme le pire dialoguiste (avec Michel Audiard) du cinéma français, et je me rappelle m’être déchaîné, comme un jeune homme en colère, lors de la parution en Pléiade de ses Œuvres complètes. Mais le temps passe, on vieillit, on devient moins sévère – et, depuis, la Pléiade, de Boris Vian à Jean d’Ormesson, en passant par Milan Kundera, Tournier, Pérec, en a vu d’autres : Prévert, tout compte fait, a au moins pour lui de « faire partie de la ménagerie » (ainsi qu’aurait dit Jean Anouilh des hommes nés pour le théâtre). Trente ans après, Prévert et sa figure d’anarchiste bonhomme appartiennent au paysage littéraire français du XXe siècle, au même titre que celles de Mac Orlan, ou d’Henri Calet – écrivains indubitablement plus doués, mais auxquels la « postérité » a réservé le même type de niche, discrète, marginale, sympathique, dans l’abside réservée aux bons auteurs de second rayon. On attend simplement que Calet et Mac Orlan le rejoignent sur papier bible.
En attendant, Gallimard a la bonne idée de publier un choix de scénarios inédits, et un énorme volume, parfaitement édité, élégamment illustré, de sa correspondance avec René Bertelé, qui fut son véritable découvreur et qui, après avoir publié Paroles, à ses éditions du Point du jour, deviendra chez Gallimard l’éditeur de la collection du même nom, où il continuera à être l’interlocuteur privilégié (voire le seul) du poète fantasque et musardant, toujours rétif à constituer des recueils à partir de ses textes épars. Ce volume, Éditer Prévert, est passionnant.
On y lit le roman d’une amitié (qui se double, de la part de Bertelé, d’une véritable dévotion mâtinée d’une infinie patience), et on y voit les coulisses d’une collaboration éditoriale qui a donné naissance à une œuvre mineure, certes, mais qui, avec sa légèreté affichée (avec Prévert, on est loin des vaines pompes de René Char), n’en est pas moins respectable, et l’une des plus lues de la deuxième moitié du XXe siècle. Et, l’âge venant, on en vient à être reconnaissant à Prévert, ou à Boris Vian, d’avoir amené à la littérature des adolescents qui, sinon, n’auraient jamais ouvert un livre. À l’ère des tablettes omniprésentes, ils font figure de vieux sages, des derniers représentants d’un temps révolu.
L’œuvre de Prévert n’est pas celle d’un grand poète, mais celle d’un touche-à-tout plutôt doué, pour qui une chanson n’était pas moins importante qu’un poème. Et suffisamment doué pour disperser son talent dans des activités de dilettante, pour qui l’« œuvre » à réaliser comptait moins que le plaisir pris à la fabriquer, sur un coin de table, au hasard de l’inspiration du moment, ou d’une commande.
« Fabriquer », le terme me semble juste, car, autant qu’un poète, Prévert était un adepte des collages, et son œuvre graphique, dont de multiples exemples illustrent le volume publié aujourd’hui, compte autant que son œuvre littéraire et fait de lui un des plus purs représentants du surréalisme authentique, rejetant la notion d’école au profit de la marginalité et de la liberté vécues comme un absolu. À la découverte de ses collages, on a la même impression que, l’an passé, on avait eue en lisant, rassemblés et préfacés par Grégory Cingal (qui, depuis, avec le Revers de mes rêves, a donné le meilleur livre français de l’année), les écrits épars de son ami (et compagnon du groupe Octobre) Jacques Brunius : pour l’un comme pour l’autre, la fantaisie et le plaisir comptaient plus que les contrats et la reconnaissance du public « sérieux ».
Cette correspondance de Prévert avec son éditeur révèle un homme attachant, préoccupé de l’essentiel (ce devait être un ami parfait – Arletty l’a assez dit, qui avait l’œil juste), soucieux du quotidien (les soucis d’argent) mais sans en faire une montagne, et avant tout préoccupé de rester lui-même.

Mais lorsque le metteur en scène était plus malléable, et que les acteurs savaient « dire Prévert », il ne fait aucun doute que la réussite est là. Les Enfants du paradis ou Drôle de drame ne sont certes pas les plus grands films français, mais leur magie, indéniable, existe, qui tient autant au texte de Prévert qu’à l’interprétation d’Arletty, de Michel Simon, de Pierre Brasseur ou de Jouvet (Carné, je suis peut-être injuste, se contente de les mettre en images, assez platement). Et Quai des Brumes ou Le jour se lève ne sont pas si mal, même si on sent que Prévert, la bride sur le cou, se laisse aller à un penchant coupable pour un romantisme populaire qui a aujourd’hui bien vieilli. Évidemment, il lui est arrivé de se caricaturer: les Visiteurs du soir et sa philosophie de bazar est grotesque, malgré Arletty et Jules Berry, et les Portes de la nuit, affligé de surcroît par la calamiteuse interprétation d’Yves Montand, est inregardable.
Peu importe : il faut lire les scénarios de Prévert comme des œuvres littéraires en soi, dont certaines ont été, avec plus ou moins de bonheur, adaptées au cinéma. On voit alors se dessiner, en dehors des images, une œuvre de mots, qui, au même titre que celle de grands dramaturges, appartient, avec ses pleins et ses déliés, à la littérature française. Il est toujours temps de redécouvrir Prévert : ce n’est pas une surprise mirobolante, mais, en un temps de médiocrité généralisée, un plaisir fugace.
Christophe Mercier
René Bertelé et Jacques Prévert, Editer Prévert Gallimard, 510 pages, 32 € Jacques Prévert, Cinéma : scénarios inédits Folio Gallimard, 390 pages.
Tweet
