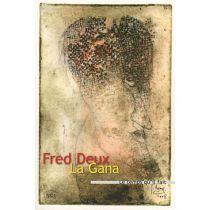 Lire La Gana, c’est avant tout, le vouloir. 950 pages en tout petit caractère. Le livre n’est pas « confortable » ni dans la forme ni dans le fond. Il ne s’adresse pas à tout le monde. Il s’adresse à qui veut bien voir et à qui a le cœur bien accroché.
Lire La Gana, c’est avant tout, le vouloir. 950 pages en tout petit caractère. Le livre n’est pas « confortable » ni dans la forme ni dans le fond. Il ne s’adresse pas à tout le monde. Il s’adresse à qui veut bien voir et à qui a le cœur bien accroché.
La Gana, c’est le récit romancé de l’enfance de Fred Deux, autrement nommé Jean Douassot, artiste peintre et écrivain né en 1924 et décédé en 2015. Il a traversé le siècle et lorsqu’il publie La Gana en 1958, il a 34 ans – seulement ! Car il faut la lucidité d’un vieux monsieur pour écrire un bouquin pareil. On y suit le quotidien d’un enfant qui a plus ou moins 10 à 15 ans selon les moments du récit. Il vit dans une cave avec ses parents et sa grand-mère maternelle. De temps en temps, il va à l’école. Le plus souvent il écoute l’oncle que beaucoup croient fou. Tous se tuent à la tâche à l’usine, à la laverie, sur les trottoirs, de vols à l’étalage. De tout ce que la vie voudra bien leur laisser en sursis. Et c’est la tête dans le guidon, un jour après l’autre que l’on avance ou piétine à la suite du mouflet, en quête d’un bol d’air, d’une évasion. 950 pages condensées, cadenassées, compactées. Aucun avenir, peu d’espoir. Pas de fenêtre. Seulement les eaux qui remontent des égouts sous la table de la cuisine certains hivers, les rats qui fuient. Pour rêver d’autre chose, encore faut-il avoir l’intuition qu’autre chose est possible.
Alors voilà, La Gana marque son lecteur, le courageux qui osera s’y plonger et y rester des semaines durant, dans ce marasme sans fond. Dans cette misère sans misérabilisme, la lucidité est de mise, le sens rationnel frise le plus souvent avec la folie, la mort, les corps fatigués. Des plaintes, si peu. Des lâchetés, aussi. De l’amour, peut-être bien. Je crois sincèrement que cette plongée dans les bas-fonds parisiens de l’entre-deux guerres est une expérience nécessaire. De celles qui aident à penser l’humain et le voir tel qu’il est.
Le langage de Fred Deux fait preuve d’un tel réalisme, d’une telle lucidité, d’une telle capacité à rendre ces émotions compressées et si rarement exprimées verbalement que je ne peux qu’être séduite par ce mélange de fiction et d’éléments biographiques qui recomposent une vérité qu’aucun documentaire, qu’aucun roman conçu pour l’évasion n’aurait pu transmettre.
La première page pour vous mettre gentiment dans le bain :
Publicités &b; &b;« – Regarde toujours ton nombril et dis-moi ce que tu en penses, me demandait mon oncle.
L’oncle, frère du père, était dans la grande lignée de la famille. Comme les princes, il portait une cloche sur la tête et traînait toujours derrière lui un parfum violent.
Né sous un jour qui devait être aussi le mien plus tard, il n’avait pas d’autres amis que son frère, ma mère et moi.
Célibataire, très peu aimé des hommes, il passait sa vie à tirer ce qu’il pouvait d’elle.
Cela ne l’empêchait pas de tirer sur du vide et d’être toujours au bord du désespoir. il ne se rendait pas toujours compte qu’il vivait et c’était mon père qui devait discrètement le lui rappeler. Il est curieux de voir combien les gens peu causants se montrent discrets avec certains êtres. C’était le cas des deux frères. L’un, le père, devait, s’il voulait tenir un peu plus longtemps, déjouer tous les pièges, lorsqu’on veut vivre, même misérablement.
Surtout misérablement.
Le passe-temps favori de l’oncle était de regarder son nombril. ç’aurait pu être révoltant pour mon père qui n’avait pas un instant à lui pour ce genre de méditation. Il aurait pu aussi bien éloigner ce contemplateur d’une famille qui n’avait déjà que trop d’emmerdements à se caler une nourriture difficile à ramasser. Il aurait pu l’éloigner de moi. Le prétexte de l’exemple aurait suffi. Pourtant, j’eus l’impression que, loin de l’éloigner, il le retint avec nous et jamais avec un sentiment de pitié. »
