Ouais c'est ça reste underground
Dessous tu es, dessous tu resteras
IAM
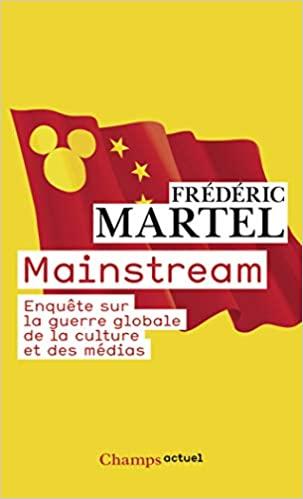
Le monde est en train de devenir mainstream et l’Afrique n’a pas intérêt à rester underground.
Frédéric Martel publie Mainstream pour la première fois en 2010 avec un sous-titre définition : Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. En effet, « mainstream » renvoie à ce qui plait au plus grand nombre en matière de culture, de politique ou de tout autre domaine. C’est cette capacité à être véritablement grand public qui caractérise le mainstream. Dès lors, les oppositions de type élite / populaire, culture / divertissement, littérature / paralittérature ne sont plus pertinentes. Ainsi, un film art et essai peut devenir mainstream, là où un autre pensé pour être un blockbuster peut faire un flop.
Le livre est réédité en 2011 avec un sous-titre plus racoleur : Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias. La version présentée ici est l’édition 2020. Le sous-titre n’a pas changé, mais le livre est augmenté d’une préface qui revient sur le projet de Frédéric Martel et rappelle, opportunément, que Mainstream fait partie d’une trilogie commencée avec De la culture en Amérique (Gallimard, 2006) et close avec Smart (Stock, 2014).
Frédéric Martel ne s’en cache pas, le livre est pensé pour être lui-même mainstream : « Enfin, j’ai voulu écrire cet ouvrage sur l’entertainment de manière “divertissante” – en écho avec le sujet même du livre. » (53). L’écriture est simple, sans fioritures. Le ton se situe entre l’académique – c’est un travail sérieux – et l’oral – c’est accessible à tous. On lit sans dictionnaire : les quelques termes techniques sont immédiatement expliqués sans passer par la note de bas de page. D’ailleurs, il n’y en a guère dans le livre, les notes sont hors texte, sur le site Internet de l’auteur. Tout est mis en œuvre pour que Mainstream soit « easy », bon public. Les bons mots égayent la lecture reposant souvent sur des phénomènes d’écho. À titre d’exemple, on peut lire à la page 173, « Il fait venir un serveur et choisit un jus de tomate ». Il faut se souvenir de la page 170 pour comprendre la blague.
Mainstream, malgré ses 600 pages se lit donc bien et est utile à quiconque s’intéresse à « cette culture qui plait à tout le monde » ou à la « guerre globale de la culture et des médias ».
États-Unis
« L’entertainment américain », la première partie de Mainstream, plus de 280 pages, soit la moitié du livre, est consacrée aux États-Unis. Cela se comprend : c’est à partir de l’Amérique que le mainstream est devenu canonique. Le pays a d’abord fait de la culture un phénomène de masse, en rendant la musique, le film, le livre ou encore le jeu vidéo accessibles à tous les Américains.
Les premiers chapitres reviennent sur la manière dont les industries créatives se sont développées et imposées dans le paysage au point de devenir incontournables dans l’économie globale. Elles sont, en termes d’exportation, deuxième, derrière l’aérospatial (69). Mais avant de partir à la conquête du marché mondial, ces industries ont d’abord dû conquérir les Américains. Dans le monde du cinéma, par exemple, cela passe par des infrastructures solides et accueillantes dans le sens où elles s’adaptent aux besoins du public. On a ainsi progressivement abandonné les drive-in en plein air pour des multiplex à l’abri des grands centres commerciaux. Cela passe aussi par la diversification des offres. Les grands studios laissent habilement les artistes jouir d’une grande liberté de création. De plus, loin de faire la guerre aux studios indépendants, ils les financent, voire les créent. Cela passe encore par une organisation sans faille et de puissants lobbies. La Motion Picture Association of America (MPAA), gère Hollywood, finance les campagnes présidentielles des Républicains comme des Démocrates, se baptise opportunément MPA à l’étranger pour mieux passer pour l’ambassadrice du cinéma et non de l’Amérique.
Les industries de la musique, du livre et autres sont tout aussi pragmatiques. En conséquence, elles gagnent un public de plus en plus nombreux. Pour tout arranger, le discours critique valide le mainstream et en est fait le nouveau canon.
Dans le chapitre 7, « Pauline, Tina & Oprah », Frédéric Martel revient sur la manière dont des critiques artistiques de renommée ont imposé la culture populaire aux élites. Pauline Kael a réussi à introduire le cinéma mainstream dans les pages du New Yorker en écrivant, de manière sérieuse, des critiques sur des films jusqu’alors jugés peu sérieux. De plus, elle tient compte, dans son travail, des gouts du public qu’elle anoblit par la même occasion. Ailleurs, Oprah Winfrey, parvient, grâce au succès de ses talk-shows à faire vendre plus de livres que le Goncourt, et parle aussi bien des Gallimard que des Harlequin. Quant à Tina Brown, elle transforme complètement la manière de faire des magazines. Elle propose, par exemple, des analyses de vidéoclips dans le New Yorker. Ce dernier finit par créer le « Department of Popular Culture », une chronique réservée donc à la culture de masse (234). D’autres revues d’envergure suivent. Avec ce type de critiques, on ne distingue plus entre l’élite et le populaire mais entre le « hot » (cool) et le « square » (ringard).
Entre le pragmatisme de ses industries créatives et l’ouverture d’esprit et le sens des affaires de ses critiques culturels, l’Amérique a réussi à faire du mainstream le nouveau canon, un canon d’autant plus légitime qu’il correspondait aux vrais choix du public (262) et qu’il s’exporte très bien. Les retombées ne sont pas seulement économiques.
Le fait de dominer le marché culturel mondial place l’Amérique dans une position des plus avantageuses. Premier exportateur, le pays n’est que le cinquième importateur mondial. La balance est donc largement en sa faveur. En conséquence, elle est peu sujette à la peur de perdre son identité que l’on retrouve dans bien des pays dominés en termes d’échanges culturels (565). Elle n’est freinée par aucune recherche d’authenticité. C’est elle qui donne le la, là où les autres craignent de finir par être américanisés. Sentiment de puissance pour elle, complexes pour les autres. Cela se traduit par une capacité à coopter les meilleurs talents mondiaux et à se renouveler par la même occasion (156). Le sentiment de puissance se manifeste aussi dans le désir d’Amérique que l’on retrouve presque partout, y compris dans les pays qui semblent les plus hostiles aux États-Unis comme en attestent les quantités de DVD pirates qui circulent en Chine (293) et dans les pays arabes (471). Mieux, la fabrique du désir d’autres régions comme l’Amérique latine (437) ou encore l’Europe (532) passe aussi par les industries américaines.
Cette position de domination profite également aux États-Unis en termes de soft power. Elle permet à ce pays d’influencer les affaires mondiales, non plus en mettant en avant les rapports de force militaires, politiques ou économiques, mais en misant sur le pouvoir d’attractivité de ses productions culturelles (45).
Le monde
La deuxième partie de Mainstream, « La guerre culturelle mondiale » porte sur les manières dont les différentes régions du monde répondent à l’Amérique. Les stratégies diffèrent beaucoup d’un pays à l’autre.
Le cas des pays européens comme la France et l’Allemagne peut surprendre. On apprend que certaines des grandes maisons qu’on pensait américaines sont, en réalité, européennes. Paris, Berlin et autres Londres procèdent ici essentiellement de deux manières : soit elles créent ces maisons, soit elles laissent Washington faire puis les rachètent. La compagnie de jeux vidéo Ubisoft a ainsi été créée par Michel et Yves Guillemot, originaires du Morbihan et à son siège à Montreuil. La maison d’édition Random House a été rachetée par le groupe allemand Bertelsman et Warner Books appartient maintenant au français Lagardère. De son côté Vivendi Games s’est procuré Activation et Blizzard. Frédéric Martel insiste sur le fait que ces maisons ne cherchent pas ensuite à européaniser les compagnies achetées. Elles les laissent continuer à travailler à l’américaine (532) et c’est, peut-être, ce qui assure leurs succès. Vivendi est ainsi devenu leader mondial du jeu vidéo.
Les pays européens n’ont, donc, aucun complexe à partir à la conquête du monde via les États-Unis. On retrouve des stratégies similaires au Japon et en Inde. Sony Pictures, qui a incorporé Columbia, a son siège en Amérique et non au Japon et a carte blanche pour faire des films hollywoodiens sans attendre le feu de Tokyo. Reliance, de son côté, a acquis une partie de DreamWorks mais se garde bien d’y produire des films façon Bollywood. Mais que ce soit en Europe, au Japon ou en Inde, Frédéric Martel note qu’en dehors de ce qui se fait avec ces grands groupes, les productions nationales peinent à toucher le marché mondial. Les films français ont du mal à séduire ailleurs qu’en France, ceux de Bollywood ne peuvent espérer des box-offices internationaux similaires à ceux d’Hollywood. En dehors des mangas dont le marché ne cesse de se développer, les contenus japonais restent au Japon. Le pays commence cependant à faire des efforts pour, à l’image de la Corée du Sud, toucher au moins le marché asiatique.
La stratégie coréenne consiste à propager sa culture chez les voisins mais sans en avoir l’air. L’objectif est d’éviter de leur donner le sentiment qu’on cherche à les coréaniser. Pour ce faire, elle glocalise. Elle produit des contenus à potentiel global mais ne cherche pas à les vendre comme tels. Elle propose plutôt des formats que les acheteurs pourront ensuite adapter à leurs publics. Dans ce sens, la pop et les dramas coréens traversent les frontières à la manière, par exemple, du jeu Qui veut gagner des millions, que les pays reproduisent dans leurs langues et selon leurs visions. Cette stratégie qui consiste à gommer les singularités nationales et les langues (378) pour mieux s’exporter est aussi celle du Japon, de Hong-Kong ou de Singapour. Elle est habile dans des régions à la fois prêtent à consommer du mainstream mais jalouses de leurs identités. La Corée parvient ainsi à pénétrer un marché chinois resté officiellement hermétique aux Américains.
Beijing ferme ses frontières à l’Amérique pour des raisons idéologiques mais aussi concurrentielles. La Chine, c’est un marché de plus d’un milliard de consommateurs potentiels. C’est aussi de grands groupes comme eSun qui disposent d’énormes budgets. Ni le gouvernement, ni ces groupes ne veulent voir Disney venir s’accaparer du marché. Ils veulent plutôt devenir les nouveaux Disney aussi bien chez eux que dans le reste du monde. Ils pensent y parvenir à travers des politiques protectionnistes. Toutes proportions gardées, les pays arabes sont dans des logiques semblables : produire leurs propres contenus mainstream et les exporter. Pour l’heure, ni les Chinois, ni les Arabes n’y parviennent. Soumis à des censures idéologiques, leurs produits n’arrivent pas à séduire leurs propres populations et encore moins le monde.
Dans le fond, si les stratégies adoptées sont différentes, chacun, qu’il l’avoue ou non, a le même objectif : détrôner l’Amérique, lui prendre des parts de marché et disposer du même soft power. Mais vouloir détrôner l’Amérique est une chose, y parvenir en est une autre. Le fait est que le désir d’Amérique est, partout, trop fort pour être efficacement contré, en particulier chez les jeunes. Ce que produisent leurs pays peinent à les satisfaire. Seules les régions qui s’inspirent, achètent ou collaborent avec les maisons américaines tirent leurs épingles du jeu. Frédéric Martel explique ainsi le succès d’Al Jazeera par le fait qu’elle a été habile à briser certains tabous, notamment en mettant à l’écran des femmes non voilées, en abordant des sujets liés à la sexualité, ou encore en ouvrant un bureau à Israël (448). De même les studios du Caire ont du succès dans le monde arabe parce que les acteurs des industries créatives bénéficient là-bas d’un peu plus de libertés. En revanche, les mêmes studios, malgré leurs efforts, parviennent rarement à attirer des producteurs occidentaux parce qu’ils ne s’y sentent pas assez libres. Ils apprécieraient, par exemple, de pouvoir boire un petit verre entre deux séances de travail (396).
Il semble donc qu’il ne suffit pas de disposer d’énormes budgets pour pouvoir concurrencer l’Amérique. Il faut encore le savoir-faire et ce qu’on pourrait appeler une atmosphère de liberté. Toutes choses dans lesquelles l’Afrique noire gagnerait à investir davantage.
Afrique noire
Cette partie du monde semble hors de la planète mainstream. En tout cas, elle est à peine présente dans Mainstream. Pour écrire le livre, Frédéric Martel a mené l’enquête dans 30 pays et seul le Cameroun représente l’Afrique noire. De plus, alors qu’il s’attarde habituellement sur ses visites et interviews, il ne fait qu’évoquer en passant quelques personnes rencontrées au Cameroun. Et pour cause, il ne semble pas y avoir vu de groupes qui ambitionnent de devenir Disney à la place de Disney ou qui ont acheté telle compagnie américaine. Dans le livre, l’Afrique apparait essentiellement à travers le paradigme de la pauvreté. On choisit d’acheter les films de Bollywood non pas pour telle raison idéologique ou du fait de tel calcul stratégique visant à mieux se positionner dans le marché mondial, mais simplement parce qu’ils coutent moins chers (353). De même, les artistes préfèrent se produire en Europe parce qu’un seul concert à Paris ou à Londres rapporte plus qu’une tournée dans un pays africain (547). Même Nollywood qui fait la fierté du cinéma africain est hors-jeu. Bien que troisième producteur mondial de films en termes quantitatif, Nollywood ne vaut rien sur le marché international car la qualité n’y est pas (549) et encore moins le potentiel à s’exporter. Il n’y a guère que Johannesbourg qui pèse un peu. Elle propose une alternative aux acteurs culturels africains qui peuvent y trouver le matériel, le financement, le savoir-faire et le cadre juridique qu’ils allaient jusque-là chercher à Paris ou à Londres.
La position plus que périphérique de l’Afrique noire au sein de ce qu’on pourrait appeler le champ mainstream mondial n’a rien de surprenant. Elle n’est qu’une autre illustration de la manière dont cette région participe peu aux phénomènes culturels à l’échelle mondiale. On se rappelle, par exemple, que lorsque David Jérôme avait également parcouru le monde pour les besoins de son enquête-conversation sur la littérature mondiale, Spectres de Goethe
En premier lieu, il faut se rappeler que mainstream rime difficilement avec obsession de l’authenticité. Or, ici, l’Afrique est dans une positive inverse à celle des États-Unis. Elle importe presque tout et n’exporte presque rien. Elle est donc particulièrement sujette à la peur de perdre son identité et de finir par être occidentalisée. Ne pouvant donner le la, elle fait partie de ceux qui s’accrochent à leur authenticité. Mais comme le démontre Frédéric Martel, les productions qui se veulent authentiques restent underground et ne touchent qu’un public de niche. Il faut voir large lorsqu’on veut toucher loin. La preuve en est que ce sont les romans pensés à l’américaine comme Voici venir les rêveurs de Imbolo Mbue ou encore De sang et de rage de Tomi Adeyemi qui deviennent mainstream. Au demeurant, il convient de relativiser cette peur de l’américanisation. En effet, ce qui fait la force de l’Amérique réside dans le fait qu’elle ne cherche pas à imposer des produits authentiquement américains mais met tout en œuvre pour intégrer les tendances et les flux mondiaux : captation des capitaux mondiaux même si cela signifie que les plus grandes maisons américaines deviennent françaises, japonaises voire chinoises, prise en compte des attentes des publics mondiaux, cooptation des meilleurs artistes mondiaux qui viennent enrichir et renouveler les produits. Dans ces conditions, « américain » est devenu synonyme « d’universel » (148).
Une autre limite de la littérature africaine a trait au public visé. Même si les intentions des auteurs peuvent être autres, une partie importante du lectorat est sensible à la logique du « By Black for Black ». Selon cette dernière, seuls les Africains sauraient écrire et lire l’Afrique. Il en résulte l’impression, certes erronée mais persistance, que la littérature africaine ne peut intéresser que les Africains. Cela se traduit par le fait qu’on pourrait dire, en caricaturant à peine, que cette littérature compte seulement trois types de lecteurs : les universitaires qui en font leur spécialité parce que c’est leur boulot, les Africains militants parce qu’ils comptent sur elle pour sauver le continent et les africanophiles parce qu’ils aaadoooreeent l’Afrique. En outre, la logique du « By Black for Black » intervient comme une sorte de censure. Elle suppose que les écrivains africains ne peuvent écrire que sur des sujets africains et les privent de la liberté d’écrire sur Mars. Elle attend d’eux qu’ils prennent certaines positions et n’hésitent pas à accuser ceux qui s’en écartent, d’écrire pour les Blancs. Elle éloigne cette littérature de toute idée de divertissement : on n’ouvre pas un texte africain pour passer du bon temps mais pour dénoncer esclavage, colonisation et autres formes de domination dont le monde noir est victime. Dès lors, la littérature africaine passe difficilement pour « hot ».
Le marché du mainstream exige de sortir de ce type de logiques et d’être plus pragmatique. Beaucoup l’ont compris et mettent tout en œuvre pour être aussi « universels » que les États-Unis, en commençant par tenir compte des desiderata des publics internationaux mais aussi de leurs propres jeunesses. En Amérique latine, les telenovelas c’était, en gros, « l’histoire d’un couple qui veut s’embrasser mais que le scénariste a décidé, sur près de 200 épisodes, de ne pas laisser faire. On comprend l’impatience du couple, et des téléspectateurs. » (401). Désormais, environ 60 épisodes suffisent. Le couple et le public international disent merci. En Inde, la Whistling Woods International School donne tous ses cours en anglais parce que c’est une linga franca et, surtout, la langue du cinéma mainstream. La Corée vend ses formats à perte dans des pays comme le Vietnam en vue de se placer sur un marché susceptible de rapporter plus tard, économiquement comme politiquement. Rotana, pour mieux répondre au gout du public, va tourner au Caire les clips qu’elle ne peut diffuser chez elle en Arabie Saoudite. Cette stratégie lui permet de dominer le marché dans le monde arabe en attendant de pouvoir toucher les autres régions.
On le voit, on n’hésite devant rien pour attirer, séduire et élargir son public. L’Afrique ne peut déroger à la règle. La preuve en est que l’Amérique est elle-même soumise à cette nécessité de pragmatisme. À cet égard, on se rappelle que la maison de disque Motown n’a dû son succès qu’au fait que Berry Gordon a eu la bonne idée, quitte à être traité de « sell out », de produire de la musique noire pour les Blancs, d’oser ce que Frédéric Martel appelle une musique « crossover » (185). À l’inverse, la country peine à devenir mainstream, même aux États-Unis, parce qu’elle reste trop associée aux paysans du Sud, parce qu’elle tarde à comprendre qu’au XXIe siècle, faire de la musique pour trois « hillbillies » du coin, ce n’est pas être underground et authentique, c’est manquer d’ambition.
Conclusion
Même en Amérique, le monde de la culture et de l’art a longtemps aimé se dire désintéressé et apolitique. Aujourd’hui, avec le mainstream, il est un peu plus honnête avec lui-même. Il assume son côté requin, la course aux bénéfices (204) et au soft power. Ailleurs, on commence aussi à arrêter de se voiler la face. Chacun est libre d’en penser ce qu’il veut. Cependant, on ne peut ignorer les nouvelles réalités. Avec le mainstream, les frontières entre les belles-lettres et la paralittérature, l’élitisme et le populaire, la culture et le divertissement sont désormais floues. Là où la masse était moquée dans ses gouts, c’est, désormais, elle qui rit des has been et impose ses quatre volontés. Certaines régions entendent résister à ce qu’elles voient comme une américanisation du monde. Mais leurs jeunesses ne cachent pas leurs désirs d’Amérique ou plus exactement de mainstream. De même, leurs industries créatives ne rêvent pas mieux que d’inspirer les mêmes désirs, de devenir Disney à la place de Disney. Il appartient à l’Afrique noire d’être assez pragmatique pour ne pas manquer le coche. Qu’elle ne s’y trompe pas, rester hors mainstream, ne revient pas à défendre l’authenticité africaine. Au contraire, c’est prendre le risque que, dans un avenir proche, la jeunesse africaine ne découvre sa culture qu’à travers des productions américaines. Le phénomène est d’ailleurs déjà en marche avec des blockbusters comme Black Panther et des spectacles comme Black is King. Certes, ces films répondent à la logique du « By Black for Black », ils n’en restent pas moins américains, ne nourrissent pas moins les banques et le soft power américains.
Un article d'Abdoulaye Imorou
pour le blog collaboratif Chez Gangoueus
Frédéric Martel, Mainstream. Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias, Paris, Flammarion, 2020, édition Kindle.

