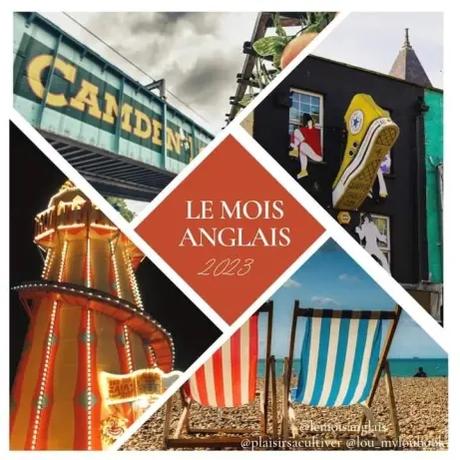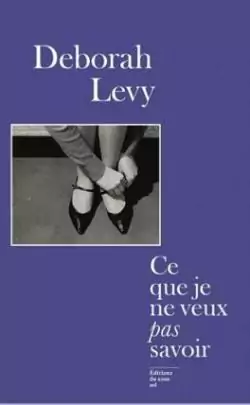
Quatrième de couverture :
Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se retrouver, et pense à l’Afrique du Sud, ce pays qu’elle a quitté, à son enfance, à l’apartheid, à son père – militant de l’ANC emprisonné –, aux oiseaux en cage, et à l’Angleterre, son pays d’adoption. À cette adolescente qu’elle fut, griffonnant son exil sur des serviettes en papier. Telle la marquise Cabrera se délectant du “chocolat magique”, elle est devenue écrivaine en lisant Marguerite Duras et Virginia Woolf. En flirtant, sensuelle, avec les mots, qui nous conduisent parfois dans des lieux qu’on ne veut pas revoir. Ce dessin toujours inédit que forme le chemin d’une existence.
Ce que je ne veux pas savoir est une œuvre littéraire d’une clarté éblouissante et d’un profond secours. Avec esprit et calme, Deborah Levy revient sur ce territoire qu’il faut conquérir pour écrire.
Il faut – me semble-t-il – avoir lu tout ce petit ouvrage 135 pages) pour en apprécier la portée. Il est de toute façon construit en boucle, avec un élément commun au début et à la fin.
Deborah Levy raconte d’abord la dépression qui l’assaille en Angleterre, où elle pleure comme une fontaine sur les escaliers roulants. Elle se réfugie à Majorque, où il neige en mars, dans un hôtel tenu par une femme. Elle rencontre un épicier chinois à qui elle va raconter quelques souvenirs de son enfance en Afrique du Sud et « en Exil » : l’image du bonhomme de neige construit avec son père et fondu, disparu, tout comme ce père arrêté et longuement emprisonné pour faire partie de l’ANC, l’African National Congress ; la petite fille qui parle peu et pas assez fort, dont sa cousine va essayer de libérer la voix (« Les filles doivent parler haut puisque personne ne les écoute de toute façon. ») ; l’oncle tellement différent de son père, raciste sans complexe ; l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ; puis, à quinze ans, l’Exil en Angleterre, la naissance inconfortable de sa vocation d’écrivain, l’impression de n’appartenir ni à l’Afrique du Sud ni à « l’Ingerland ».
Au passage, nourrie par ses lectures de Marguerite Duras et de Virginia Woolf, Deborah Levy parle de la condition féminine, de la maternité, de la voix des femmes. Aucune amertume dans sa voix mais un constat lucide et décomplexé. La voix de l’écrivaine en devenir, puis de celle qui ne sait plus comment orienter sa vie, peut toucher tous ses lecteurs : comme le dit l’épicier chinois, « Parfois, dans la vie, la question n’est pas de savoir où commencer, mais où s’arrêter. » (p. 129)
« Parler haut, ce n’est pas parler plus fort, c’est se sentir autorisé à énoncer un désir. On hésite toujours, quand on désire quelque chose. Dans mon théâtre, je préfère montrer l’hésitation plutôt que de la cacher. Une hésitation n’est pas la même chose qu’une pause. C’est une tentative de rejeter le désir. Mais quand vous êtes prêts à vous saisir de ce désir et à mettre des mots dessus, alors même un murmure, les spectateurs l’entendront. » (p. 20)
« Si la maternité est le seul signifiant féminin, nous savons que le bébé sur nos genoux, à supposer qu’il soit en bonne santé et qu’on s’occupe bien de lui, finira forcément par se détourner de notre sein et ira voir ailleurs. Il ira voir quelqu’un d’autre. Il ira voir le monde et en tombera amoureux. Certaines mères deviennent folles parce que le monde qui les a fait se sentir inutiles est le monde dont leurs enfants tomberont amoureux. La banlieue de la féminité n’est pas un endroit où il fait bon vivre. De même qu’il n’est pas sage de chercher refuge auprès de nos enfants parce qu’ils ont toujours tendance à courir le monde pour y rencontrer quelqu’un d’autre. » (p. 29-30)
« Comment les gens deviennent-ils cruels et pervertis ? Si on torture quelqu’un, est-on fou ou normal ? Si un homme blanc lance son chien sur un enfant noir et que tout le monde dit que c’est acceptable, si les voisins, la police, les juges et les enseignants disent : « moi ça me va », la vie vaut-elle d’être vécue ? Et qu’en est-il des gens qui pensent que ce n’est pas acceptable ? Sont-ils assez nombreux dans le monde ? » (p. 124)
« Cette façon que nous avons de rire. De nos propres désirs. Cette façon que nous avons de nous moquer de nous-mêmes. Pour devancer les autres. Cette façon dont nous sommes programmées pour tuer. Nous tuer. Mieux vaut ne pas y penser. » (p.132 – 133)
Deborah LEVY, Ce que je ne veux pas savoir, traduit de l’anglais par Céline Leroy, Editions du Sous-sol, 2020
Le Mois anglais 2023 – Journée essai/document/biographie/autobiographie