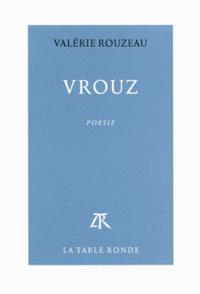 Ni vrac ni vroum, voilà le vrouz qui arrive, déboule et roule comme un dé sur la table, avec sa couverture bleue sage pas ciel plutôt bleu gris froid, peut-être un peu terne mais quelle vie ne l’est pas ? Vrouz donc, et une note finale nous informe qu’il s’agit d’un bon mot forgé par Jacques Bonnaffé, titre préféré à celui initialement prévu, « autoportraits sonnés avec ou sans moi ».
Ni vrac ni vroum, voilà le vrouz qui arrive, déboule et roule comme un dé sur la table, avec sa couverture bleue sage pas ciel plutôt bleu gris froid, peut-être un peu terne mais quelle vie ne l’est pas ? Vrouz donc, et une note finale nous informe qu’il s’agit d’un bon mot forgé par Jacques Bonnaffé, titre préféré à celui initialement prévu, « autoportraits sonnés avec ou sans moi ».
J’aime bien que l’auteure joue discrètement sur les notes en fin de livre et refuse une quatrième de couverture, le plus souvent inutile. Mais revenons à ce titre initial : « autoportraits avec ou sans moi ». Donc lyriques ou objectifs mais toujours autoportraits, autrement dit une vie en mots, « a set of snapshots ». Intime, mais pas forcément, cela dépend des jours. Et si moi sans moi, que reste-t-il sinon de l’écriture ? « Bonne qu’à ça ou rien » est le premier vers du premier poème. Ceci posé, j’entends aussi dans ce « avec ou sans moi » quelque chose comme une vie à la peine, des moments où l’on ne se retrouve plus, où l’on ne s’y retrouve plus, une vie sans soi, une vie de rien, ou peu. Cependant, « autoportraits » tout de même, mine de rien. Parce que si être ou ne pas être, c’est difficile, être sans être reste encore moins simple ; et pourtant on continue, on persiste, en bordure de mort, à côté, pas finis.
Je n’oublie pas que ces autoportraits sont « sonnés », et vrouz, ça repart… On entend « sonné » comme un boxeur peut l’être ; pas K.-O., juste titubant sous le coup inattendu qui vient de l’atteindre. Même pas besoin d’adversaire clair, la vie se charge de cogner. « Sonnés », on entend aussi pris en son, travaillé sur un plan sonore ; là-dessus, on ne sera pas déçu, Valérie Rouzeau est une poète sonore. La descendance en ligne directe de Chopin ou Heidsieck peut être discutée, mais le caractère sonore du travail, non. Et dans ce livre, Valérie Rouzeau sonne en sonnet : « forme sonnée » (p. 28), « Est-ce un travail de sonner comme ça le quotidien » (p. 104). De fait, les 151 poèmes ont tous 14 vers. C’est la première fois, je crois, que l’auteure s’astreint à une contrainte aussi forte, aussi longuement. Voilà peut-être la raison pour laquelle ce livre a pris son temps, celui du travail de lime qu’implique toute forme fixe et métrée. Car si l’on ne peut parler ici de vers régulier au sens strict, il faudrait parler de vers réglé, une sorte de forme intermédiaire entre vers régulier et vers libre. Chaque « sonnet » fait bloc, sans découpage en strophes, sans schéma de rimes obligé, mais avec une contrainte isométrique très forte sur des mètres pairs : 6 – 8 – 10 – 12 – 14. Bien entendu, les licences sont fréquentes, diérèses ou compte tenu ou non de l’e muet. Mais le rythme pair est si majoritairement prégnant que la lecture modèle le vers jusqu’à l’entendre régulier. Ainsi par exemple, le début du premier poème : « Bonne qu’à ça ou rien / Je ne sais pas nager pas danser pas conduire / De voiture même petite / Pas coudre pas compter pas me battre pas baiser / Je ne sais pas non plus manger ni cuisiner / (Vais me faire cuire un œuf) / Quant à boire c’est déboires ». Je vais appuyer le e muet sur « bonne », « coudre », et taire ceux de « voiture », « même », « battre », « faire », « boire ». Et cela me donne une série paire de 6-12-6-12-6-6. Pas étonnant que Prévert soit cité au passage page 50, c’est la même liberté d’écriture formée non conforme. De même pour la rime ; elle est là ou pas, comme en passant, jamais contrainte ou bijou clinquant. Par contre, elle est relayée par divers montages sonores, aussi inventifs que calculés. Ainsi, dans une courte série (pages 110-111-112), la fin du vers est reprise en début de vers suivant : « …Tourcoing/Coin »,« …orchidées/Idéales », « …succulentes/Lentement », « …ellébore/ S’élabore », « …chemin/Maintenant » etc. Dans le même ordre d’oreille, les jeux homonymiques ou paronymiques abondent jusqu’à créer une sorte de tissage sonore du poème : pour le seul sonnet de la page 19 : « baskets/basses côtes, antérieur/pas rieur/sérieux, fracassée/tracassée, attraper/métro tard rater »… Tout cela pourrait donner l’impression d’une légèreté ludique autant que d’un travail technique de précision. Ce n’est pas faux, et bien dans la continuité de l’écriture de Valérie Rouzeau depuis Pas revoir. De la même façon, on retrouverait le goût pour les comptines, les onomatopées, les emprunts à l’anglais, les néologismes, les chocs de registres de langue, les dérivations de clichés…
Bref on retrouve une voix, et sa boîte à outils, ce qui est la moindre des choses en poésie vraie. Mais le poème n’a pas pour objectif d’être un pur travail de langue ; il est là pour porter une vie. Et la forme du « sonnet » se prête bien à la saisie de scènes brèves du quotidien ; bon nombre de poèmes ont un aspect polaroïd, saisie d’un moment particulier. Ce peut être une scène de voyage ou de rue, une brève rencontre, un événement aussi banal que changer de matelas ou se faire à manger… Mais tout cet « anodin », s’il est évoqué le plus souvent avec humour, révèle surtout la fatigue de vivre, la difficulté d’être qui est au fond de la poésie de Rouzeau. Dans ces pages, la mort est souvent présente, autant celle du poète que celle des autres. L’impasse politique, aussi, même si on ne peut parler de poésie lourdement « engagée ». C’est bien une « éclopée/de la vie mal possible » (p 34) qui nous parle et nous touche parce qu’elle sait évoquer les difficultés d’une vie étroite en même temps qu’elle arrive toujours à développer une forme de résistance à l’écrasement : « Et ton rêve tient debout tout seul même quand tout tremble ».
Ce livre n’est absolument pas moralisateur, mais il s’en dégage une façon de voir la vie, sans doute pauvre et pas facile, mais solide : « Il faut tenir debout tout seul il faut aller / En classe au cimetière aller tant bien que mal bien » jusqu’à « Comprendre plus ou moins le monde et soi ».
Il reste à dire encore ce que cette poésie porte de générosité et d’attention aux autres : les œuvres amies ou aimées, bien sûr, largement présentes, mais tout un chacun, l’anonyme de la rue, autant : « Aussi je est un hôte d’on ne sait qui ni quoi / Mystère en bout de course comme à la balançoire / La vie assujettit drôlement ses invités / Alors je vante le vent par ma lucarne ouverte / Et je ne confonds pas auspices avec hospices / Rouzeau avec réseau dentiste avec temps triste / Pater avec par terre pleure avec meurs meurs meurs / Tu pisseras moins moins moins / Mon poème ne compte pas davantage / Que la conversation bruyante de mon prochain / M’empêchant de poursuivre par ici sauf / A fermer ma lucarne ou la repeindre en bleu / Appeler ma prochaine / Ou m’écrier au feu. » (p. 140)
[Antoine Emaz]
Valérie Rouzeau, Vrouz, Editions La Table Ronde, 170 pages, 16 €

