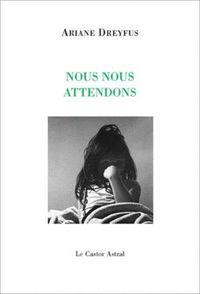 Pour une fois, commençons par la fin : les deux textes donnés en « annexes », Cerises interlocutrices* et Les bouées que nous prenons, ne sont pas du tout accessoires. Ils pourraient être lus comme une sorte d’introduction ou de préface de l’auteur, tant ils éclairent la visée et la manière de travailler, à partir de deux poèmes précis et présents dans le livre. Il est tout à fait intéressant d’entrer dans l’atelier d’Ariane Dreyfus, de lire les différents états du poème, de comprendre le pourquoi de l’évolution de tel ou tel vers. Ecrire est un travail de précision, pas un pur élan inspiré ; un travail de retour sur soi autant que d’attention à l’autre, à la réception. Un travail aussi de défiance vis-à-vis de ses propres « tics ». Un travail enfin de pesée gain/perte pour chaque variante possible. Ces pages permettent aussi l’accès au soubassement du texte : on mesure combien la force originaire du poème est finalement et volontairement bridée jusqu’à n’être qu’indication rapide au lieu de se déployer en un flot lyrico-sentimental : « mon livre vise à l’affleurement de drames banals et jamais exposés » (p.150). Je pourrais donner plusieurs de ces « affleurements » mais ce serait les mettre au premier plan alors que le travail d’écrire ne vise pas à leur mise en valeur, sinon par leur présence maintenue dans un environnement textuel qui dit tout sauf le « drame ».
Pour une fois, commençons par la fin : les deux textes donnés en « annexes », Cerises interlocutrices* et Les bouées que nous prenons, ne sont pas du tout accessoires. Ils pourraient être lus comme une sorte d’introduction ou de préface de l’auteur, tant ils éclairent la visée et la manière de travailler, à partir de deux poèmes précis et présents dans le livre. Il est tout à fait intéressant d’entrer dans l’atelier d’Ariane Dreyfus, de lire les différents états du poème, de comprendre le pourquoi de l’évolution de tel ou tel vers. Ecrire est un travail de précision, pas un pur élan inspiré ; un travail de retour sur soi autant que d’attention à l’autre, à la réception. Un travail aussi de défiance vis-à-vis de ses propres « tics ». Un travail enfin de pesée gain/perte pour chaque variante possible. Ces pages permettent aussi l’accès au soubassement du texte : on mesure combien la force originaire du poème est finalement et volontairement bridée jusqu’à n’être qu’indication rapide au lieu de se déployer en un flot lyrico-sentimental : « mon livre vise à l’affleurement de drames banals et jamais exposés » (p.150). Je pourrais donner plusieurs de ces « affleurements » mais ce serait les mettre au premier plan alors que le travail d’écrire ne vise pas à leur mise en valeur, sinon par leur présence maintenue dans un environnement textuel qui dit tout sauf le « drame ».
Dans ces textes « annexes », le projet du livre est aussi clairement énoncé : « je travaille à un livre hanté par l’œuvre de Gérard Schlosser, en « miroir de peinture », comme le dit une amie. J’ai envie d’écrire dans la lumière de sa pensée, de son rapport au monde tel que je le ressens en regardant ses tableaux, non pas pour décrire ou reproduire ceux-ci, mais pour provoquer un effet approchant. » (p.112) Donc il s’agit d’un livre dans la proximité d’une peinture, en « reconnaissance à Gérard Schlosser », comme l’indique le sous-titre, mais pas du tout d’un livre illustrant la peinture de Schlosser, à proprement parler. Au fil des poèmes, le peintre peut être évoqué, « Le rose vient d’être ouvert, il hésite / Il pose son pinceau dans le pot de pinceaux » (p.105). Mais ce n’est aucunement une présence invasive. Le poème a son autonomie, sa tenue, tout comme dans les livres précédents Ariane Dreyfus pouvait passer par d’autres formes artistiques (cinéma, danse…) permettant un détour pour mieux ramener à son œuvre personnelle.
Les scènes d’intérieur dominent, mais le paysage (mer, campagne, pas de ville) n’est pas oublié. Dominent l’été et l’harmonie : « La nature est cette communauté surprenante où nous introduit le corps » (p.81). Sensualité, participation au monde : le corps comme interface multiple entre soi, l’autre, le dehors. Mais c’est toujours dans ce livre comme un bonheur possible : le temps s’absente, reste un accord immédiat avec le réel, nature ou corps de l’autre : « Une pierre que l’après-midi tient au chaud / C’est mieux les lèvres,/ Changeant de forme dans les baisers / Alors que l’angoisse n’arrive à rien » (p.89).
Poésie amoureuse, oui, mais curieusement décalée par l’éviction du rapport je/tu et son remplacement par il/elle, qui provoque comme une impression de suspension. On ne sait pas si la scène est vécue ou décrite à partir d’un tableau de Schlosser. Expérience personnelle ? Rêverie à partir de personnages peints ? Flou entre les deux ? Par contre, on retrouve bien l’érotisme sans violence particulier à la poésie d’Ariane Dreyfus. Etre au plus près du corps, c’est le caresser : « C’est si calme d’aimer » (p.58). Erotisme de la tendresse : « Il plie le bras pour qu’elle y mette sa tête / A deux ils font un corps » (p.92). Les objets participent à ce jeu qui peut envelopper autant que découvrir, sans rien de pervers : pull, chemisier, couverture… Le désir a toute sa place de simple désir.
Les titres des poèmes contribuent à créer cette atmosphère de normalité, de naturel : ce sont des paroles de la vie quotidienne, sans contexte ni lien direct ou évident avec le poème qu’ils annoncent : « Arrête, veux-tu », « On est arrivés hier », « Je vais au jardin », « Tu aurais dit une chose pareille ? », « Je me sens vieux »…
Un dernier élément, déjà présent depuis longtemps chez Ariane Dreyfus, mais qui rejoint peut-être la peinture de Schlosser : privilégier le détail. En allant vite, on pourrait parler d’une pente métonymique de cette poésie : une partie du corps, un geste, un objet… sont révélateurs de bien plus qu’eux-mêmes. Ils portent une vie. Le livre devient comme un miroitement d’éclats de vivre, même si chacun est composé comme un tableau dans lequel le poème peut ouvrir une profondeur, voire un à-pic : « Est resté ou est revenu / La couverture cette fois est à gauche / Genou / Pliant sa jambe son pied est posé / Sur l’autre jambe // La moitié d’un losange / En-dessous c’est un peu d’ombre c’est creux // S’arrêtant de lire pour garder ouverte la page / Où c’est écrit / « Les rues de Vienne sont pleines de Juifs qui ne sont pas là » » (p.66).
Le titre d’un poème peut parfaitement exprimer la poésie de ce livre : « Une musique qui parle, pas une qui déclame ». Exact.
[Antoine Emaz]
Ariane Dreyfus – Nous nous attendons, Le castor Astral – 155 pages – 14€
*on peut lire ce « chantier de poème » dans Poezibao.

