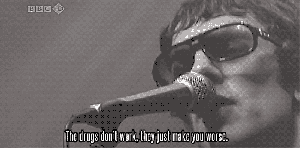
Nous avons beau être unis de la manière la plus sacrée qui soit, ce n’est pas pour autant que je sois des plus fusionnelles avec le Mari. Pour preuve, nous avons profité de ce samedi après-midi maussade de juillet à Paris pour aller au cinéma, mais pas ensemble. Cela nous a permis de voir deux films au format différent, mais à la problématique similaire : comment des musiciens considérés comme géniaux peuvent sombrer à cause du mélange explosif d’addictions diverses et de la mauvaise influence d’un entourage pas forcément bienveillant.
Chacun de notre côté, nous allons donc vous donner notre ressentiment sur deux films sortis durant ce mois de juillet 2015 sur les écrans français. Je vous parlerai d’Amy, un documentaire à la réputation sulfureuse sur ce fabuleux météore qu’était Amy Winehouse. Le Mari vous exposera son point de vue d’exégète sur Love & Mercy, un biopic sur Brian Wilson.
Amy (docu d’Asif Kapadia, 2015)
Pitch Allociné : Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l’attention du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque. Mais l’attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre précaire. Le grand public a célébré son immense succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur pour elle a fini par être la cause même de sa chute. Avec les propres mots d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif Kapadia nous raconte l’histoire de cette incroyable artiste, récompensée par six Grammy Awards.
Mon humble avis : Ayant moi-même écouté en boucle Back To Black et le classant parmi les meilleurs albums produits dans les années 2000, je me suis toujours sentie très proche de cette artiste qui avait mon âge. Ici, on suit son parcours, depuis une fête entre potes lors de ses 14 ans – où sa manière de chanter Happy Birthday pose déjà le personnage – et son tragique décès, dans sa 28e année, frappée par la fatalité d’un destin qui ne voulait pas qu’elle survive davantage.
On voit à quel point pour elle, la musique était instinctive, comme un moyen de survie, face à une situation difficile à vivre pour une enfant. Ce qu’on peut s’apercevoir, c’est que malgré la défonce, elle était consciente de ses capacités de musicienne intégrale, qui ne se développaient que lorsqu’elle sortait d’une situation éprouvante : elle enregistra Frank à la sortie de l’adolescence et des antidépresseurs, elle enregistra Back To Black après sa première rupture avec Blake Fielder et sa première tentative de rehab, elle enregistra avec Tony Bennett après avoir rompu avec l’alcool début 2011. Sa dernière prestation à Belgrade en juin 2011 est d’ailleurs très éloquente à ce sujet : elle se savait défoncée (s’était-elle défoncée sciemment ?) et clairement pas en état physiquement pour assurer un concert. C’était certes pitoyable, mais c’est surtout le dernier acte public de lucidité.
Derrière la chanteuse jazz, il y avait donc des fêlures et surtout des mauvaises fréquentations. Il y a évidemment son mari, Blake Fielder, qui l’a menée à la consommation massive de drogues pour supporter le succès de Back To Black, et dont l’incarcération a mené Amy à faire une coupure de six mois salvatrice à Sainte-Lucie. Mais il y a surtout ce père, Mitchell Winehouse, à la fois l’origine de ses problèmes personnels et le pire manager qui puisse lui être donné, contrairement à ce que les médias et même lui-même veut en montrer. Alors qu’Amy a 18 mois, il entame une relation avec une autre femme et finit par abandonner sa famille quand elle a 9 ans. Alors qu’il pense que sa fille s’en sort très bien, elle passera son adolescence sous antidépresseurs et gardera sa vie durant un attrait pour l’autodestruction et les relations blessantes avec les hommes. C’est lui qui lui évitera sa première rehab fin 2005, qui a résulté à ce superbe album qu’est Back In Black. Alors on va dire que c’est un mal pour un bien, mais Amy a payé le prix d’une relation filiale bancale, comme en témoigne la chanson What Is It About Men. Ce qui est assez frappant à voir, c’est que ces deux hommes l’ont un jour quittée, pour revenir, le succès aidant…
Ce qui est surprenant, c’est que, contrairement à une bonne partie des chanteurs de son acabit, elle avait malgré tout un entourage extrêmement sain autour d’elle : ses amies de toujours, Juliette Ashby et Lauren Gilbert, qui prennent une part prépondérante dans le documentaire, mais aussi son premier agent, Nick Shymansky et les producteurs Salaam Remi et Mark Ronson. Les cinq dernières minutes sont de surcroît très émouvantes, lorsque Juliette évoque les conversations qu’elles se sont échangées les derniers jours de sa vie.
Parlons maintenant de la forme du documentaire : il est tiré de documents personnels, de documents d’archives et des commentaires audio de chacun des protagonistes qui ont, un jour, entouré Amy Winehouse dans son ascension et dans sa chute. Asif Kapadia a fait le choix de livrer les témoignages et de les monter dans un état brut, sans rajouter un éventuel point de vue. C’est de cette manière que la figure de Mitch Winehouse en est exacerbée sans pour autant qu’il y ait de témoignage à charge directement contre lui. Blake Fielder passe finalement pour un paumé un peu dépassé par les événements. Les témoignages les plus criants de vérité viennent de ses amies qui ne l’ont jamais lâchée, malgré la déchéance et malgré le fait qu’elles aient pu elles-mêmes souffrir d’une telle situation.
Au final, en bonne spectatrice lacrymale, j’ai pleuré la moitié du film. En effet, la déchéance est montrée sans ambages ni excès de sensationnalisme. Le documentaire montre parfaitement les fêlures qui l’ont menée à exploiter ce don du ciel qu’elle avait et à se pourrir, le succès venu. Car, en bonne chanteuse d’un répertoire supposé confidentiel et élitiste, le succès et les conséquences de Back To Black semblaient difficile à assumer, tant elles lui étaient comme une erreur de parcours. Bref, Amy Winehouse n’était pas faite pour le succès populaire qui détruit les âmes les plus fragiles.
Love & Mercy, la véritable histoire de Brian Wilson des Beach Boys (Bill Polhad, 2014)
Pitch Allociné : Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie musical, John Cusack ses années noires, et l’histoire d’amour qui le sauvera.
L’humble avis du Mari : En tant que fan qualifié par ma femme d’exégète des Beach Boys et (surtout) de Brian Wilson, je me devais d’aller voir Love and Mercy. Rien que le titre était censé m’attirer, car il s’agit du morceau d’ouverture de son beau premier album solo (officiel, car The Beach Boys Love You en était presque un, tout comme… Pet Sounds) de 1988, par ailleurs sorti en single. Celui-ci a fait un flop, éclipsé par l’horrible Kokomo, que tout le monde adore autour de moi… Bref, passons.
Le film est magistralement interprété par ses acteurs, c’est évident. La palme revient à Paul Dano, jeune Brian Wilson plus que crédible, et Paul Giamatti en impitoyable Eugene Landy. Ayant lu la fausse autobiographie de Brian Wilson (émanant en fait de Landy), ainsi que le livre de Carlin Catch a wave (indispensable et aucunement racoleur), je peux dire que j’attendais le film au tournant.
Il est dit que Brian Wilson a été bouleversé par le film. Il a été grandement perturbé, paraît-il. Il faut dire que le film joue sur une dualité (qui ne m’a pas choqué, car je n’ai pas eu le sentiment qu’on passait systématiquement du coq à l’âne) entre 1965-1967 et une période semblant se situer entre 1985 (référence à la mort de Dennis Wilson deux ans auparavant) et 1991 (enregistrement de Sweet Insanity, début du procès ayant permis d’éloigner Landy de Brian). L’effet de ping-pong entre les périodes souligne le drame de l’existence de Brian Wilson. En 1966, il était considéré comme LE génie musical (à mes yeux, il était à l’époque supérieur aux Beatles, haut la main, et pourtant on sait à quel point je les adore). Qu’était-il devenu dans les années 80 ? Une épave, avec des éclairs mélodiques…
Le film dérange. Il dérange surtout si on se sent concerné par la musique des Beach Boys… Non, je ne parle pas de la période surf, qui est un détail, et je pèse mes mots. La vraie musique des Beach Boys, c’est celle qui montre Brian Wilson à cœur ouvert, quand il s’épanche, qu’il évoque ses peurs, ses obsessions, ses cauchemars, en les magnifiant par des mélodies célestes, qui n’ont quasiment plus rien à voir avec le rock, qui ont atteint une autre galaxie, que peu ont atteinte d’un point de vue mélodique (Odessey and Oracle des Zombies et Tubular Bells de Mike Oldfield). Pour comprendre le film Love and Mercy, il faut aimer la période 1965-1971, l’album Love you de 1977 et l’album solo de 1988. Sinon, vous ne comprendrez jamais ce film. Oubliez les voitures, le surf et les filles, ce n’est pas de ce Brian dont on parle. Du coup, on est presque surpris que le réalisateur n’ait pas fait une séquence avec la chanson I just wasn’t made for these times. C’est l’esprit génial, mais torturé, détruit par son père, son cousin Mike Love (parfaitement portraituré dans sa bêtise et son souhait de continuer sur la thématique idiote des voitures et des filles), puis par Landy.
Les sons rendent bien les perturbations auditives et mentales de Brian, aggravées par la drogue : ils mettent mal à l’aise. Mais ce ne sont pas n’importe quels sons : ce sont des bribes de chansons des Beach Boys avec du phasing, des ralentissements, à l’envers, avec de l’écho… Le pire, c’est quand on reconnaît des bribes de SMiLE, l’album maudit et mythique. J’ai été grandement perturbé par les sons du motif de Do you like worms ?, que les profanes connaissent comme passage au clavecin de Heroes and Villains. J’en suis presque à me demander si la crise d’angoisse que j’ai eue dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2011 n’a pas été due à l’écoute quelques heures auparavant au casque des sessions d’enregistrement de ce motif… À côté, la reproduction de la session d’enregistrement de Fire en paraît presque jouasse…
Malgré les perturbations que j’ai subies au cours du film, j’ai conservé assez de lucidité pour remarquer quelques inexactitudes. Le moment où Brian annonce faire le plus grand album de tous les temps après la découverte de Rubber Soul des Beatles (dans sa version américaine, démarrant par I’ve just seen a face) date de décembre 1965, devant Marilyn (sa première épouse), et non face à ses frères lors d’une fête. On notera aussi que la gestation de Good Vibrations prête à caution. Elle est placée après Pet Sounds, alors que les premières versions datent des sessions pour cet album. L’enchaînement vers Smiley Smile reprend la vieille légende d’un Brian qui a tout abandonné, alors que des bandes qui ont fuité montrent qu’il cornaquait encore les sessions en juin-juillet 1967. Pire encore, la même séquence filmique évoque la vente par son père Murry des droits de ses chansons (le label Sea of Tunes), qui n’a eu lieu qu’en… 1969. On y voit d’ailleurs en toile de fond des bandes master Scotch, à l’ancienne, reproduisant une pile de sessions pour SMiLE… avec des incohérences de titres. Song for children s’appelait à l’époque Look ; le titre n’a été adopté qu’en 2004, lors du réenregistrement de l’album. Mrs. O’Leary’s Cow s’appelait The Elements : Fire. Quant à I ran, aucun enregistrement n’a subsisté. Y en avait-il ? Quelque chose a-t-il été enregistré sous ce titre réellement ? Ou est-ce une session qui n’a pas abouti, donc sans enregistrement (comme la séance annulée figurée dans le film) ? Quand Brian joue à Melinda un instrumental de Love and Mercy, on est certainement en 1987, alors qu’il avait commencé l’enregistrement de son premier album solo. Or, dans le film, on a l’impression qu’il y a un mélange entre cet album et Sweet insanity ; la confusion peut être problématique… Ajoutons également que Melinda Ledbetter apparaît comme celle qui a décidé d’ôter Brian des tentacules de Landy. Carlin dit dans Catch a wave que c’est Peter Reum qui l’a fait. Or, comme l’indique un article de Slate.com, peut-être qu’il s’agissait vraiment de Melinda, aidée de Gloria, la bonne de la maison de Brian, puisque cette dernière est remerciée à la fin du film… Mais là n’est pas l’important dans le film, et cela est d’autant plus remarquable qu’habituellement, je décroche d’un film après une inexactitude.
On ne s’ennuie jamais au cours des deux heures du film. Il manque un je-ne-sais-quoi pour en faire un grand film, mais il y a des séquences marquantes. Outre celles purement musicales, la séquence sur fond d’In my room (chanson dont j’ai toujours adoré le texte pour des raisons personnelles tout comme In the back of my mind et I just wasn’t made for these times) explique tout le film, toute l’histoire de Brian. Landy a joué de l’oppression de Murry pour en exercer une identique et prendre le contrôle de sa personne, jusqu’à se faire désigner principal héritier testamentaire… On est pris par l’histoire, par la psyché de Brian Wilson, on s’identifie presque à lui. Malgré ses défauts et ses vices, on ne peut qu’être compatissant (mercy) voire l’aimer (love) en le voyant regarder les étoiles, parler avec une honnêteté assimilable à la candeur, le rendant maladroit dans ses gestes et envers les femmes… Certes, la fin est un peu Disney avec le mariage et le fait que tout va pour le mieux après, alors que certains fans commencent à surnommer Melinda… Melandy, ce qui peut paraître injuste, mais le côté mainstream dégoulinant des dernières productions lui est autant imputé qu’au backing band de Wilson, mais songez à ce que peut être la vie commune avec quelqu’un comme lui, avec tout le respect que l’on peut avoir pour l’artiste génial des années 60… Mais on est pris par surprise, avec une interprétation live de Love and Mercy (de 2004-2005 ?) qui a failli me faire craquer. J’ai été tellement ému par ce cadeau final que la diffusion d’une chanson du bien mauvais No pier pressure, One kind of love, m’a fait paradoxalement plaisir, en tapant même du pied.
Je suis ressorti du cinéma MK2 Hautefeuille, assez perturbé, à vouloir faire un tour près de Gibert Joseph (mon fief depuis presque vingt ans), avant d’être rejoint par ma femme, qui a été émue par le visionnage d’Amy. Pour retrouver mes esprits, j’ai demandé à revoir les étals de livres chez Gibert et revenir à mes affaires intellectuelles ordinaires, pour me retrouver dans mon élément, tel un Brian Wilson se retrouvant en studio, dans son élément…
A bientôt pour de nouvelles aventures musicales !

