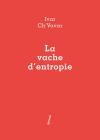 A la demande de Poezibao, soucieuse de le voir exprimer son point de vue, Ivar Ch'Vavar répond ici aux considérations de Gérard Cartier sur le vers justifié (dans une toute récente note de lecture de La Vache d’entropie).
A la demande de Poezibao, soucieuse de le voir exprimer son point de vue, Ivar Ch'Vavar répond ici aux considérations de Gérard Cartier sur le vers justifié (dans une toute récente note de lecture de La Vache d’entropie).
Réponse à Gérard Cartier, 23 janvier 2020
par Ivar Ch'Vavar
Je remercie Gérard Cartier, qui a écrit ce bel article sur mon livre La vache d’entropie. Toutefois je dois répondre à la note, sur la justification, dont il fait suivre cet article, où il écrit que j’accorde trop d’importance à la technique des vers justifiés.
J’ai écrit quelques centaines de pages en vers justifiés, et quelques dizaines sur la poésie justifiée. Ces dernières, plutôt d’approche, et dans le cadre d’un travail en réseau avec les camarades, peuvent difficilement être résumées en quelques lignes, et de toute façon les questions restent ouvertes.
Au départ (fin des années 1990) on a recouru aux contraintes d’écriture comme le vers arithmonyme et le vers justifié parce qu’il fallait inventer une nouvelle profération poétique : ces contraintes ont donc tout d’abord à voir avec l’oralité, et la musicalité ; ce qui signifie que les poèmes justifiés doivent être dits, à tout le moins lus avec l’oreille de l’œil, lus aussi comme une partition (partition qui laisse du reste au lecteur une grande part d’interprétation). Mes premiers textes justifiés étaient plus « musicaux » que les plus récents, et on les a généralement trouvés plus « poétiques ». Gérard Cartier s’en est bien rendu compte, et c’est le poème le plus récent qui lui a posé un problème, parce qu’il s’approche davantage de la prose, il se confronte à elle, il n’est pas loin de se confondre avec elle (sans renoncer à la musicalité).
Je ne suis pas un formaliste, c’est ce que dit le poème qui m’intéresse. Cette contrainte, la justification, si elle a tout d’abord servi à créer une nouvelle profération poétique, très vite il est apparu qu’elle me permettait tout simplement de dire ce que j’avais à dire, et que je ne parvenais pas à dire : il est pour moi absolument certain que je n’aurais écrit aucun de mes derniers livres, exprimé ce qui s’y exprime, sans elle.
Contrairement à ce que pense Gérard Cartier, elle demande un travail intense. La fonction « justification » des traitements de texte ne fait pas de miracles, elle n’apporte nullement une aide automatique, mais une résistance, au contraire, qu’il faut vaincre ligne après ligne.
Je ne peux en dire davantage dans le cadre de cette réponse. Je reprends seulement ci-dessous un texte de 2012. On le retrouvera dans le premier volume de mon livre Échafaudages dans les bois, à paraître cette année aux éditions Lurlure.
La JUSTIFICATION apparaît désormais comme un « système » particulièrement intéressant dans la problématique générale (actuelle) du poème et de la poésie parce qu’elle se configure, oui, peu à peu on peut voir qu’elle se configure avec les trois pistes, les trois « idées » dont j’ai parlé tout d’abord, comme avec les trois « niveaux de sens » que j’ai dégagés ensuite :
1. Elle intéresse le vers même, libéré de sa « coïncidence » avec le mètre ; elle permet le grand chevauchement vers/prose et l’éternel enjambement, parce qu’elle fonde un mètre sur un principe a- ou anti-rythmique. Étonnant paradoxe !
(le vers libéré du mètre ; le vers comme sens ― cinétique ― du poème)
2. Elle permet (je m’en suis expliqué plusieurs fois) la levée des censures, et bien plus efficacement que l’écriture automatique (nouveau paradoxe). Elle provoque une irruption plus forte du subconscient. ― En même temps, elle rend possible (toujours paradoxalement) une observation plus rapprochée de l’acte poétique, et donc du « fonctionnement réel de la pensée » (Breton). Elle peut servir d’appui à une nouvelle phénoménologie de l’imaginaire.
(l’image poétique ; le sens caché ou symbolique ; le « contenu »)
3. Elle est, je ne crains plus de le dire, dans l’histoire de la poésie (comprendre : la poésie comme histoire), non seulement une étape importante, mais une révolution véritable. Elle refonde le poème, elle modifie l’acte poétique dans son faire, et profondément… Elle relance la poésie comme histoire, et sans doute n’est-ce pas un hasard si elle a presque immédiatement (Martial Lengellé, Lucien Suel) réorienté le poème vers l’épopée.
(l’histoire de la poésie ; une poésie populaire).
Ivar Ch'Vavar
NDLR : Un livre d'Ivar Ch'Vavar à paraître aux Editions Lurlure reviendra largement sur la question du vers justifié.

