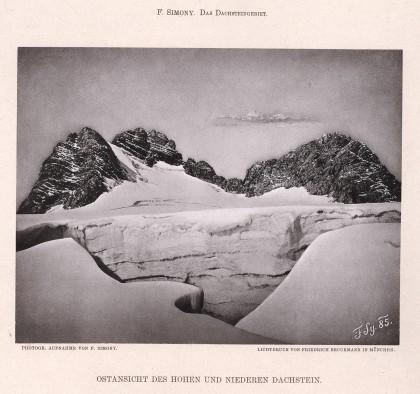
Comme de nombreux Français, j’écoute chaque année avec beaucoup d’intérêt le résultat du Livre Inter. Il s’agit d’un prix qui est attribué à un auteur par des auditeurs qui font acte de candidature pour lire une sélection proposée par la chaîne de radio France Inter, puis qui se réunissent en jury souverain, sous la présidence d’un écrivain.
Depuis plusieurs années je prépare ma lettre pour faire partie du jury…et je ne l’envoie pas car je ne suis jamais certain que j’aurai vraiment le temps de tout lire et que, le jour du jury, je pourrai vraiment me libérer.Et cette année n’a pas fait exception ! Comme je le regrette ! En tout cas, je reste admiratif du choix qui vient d’être fait. « Le prix a été attribué », comme on dit à…Henry Bauchau.
Je dois avouer qui j’ignorai son nom jusqu’à ce jour. Et je suis encore plus surpris lorsque je lis qu’il est né en 1913 en Belgique, qu’il est psychanalyste et que son œuvre est abondante dans le domaine poétique, théâtral et romanesque. Ainsi « Géologies », poèmes, paru chez Gallimard en 1958 a reçu le Prix Max Jacob. Il y a dans ce parcours, en effet, quelques prix, trop peu et relativement confidentiels et un très gros travail d’éditeur de la part d’Actes Sud.
Le roman primé aujourd’hui, que l’auteur termine en juillet 2007, s’intitule « Le boulevard périphérique ». On y verra là un ancrage parisien qui pourrait faire craindre du parisianisme; mais ce titre signale surtout l’importance d’une frontière dont les Parisiens connaissent la portée, en ce qui concerne le prix des logements, comme pour ce que l’on nomme aujourd’hui la sécurité et plus largement encore, en mesure de temps passé dans les transports en commun ou dans une voiture individuelle. Et pour les plus âgés, il s’agit même d’un rapport au monde sauvage et aux apaches, ces mauvais garçons de la banlieue.
J’ai vécu, de l’âge de quatre ans jusqu’à celui de quarante-six, au-delà du périphérique ; mais cette frontière là n’a remplacé pour moi les boulevards extérieurs – dits encore boulevards des Maréchaux – que dans les années soixante-dix. Je venais chaque jour d’une verdure relative vers la dureté grise et les plaisirs de la ville, et souvent, je suivais sous une pluie désespérante mes confrères, prisonniers eux aussi de leur migrations quotidiennes.
Le périphérique se mesure certes comme un cercle qui définit un dehors et un dedans, mais il se décrit plutôt en minutes ; celles qui séparent aux heures de pointe, une Porte d’une autre.
Henry Bauchau a accumulé de la douleur au cours de sa vie; avec un calme surprenant. Il a accumulé de l’expérience, en particulier celle du malheur des conflits puisqu’il est né à l’aube de la Grande Guerre. Mais dans ce roman, il se laisse conduire par un sentiment très personnel de l’inéluctable qui s’appuie sur les dernières étapes qui précèdent la mort de sa belle fille dans un hôpital parisien.Rien que de banal, mais un banal scandaleux, puisqu’il s’agit de la disparition d’une jeune femme, d’une jeune mère qui sait et ne sait pas qu’il lui reste peu de temps, qui fait des projets dont elle comprend au fond d’elle l’accomplissement peu probable. Rien de plus banal que le devoir de visite, quand un proche souffre et va disparaître. Ce que l’on doit à sa souffrance, même si on ne connaît ce proche qu’à distance, ou trop mal, ou partiellement, et qu’il est une pièce familiale rapportée.
Tout commence par :
« Le traitement contre le cancer a fait perdre ses cheveux à Paule. Je pense souvent, en la voyant si préoccupée de garder sa perruque bien en place, combien elle a dû souffrir en se découvrant chauve. »
Et tout finit par :« On apporte le cercueil, Mykha et Win le suivent. Je suis frappé par Win, il est beau, vêtu d’un blouson sombre et tient résolument la main de son père. A ce momentje n’ai plus de doute, il fallait vraiment qu’il revienne et qu’ils participent ensemble aux funérailles. »
Mais au début, comme à la fin, un contrechamp existe.« Stéphane, s’il avait vécu, s’il n’avait pas été assassiné en 1944 par les nazis, serait-il devenu chauve ? Je le verrai toujours tel qu’il était à vingt-sept ans, et dans ma mémoire il n’aura jamais été touché par le temps. Il me semble qu’il entre avec moi dans la chambre de Paule, avec ses yeux très bleus, ses cheveux blonds, sa taille haute, son sourire bref. Non pas timide mais réservé. Un homme de l’acte. »
Et à la fin, la dimension littéraire referme un couvercle avec gravité :« Le prêtre monte à l’autel, l’homme un peu anonyme de l’autre jour est dans sa chasuble, un prêtre revêtu d’une dignité singulière. Il fait signe à Mykha et celui-ci au pied de l’autel lit les lignes du texte de Ramuz. Je retrouve le piétinement un peu lourd, la recherche de la matière fondamentale, le goût pour une sorte de simplicité patriarcale de la vie que j’ai aimé dans ses livres. La Suisse, la montagne, la neige, le lac apparaissent dans mon esprit comme un espace définitivement perdu.”
Au cœur du livre, gravé dans le métal, vient peu à peu se mettre en place l’histoire d’une amitié exclusive qui est aussi de l’ordre du légendaire. Un mythe ronge le métal pour y imprimer un dessin en creux, celui de la violence des Nazis, mais d’une violence qui ouvre la question du mal absolu. Et dans l’écriture, l’ange blond fait face à l’ange noir, tandis que le rythme de sa vie présente de l’auteur est constitué du trajet en métro ou en voiture ; dehors dedans, dedans dehors. Mais la banalité engendre paradoxalement la structure d’un roman dont les chapitres s’ouvrent comme autant de portes situées au fond de chambres secrétes.
A cet âge de la vie, celui de l’auteur, où on ne juge plus ni Dieu ni Diable. On prend la vie et on l’accepte. Une station de métro devient un repère pour avancer matériellement, tout simplement pour encore mettre un pied devant l’autre. Le souffle d’un malade constitue un sursis pour avancer émotionnellement. Et le portrait d’un criminel nazi dessiné face à l’élégance d’un alpiniste, devient un moyen d’avouer dans l’allusion, la fabrique du roman.
Ce sont des strates d’intelligence, comme on en trouve trop rarement posées l’une sur l’autre. La première qui contient le sourire d’un médecin qui veut consoler, une autre qui enferme la querelle dans une chambre d’hôpital d’un couple que la mort va séparer, où une troisième qui aide à contempler le parcours dans l’autobus, quand se lit le racisme quotidien.
Et entre ces feuilles ordinaires, un peu transparentes parfois, tellement le papier en est fragile, viennent se placer des densités. La sortie d’un résistant ou d’un Juif, du temps de l’occupation, quand l’opposition calme des femmes qui tiennent à les protéger, se place devant les soldats et nous tire vers Zola :
« Nous sur le trottoir, on s’est serrées après le passage des garçons. Et quand les soldats et les SS sont arrivés avec leurs fusils et leurs matraques, ils se sont trouvés devant des femmes qui n’attaquaient pas, qui ne faisaient pas mine de se défendre. Qui criaient, qui criaient rien du tout. De plus en plus fort, dans quelle panique ! Et les voix s ‘élevaient vers l’aigu, tu connais la mienne, elle montait, elle montait, il me semble qu’on n’entendait plus qu’elle et peut-être c’était vrai. Mais les autres elles me l’ont dit, sentaient la même chose. Ils étaient là devant nous, les soldats d’occupation et les terribles SS, j’en ai vu deux qui avaient de longs fouets, je les ai montrés aux voisines et toutes nous avons regardé ces fouets…On criait à cause de quelque chose qui n’aurait jamais dû se vivre, quelque chose de honteux. Oui, quelque chose de honteux pour eux qui étaient aussi des fils de femmes, des maris, des amants, des pères, qu’est-ce que je sais, moi. On ne pouvait pas se battre, on ne pouvait tout de même pas pleurer, même s’il y avait pas mal pas mal de larmes sur nos joues. Alors, pâles, oui pâles de frousse et de dégoût, on criait de toutes nos forces en pensant – on se l’est dit après – en pleurant ou en riant enfin : « Pourvu, pourvu que je fasse pas dans ma culotte. Mais si je fais, tant pis. »
Ou encore la construction de la haine absolue :
« Sur la route, j’ai rencontré un des disciples, un homme riche, je lui ai dit de me donner beaucoup d’argent. Sans un mot il m’a emmené chez lui et il m’a donné tout ce qu’il avait chez lui. C’était une grosse somme. Quelque chose était fini et j’avais envie d’apposer ma signature à cette fin. Il l’a senti.Il est allé chercher sa femme et son fils et s’est enfui avec eux. J’ai mis le feu à sa maison et le suis rentré en Europe. Depuis je ne me suis plus servi de l’arc et, chaque fois que je concentre ma pensée sur un homme dont la mort me convient, je regarde sa mort en moi et je sais que je puis l’atteindre. »
Plus difficile enfin…et pourtant :
« Je voudrais faire l’économie de toutes les morts que j’ai vécues, de celles que je devrai vivre encore. Je ne peux pas, je suis dans ce temps, dans ce monde, il n’y en a pas d’autre. »
Et dans le roman, à l’égal de ceux de Mario Rigoni Stern, la fiction permet de convoquer les vivants et les morts, calmement, gravement, même si on plaisante avec eux, même si on éprouve pour eux une haine irrépressible.
La vie la plus ordinaire se tisse de légende, comme dans le quotidien des civilisations les plus antiques. Le roman, quand il atteint ce détachement et cette acuité, nous permet de partager un peu ce qu’éprouvent toujours ceux sur notre planète pour qui, derrière chaque visage, un dieu ou un démon tour à tour se repoussent, en attendant qu’un chaman les départagent.
Le candidat le mieux placé derrière Henry Bauchau était Sorj Chalandon pour “Mon traître”.

