***
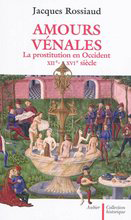
Amours vénales La prostitution en Occident, XIIe-XVIe siècle de jacques Rossiaud
Longtemps la bienséance académique a tenu dans l’ombre l’histoire des comportements sexuels et, a fortiori, celle d’un phénomène central dans les anciennes sociétés d’Occident : la prostitution. Depuis une trentaine d’années, les études se sont multipliées. Jacques Rossiaud, un pionnier en la matière, livre une belle synthèse des connaissances actuelles sur les « amours vénales » au temps où elles se pratiquèrent avec le moins de honte et la plus grande publicité, c’est-à-dire lors de la seconde partie du Moyen Âge. À l’époque de Jeanne d’Arc (v. 1410-1431) – et donc bien avant le XIXe siècle des « maisons de tolérance » enregistrées en préfecture –, des « prostibula » étaient officiellement administrées par la plupart des municipalités dans une bonne partie de la chrétienté. Parallèlement à ce « secteur public » proliférait « presque sans contrainte », à la ville comme aux champs, une « libre entreprise vénale » multiforme (maisons privées, étuves, mais aussi « bordelages d’assise et d’envergure artisanale » qui « prospéraient sur l’armée de réserve des prostituées secrètes et occasionnelles »). Le plus souvent, les autorités se contentaient de circonscrire tant bien que mal les aires concernées (il y a en avait près d’une quarantaine à Paris au XVe siècle), tout en imposant un respect minimal des fêtes religieuses. À Dijon, Uzès, Arles ou Albi, par exemple, les prostituées ne faisaient relâche que pendant la semaine sainte. Les magistrats prenaient alors en charge leur hébergement à l’écart et leur accordaient des indemnités pour le manque à gagner…
Nulle contradiction entre cet état de fait et la forte emprise du religieux. Au contraire, à partir du XIIe siècle, l’Église joua un rôle déterminant pour donner à la prostitution une place inédite dans les systèmes de représentation. Théologiens et confesseurs la considéraient désormais comme un moindre mal, nécessaire pour préserver non seulement l’ordre matrimonial, mais aussi l’ordre clérical. Le recours aux « fillettes » permettait en effet l’assouvissement des désirs mâles indéracinables dans les conditions les moins peccamineuses, celles de la « fornication simple ». Vierges ou femmes mariées étaient ainsi épargnées, le scandale du mariage des prêtres ou du concubinat évité. La casuistique et toute une « culture de l’équivoque » inclinaient à ne voir dans la fréquentation modérée du bordel qu’un péché mineur, infiniment moins préjudiciable que les autres actes luxurieux (constitutifs, eux, de « fornication qualifiée », parce qu’accompagnés d’adultère, de rapt, d’inceste, de sacrilège ou de « stupre »). Les prostituées elles-mêmes, aux yeux des ecclésiastiques, n’étaient pas irrémédiablement perdues ; le repentir, le mariage ou les vœux religieux pouvaient les racheter au terme de leur carrière. Quant à la commercialisation consentie du corps, elle n’était en rien condamnée. À l’inverse, la théologie déclarait le salaire des filles de joie licite et nécessaire, parce que contrepartie d’un ministerium (un service). Science de Dieu et pouvoirs séculiers s’accordaient ainsi pour (tendanciellement) assimiler la prostitution au monde de l’artisanat et l’intégrer dans le corps civique. De nombreux ecclésiastiques adoucissaient la rigueur de leur célibat auprès des bordelières ou des cantonnières (filles des rues et des tavernes). Rossiaud évalue leur proportion à 20 % de la clientèle dijonnaise. Il note aussi que les grandes assemblées conciliaires de Lyon (1245 et 1274), de Constance (1414-1418) et de Bâle (1431-1448) « furent, au plan de la vénalité, de totales réussites » ! L’omniprésence de la prostitution s’expliquait surtout par un impératif structurel de gestion des frustrations engendrées par un ordre conjugal inégalitaire (moins de 50 % des hommes avaient accès au mariage, en général tardivement ; les viols étaient fréquents, souvent collectifs et rarement punis). Foisonnant de vie et d’exemples révélateurs, le livre est écrit dans une langue riche, allègre et pleine de saveur. Le parti pris est celui d’une histoire des plaisirs bien plus que de la misère. Ces Amours vénales sont bien l’oeuvre d’un homme ; il faudrait pouvoir lire un jour une historienne sur le même sujet. Rossiaud pour autant ne minimise pas la triple oppression située au principe de son objet : oppression des hommes sur les femmes d’abord (la domination patriarcale, la « double morale » viriliste), des riches sur les pauvres ensuite (la contrainte économique était évidemment le premier facteur qui conduisait à la prostitution), enfin des vieux sur les jeunes (exclus en masse de l’accès aux « femmes honnêtes »). Rien de tout cela pourtant ne s’améliora lorsque, dans la première moitié du XVIe siècle, le développement des discours rigoristes et l’essor des États souverains (combinés à l’apparition de la syphilis) ouvrirent une ère de répression et de clandestinité.
Julien Théry
