Le Désaccord
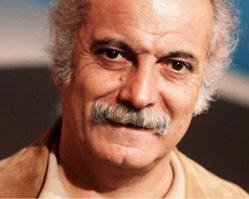
Quel temps fait-il
Chez les gentils
De l’au-delà
Les musiciens
Ont-ils enfin
Trouvé le la
( Le Vieux Léon)
La rime est on ne peut plus riche : le la n’existe en effet peut-être que dans l’ « au-delà ». De même que dans la nature, ici-bas, il n’y a ni cercle parfait, ni ligne droite, il ne peut y avoir de son juste. Le la est un son rêvé, une utopie, un lieu idéal où les harmoniques se renvoient des échos dans la rotation des sphères qui se caressent. C’est un ciel où tout vibre ensemble, donnant aux mouvements une telle régularité que le temps s’abolit. C’est un espace pur, hors des heures, dont l’orgue semble parfois s’approcher lorsque ses sons roulent sous les voûtes gothiques longtemps après que les pieds et les mains du musicien ont quitté les claviers. Ces éblouissements lourds d’étoiles mortes nous chantent ainsi la suspension éternelle des ogives intouchables.
Ce n’est pas humain. La note juste est un au-delà tendu – comme les cordes de la guitare – mais, sur la terre le temps la défait. Tandis que la musique joue, le temps dévide la corde en sous-main et la mélodie se fait autour d’une ligne imaginaire dont on s’écarte souvent. J’écoute : je guette le froissé du faux qui cherche la justesse. La fausse note chante le fossé qui sépare le ciel de la terre, le rêve de la réalité et donne à nos vies des allures de presque. J’aime dans la musique ce léger désaccord, le risque toujours joué d’un effleurement, car le jeu, jouer d’un instrument, chanter, c’est entrer dans cet imparfait magnifique de nos vies qui s’appelle liberté, où chaque seconde à venir est imprévisible.
Et chacun est à l’autre sa fausse note. Sinon ce serait moi. Heureux dérangement de mon intériorité folle, le visage de l’autre oblige au retour au réel ; le différent est ma chance : nos yeux doivent s’adapter. C’est le bonheur du langage où l’on se promet des messages, des signes souriants au plein cœur du scandale de la non-ressemblance. La vie est un allegro ma non troppo où les graves et les aigus tentent d’avancer ensemble malgré les clefs différentes. Dans les villes nos pas se croisent et chacun, depuis sa ligne mélodique ténue, tente de jouer sa partie avec les autres, hors d’eux, seul, mais dans le même temps. La rumeur grouillante des boulevards dit tous les jours que c’est possible, qu’il faut y croire, que l’approximatif et le faux sont notre espoir.
L’immense danger de vivre aujourd’hui est le refus du désaccord. Le progrès technique a produit des instruments qui émettent des sons parfaits. Des voix trop pures nous ont habitués à la note juste. C’est ainsi qu’avec les nouvelles techniques d’enregistrement, le ciel est descendu sur la terre : nos rêves se réalisent. L’utopie est aux tympans, tuant la possibilité d’un écart qui permettrait de sortir de ces flots de musique qui recouvrent la terre. Si l’harmonie doit être chantée, recherchée, il est parfaitement immoral que nous la trouvions, car alors la joie et le rire, l’impromptu et la surprise deviennent obscènes, incorrects, non conformes. Le désastre de la musique des sphères nous guette et l’imitation du chant des Sirènes ouvre au silence. C’est la mort du futur.
Heureusement les mots, comme les cordes, se détendent et se lestent d’approximations humaines. Ainsi l’harmonie désigne-t-elle un orchestre d’instruments à vent de type militaire qui souffle la tempête dans nos rues. Les musiciens défilent, traversent les villes, obligeant le corps du musicien à marcher au pas contre le désordre quotidien des avenues. C’est un « Taisez-vous ! » qui donne le la de l’ordre laïque. Et il y en a pour applaudir ! Par chance, l’harmonie joue faux et son ridicule sauve notre liberté. Si elle jouait juste, le chef de ces exécutants pourrait installer un pouvoir éternel.
Le jour du quatorze juillet
Je reste dans mon lit douillet
La musique qui marche au pas
Cela ne me regarde pas.
Voilà ce que Brassens exècre : la musique engendre l’obéissance des corps, c’est-à-dire la morale absolue où l’indifférenciation étouffe la voix du sujet (forcément mauvais). Au temps d’égalité, le tympan aspire au tambour – peau tendue de bête égorgée – , il n’a de cesse d’entrer en résonance avec un monde en ordre. La guerre attend là, juste derrière.
Il dort dans l’oreille un « Tout plutôt que le silence » dont la musique s’empare un peu plus chaque jour pour faire de l’auditeur une chose, un objet, rien : c’est un danger fabuleux d’idéal communautaire dont les dictateurs de ce siècle ont joué avec une virtuosité étourdissante. Mais la musique d’obéissance ne s’est pas arrêtée avec leur disparition, le danger s’accroît chaque jour davantage.
Brassens fait du désaccord son plus sûr allié. Il défend le droit d’être différent de ce qui perdure : coutumes, traditions, « évidences ». Sa liberté est dans la voix qui s’aggrave, devient fausse parfois comme un effet de pesanteur.
Bien sûr le rythme doit être tenu puisque le cœur bat, puisque nos pas se font naturellement réguliers : sur les grands fonds de cette loi organique, l’artisan bricole des petits rêves où copeaux et éclats jaillissent pour figurer sa révolte. Le « swing » omniprésent dans ses enregistrements n’est rien d’autre que ce balancé souple où la voix de l’opprimé se moque du rythme imposé : même lorsqu’il n’y a pas de triolets dans une mesure simple ou de duolets dans une mesure composée. Brassens s’évertue à chanter « à côté ». Le contre-temps est résistance au temps fort. Il joue le faible, l’entre-deux du pas ; ironie musicale, croche-pied à l’ordre, il avance de biais pour enfoncer la contestation jusqu’au fond de la mémoire. Le « pas d’accord » de l’anarchiste est plus puissant encore dans la mélodie que dans les mots. Il pousse sa différence au maximum lors des séances d’enregistrement puisqu’il ne réécoute jamais, reprenant peu, laissant le crissement des barrés et les étranglements de la voix éclabousser la chanson.
On imagine l’effroi de Brassens, quand, le 6 mars 1952, Patachou, après avoir entendu quelques chansons lui dit : « Écoute Georges, des chansons comme Le Gorille, La Mauvaise Réputation, Corne d’Aurochs, Le Fossoyeur ne sont pas des chansons pour moi, c’est toi qui vas les chanter. » Il ne se concevait alors que comme auteur de chansons. Il composait d’ailleurs sur clavier et n’avait appris la guitare que parce que ses chansons étaient plus faciles à présenter. Il chantait bien sûr, mais pour les copains, pour amuser Jeanne et se prouver que ses bricolages étaient audibles.
Et voici qu’il doit « enchanter » un public, c’est-à-dire l’obliger à se taire, provoquer le silence, imposer sa maîtrise, lui, l’autodidacte boulimique de la bibliothèque du 15ème arrondissement, le géant de l’Impasse, l’Ours, le « Gros » qui traînait en savates dans son quartier depuis dix ans !
Comment l’anarchiste peut-il être maître du silence ? Comment susciter la liberté absolue dans le temps où l’on dit : « Écoutez-moi ! » Sa chance est alors d’affirmer qu’il n’est pas poète mais auteur de petites chansonnettes. Il amuse, détourne, multiplie les clins d’œil et ne fait rigoureusement aucun effort pour plaire. Il se contente de :
Se gratter le ventre en chantant des chansons.
Si le public en veut, je les sors dare-dare
S’il n’en veut pas je les remets dans ma guitare…
(Les Trompettes de la renommée)
Il ne cherche que l’écho. Un pied sur la chaise, des milliers vont l’écouter comme si l’on était chez lui. Filant de ville en ville, ne saluant jamais, il va faire de toutes les salles un temple pour l’oreille, et les gens se bousculeront pour vérifier qu’il n’existe pas seulement sur le disque, mais qu’il est comme eux, de chair et de sang, n’en croyant pas leurs yeux ni leurs oreilles de l’entendre expédier ses perles : « Il est comme nous, mais quel culot ! » On l’envie, on le désigne par sondage comme « l’homme le plus heureux de France » (réaction de l’intéressé : « Les cons ! ») mais au dehors, il s’exprime le moins possible, ne prenant position sur aucun problème social, économique ou politique (sauf contre la peine de mort), renvoyant systématiquement à ses chansons. Il y a un émetteur, des millions de récepteurs. Il se moque du retour.
Vivre ce n’est donc plus rôder dans l’Impasse, mais se poser sans s’imposer, avec pour tout langage les paroles de ses chansons. Il déclare simplement que le public est « aussi intelligent » que lui et il emprunte la « route buissonnière » de la suggestion. Il conte, chante et s’en va plus loin, et le jour où il quittera l’Impasse, il refermera tous les soirs la porte blindée de sa villa rue Santos Dumont… ou bien, seul dans sa loge, il se cloîtrera pour tirer sur les cordes d’acier de sa guitare qu’il retend un peu vainement avant chaque récital.
Jouer faux, laisser aller sa voix sans le vouloir, tourner autour de la justesse, éviter la battue du temps rythmé, c’est donner aux mots très écrits l’imperfection de la vie, imiter les faux pas du présent, présenter l’incomplétude de nos existences comme un chant possible. La perfection de Brassens est dans l’association d’une langue ornée et de ces petits ratés successifs : il ne nous expédie pas vers un azur impeccable qui laisserait sans voix, mais il nous prend par la main, là où nous sommes, et tout en nous gardant à l’intérieur de nos trébuchements, il nous fait rire ou pleurer dans la petite pièce où il a décidé de se tenir. Lorsqu’on l’écoute chez soi, on ne peut s’empêcher de chanter avec lui, c’est la même voix, la même mémoire, ce n’est pas lui qui nous possède, mais nous qui nous emparons de lui. Un disque présente une suite de tableaux que l’on découvre lentement, sautant celui-ci, musardant sur celui-là, à la syllabe près, mais toujours notre voix s’en vient couvrir la sienne, imitant son boitillement décalé qui nous écarte de la fascination. Il nous propose son terrain pour que chacun s’y ébroue à sa guise en riant.
C’est la raison pour laquelle nous avons tous rêvé d’être de ses copains, jalousant les vrais, car ses chansons nous ramenaient à chaque fois dans la maison des rimes et que nous aurions aimé partager avec lui quelques instants de la grande prose des jours. On aurait voulu respirer avec lui l’air instable du temps vécu, avec l’espérance de retrouver dans ce moment le petit monde idéalement clos de ses chansons. C’est un rêve d’enfant. « Tonton Georges » n’aurait pas été d’accord, il nous aurait renvoyé à ses chansons, à notre solitude, arguant que l’on n’avait pas compris le lien qu’il voulait établir avec nous. Oncle Archibald, Tonton Nestor, sont ces parents à la fois proches par la filiation et lointains dans la réalité. C’est le nom populaire de l’artiste ; c’est le sujet créateur, ce père de cœur qui garde ses distances, engendrant des œuvres plutôt que des enfants afin de se (de nous) préserver de toute dépendance. Il s’agit une fois de plus d’un démarquage, d’un pas de côté discret, d’un effacement rieur qui dit en s’éloignant que l’on s’aime bien, mais que pour préserver cette affection il convient de ne pas vivre ensemble. C’est la leçon du père, le grand maçon de Sète : des murs pour éviter toute fusion et garder le respect de notre intimité. La déclaration d’amour stupéfiante :
J’ai l’honneur de
Ne pas te de-
mander ta main…
(La Non-demande en mariage)
vaut aussi pour chacun de nous. Pour « s’entendre », il faut marquer le désaccord (« lui c’est lui, et moi c’est moi ») afin que l’entente se développe – tout près on n’entendrait plus rien – , hors de la morsure de l’autre, loin de ces rapports de forces qui guettent les cœurs en fusion. Être deux n’est possible que si l’on reste seul, et de toute façon :
Dès qu’on est plus de quatre
On est une bande de cons
(Le pluriel)
Ces désaccords accumulés sont à ses chansons ce que figurent les pierres moussues sur les chefs-d’œuvre d’architecture. Ils sont les creux et les bosses qui nous séduisent dans les meubles anciens et font le charme fou des robes de lin dont les fils forment une trame irrégulière. Les créations d’aujourd’hui – comme les marchandises – sont lisses, belles, policées, propres, mais elles ne donnent pas envie de vivre libre. Seule la trace préservée de la main humaine ouvre l’œuvre comme une paume tendue. Ainsi gardons-nous en mémoire les aspérités de sa voix qui plus encore que les mots sont attendues ; elles nous stimulent contre la glissade du temps qui ne bat que pour nous. Ses paroles sauvages et sa patte qui gratte à notre porte nous maintiennent à mi-chemin, entre l’effusion et le silence.
