_____________
Revue de livre par Geoffroy L.
La mondialisation selon Bhagwati
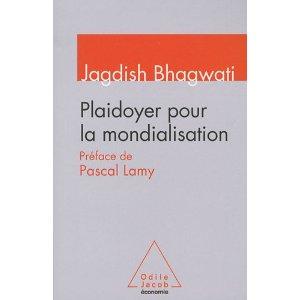 Recension par Geoffroy L. – Le 5 janvier 2012. S’il n’est pas rare que les intellectuels qui s’expriment sur la mondialisation dans le débat public aient une connaissance lacunaire de la science économique, ce n’est pas le cas de Jagdish Bhagwati. Cet économiste indien, Professeur à l’Université de Columbia (Etats-Unis), contribue depuis un demi-siècle à faire reculer la frontière de la connaissance en économie internationale, en particulier sur les questions de politique commerciale et d’économie du développement.
Recension par Geoffroy L. – Le 5 janvier 2012. S’il n’est pas rare que les intellectuels qui s’expriment sur la mondialisation dans le débat public aient une connaissance lacunaire de la science économique, ce n’est pas le cas de Jagdish Bhagwati. Cet économiste indien, Professeur à l’Université de Columbia (Etats-Unis), contribue depuis un demi-siècle à faire reculer la frontière de la connaissance en économie internationale, en particulier sur les questions de politique commerciale et d’économie du développement. Dans son livre In defense of globalization (Oxford University Press, 2005), Bhagwati dissèque avec expertise les dogmes de l’altermondialisme. Selon cette doctrine, la mondialisation aurait des effets sociaux délétères : elle nuirait aux pauvres, desservirait les minorités, détruirait le pluralisme culturel, tirerait les salaires vers le bas, dégraderait l’environnement. L’objet du livre de Bhagwati est de montrer que ces croyances sont infondées.
Sur la pauvreté, d’abord. L’ouverture sur le monde, nous dit Bhagwati, est un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. En élargissant la division du travail, le commerce international accroit la productivité, augmente les revenus et, partant, réduit la pauvreté (pp. 60-64). Si certaines zones restent pauvres, c’est qu’elles sont à l’écart de la mondialisation. Les exemples récents de succès économiques liés à l’adoption du libre échange confirment cette thèse : « En Chine, la pauvreté est passé de 28% en 1978 à 9% en 1998 » (p. 65). Le succès est encore plus fort en Inde : « le taux de pauvreté est passé de 51% en 1977 à 26% en 1999-2000 » (p. 65).
Non seulement la mondialisation réduit la pauvreté, mais elle contribue aussi à éliminer certains maux que les altermondialistes lui associent à tort. Le travail des enfants est un cas typique. La mondialisation, en réalité, « accélère la réduction du travail des enfants, augmente le taux d’inscription à l’école primaire et donc l’alphabétisation » (p. 68). Pourquoi ? Car la consommation des services d’éducation augmente à mesure que le revenu croît. Or, la mondialisation fait croître le revenu des ménages. Par ce biais, elle conduit ces ménages à inscrire leurs enfants à l’école et, partant, contribue à atténuer le phénomène du travail infantile. Cette idée est confirmée par les études économétriques. Au Vietnam, par exemple, les ménages qui ont vu leur revenu croître à la suite de la libéralisation du début des années 90, ont, pour la plupart, cessé de faire travailler leurs enfants pour les inscrire à l’école (p. 71).
Qu’en est-il du sort des femmes dans la mondialisation ? Dans nombre de pays, l’ouverture internationale contribue à réduire les discriminations illégitimes à leur égard. Comment ? En intensifiant la concurrence, la mondialisation rend de plus en plus difficile, pour les producteurs, de louer les services du travail à un salaire inférieur à la contribution de l’employé : cela conduirait les concurrents à enchérir sur le prix du travail pour saisir l’opportunité de profit. Autrement dit, la mondialisation rend peu profitable la stratégie consistant à payer moins les femmes que les hommes à contribution égale à la production. La discrimination est une stratégie perdante au sein de la mondialisation capitaliste (pp. 75-76).
Une autre crainte souvent exprimée par les altermondialistes concerne la culture. Selon eux, la mondialisation conduirait à une « américanisation du monde » et à la destruction des cultures indigènes. Cette vision, en vérité, est « bien trop simpliste et pessimiste ; car bien souvent la mondialisation économique est un processus d’enrichissement culturel » (p. 107). La rencontre des cultures crée des mélanges : « l’utilisation locale de langages indigènes a été revitalisée, à côté de la propagation internationale de l’anglais » (p. 110). Ensuite, les cultures non américaines s’épanouissent aussi dans la mondialisation. Par exemple, « les films recevant des récompenses viennent d’Iran, de Hong-Kong, du Danemark, d’Inde, de Grande-Bretagne, de France, entre autres pays » (p. 112).
Dans l’opinion populaire, la mondialisation est aussi associée au « dumping salarial et social ». Selon cette logique, la concurrence accrue des pays à bas coûts salariaux et à faible protection sociale conduirait tous les gouvernements à revoir à la baisse leurs standards salariaux et sociaux pour conserver leurs entreprises. Cet argument est problématique (p. 130). Il suppose, à tort, que les entreprises choisissent de s’installer là où les salaires et la protection sociale sont faibles. En réalité, d’autres variables sont bien plus importantes dans la stratégie de localisation des firmes : productivité du travail, accès aux matières premières, potentiel du marché local, qualité des institutions…
Si l’idée du dumping salarial et social n’est pas fondée, assiste-t-on à une course vers le bas des normes environnementales ? Là encore, la réponse est négative. L’environnementalisme, en effet, est le produit des sociétés riches. A mesure qu’une société s’enrichit, ses membres aspirent à prendre soin de leur environnement. En propageant la prospérité, la mondialisation propage les préoccupations environnementales. Par ailleurs, comme dans le cas de la protection sociale, il est faux d’affirmer que la régulation environnementale est une variable clé dans le choix de localisation des firmes : « La conclusion des études internationales et domestiques sur la localisation des industries est que les régulations environnementales ne dissuadent pas de façon statistiquement ou économiquement significatives les investissements des firmes » (citant Arik Levinson, p. 148).
Bhagwati défend ensuite l’institution que les altermondialistes abhorrent : les firmes multinationales (FMN). Contrairement à ce qu’affirment les altermondialistes, les FMN n’exploitent pas les travailleurs. Bien souvent, ces entreprises proposent aux travailleurs des pays où elles s’installent la meilleure opportunité disponible. Les FMN, en effet, payent une prime salariale (« wage premium ») : « Les multinationales payent un salaire moyen qui excède le salaire courant, en général de plus de 10% et parfois plus, certaines filiales de FMN américaines payant une prime allant de 40 à 100% » (p. 172). Ensuite, les FMN génèrent aussi des externalités positives. Lorsqu’une multinationale s’installe dans un pays, elle apporte avec elle des connaissances techniques et des pratiques organisationnelles. Les firmes locales tirent profit de ces savoirs grâce à la transmission d’information et aux mouvements inter firmes de travailleurs (p. 181).
En résumé, la mondialisation n’est pas le processus de prédation que les altermondialistes dénoncent. La mondialisation a un visage humain. A l’heure où la majorité des partis politiques français accable l’ouverture sur le monde et plaide pour une forme ou une autre de protectionnisme, la lecture de In defense of globalisation est rafraîchissante. Cette recension en extrait les idées les plus pertinentes pour le débat public. Bhagwati y traite d’autres questions, que le lecteur intéressé découvrira de lui-même : ONG, flux financiers, migrations et politiques publiques. Il est à noter enfin que In defense of globalisation a récemment fait l’objet d’une traduction française, particulièrement bienvenue (Plaidoyer pour la mondialisation, Odile Jacob, 2010).

