Quel soleil chavire ta langue ?
« Ce qui fait scandale… c’est sa sincérité » Jean Renoir à propos de P. P. Pasolini.
***
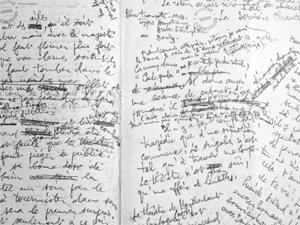 Entre le contrebas de la grande poste, entre les arcades du boulevard Che-Guevara et la mer, à Alger, il est un petit square appelé Sofia où quelques hommes et de vieux bananiers dorment dans la touffeur de juillet. L’autocar qui mène à Aïn Benian est déjà bondé. Il longe la casbah puis le quartier de Bab El-Oued par le sud, traverse Saint-Eugène, ou plutôt Bologhine, suit vers Raïs Hamidou, la pointe Pescade, franchit le cap Caxine, poursuit sur l’avenue du Président Hô-Chi-Minh, et file toujours par la corniche vers Aïn Benian, l’ancien Guyotville. Il suffit alors de traverser. Le cimetière grimpe depuis le bord de mer. J’ai dans un livre avec moi plusieurs photos de la tombe de Jean Sénac.
Entre le contrebas de la grande poste, entre les arcades du boulevard Che-Guevara et la mer, à Alger, il est un petit square appelé Sofia où quelques hommes et de vieux bananiers dorment dans la touffeur de juillet. L’autocar qui mène à Aïn Benian est déjà bondé. Il longe la casbah puis le quartier de Bab El-Oued par le sud, traverse Saint-Eugène, ou plutôt Bologhine, suit vers Raïs Hamidou, la pointe Pescade, franchit le cap Caxine, poursuit sur l’avenue du Président Hô-Chi-Minh, et file toujours par la corniche vers Aïn Benian, l’ancien Guyotville. Il suffit alors de traverser. Le cimetière grimpe depuis le bord de mer. J’ai dans un livre avec moi plusieurs photos de la tombe de Jean Sénac.
Notre chemin procède par énigmes
La porte du cimetière tient seulement par un cadenas ouvert. Dans les allées reprises par la végétation, les tombes propres portent des noms et dates déjà anciens, Mazella, Franzoni, Chazot, Sintès, 1947, 1956, 1951, 1922. Il faut monter un peu. Au dernier flanc, au fond, il y a une tombe ovale, la seule du genre, légèrement à l’écart des autres. La matière dont elle est faite aussi est différente, des pierres brutes. La tombe est posée comme un gros œuf sur le sol. Tout autour, un petit muret monte à 60 centimètres. La tête est comme relevée.
Dans le document que j’ai apporté, je lis : « Le 29 novembre, jour de son anniversaire, Mireille, avec Hamid Nacer Khodja, a planté la tombe, absinthes, petits iris bleus, thym, romarin, géraniums… dessus, entre les pierres, et en prolongement, ainsi qu’un petit figuier. J’ai demandé à Denis Martinez, peintre ami de Jean, de faire une plaque de terre cuite carrée que nous mettrons au pied, scellée… » (lettre de Jean de Maisonseul, peintre et urbaniste, à Jean Pélégri, écrivain, en 1974).
Je suis devant cette tombe, la tombe de Jean Sénac construite sur le modèle des tombes kabyles du petit cimetière musulman tout près. Un large espace vide descend devant elle. Sur le dessus, il y a bien un figuier, des plantes en terre, plantes roturières surtout, mais de plaque, aucune. De plaque, non, avec le nom « Jean Sénac » où j’aurais dû lire, comme sur la photo : Beni- Saf 29 novembre 1926, Alger 1er septembre 1973. Il n’y a qu’un minuscule jardin sauvage entre des pierres sèches sur un terrain en pente, face à la mer.
Ainsi, Jean Sénac, te voilà, toi, une fois encore sans nom, sans personne ! Quelqu’un aura volé cette plaque. Un ballon l’aura cassée. Des coups de pied ? Des coups de haine dans la terre cuite ? Et même ? Ou rien. Le vent, du rien qui aura fendu le nom. Liquidés les mots, les chiffres, les repères.
Ce que je pensais alors me sortit par des frissons sur les avant-bras. Sans doute surgirent-ils à la deuxième syllabe du mot « repère » en même temps que l’écho de la mince existence de Jean Sénac, de ses combats considérables et du vide inhabitable, soudain, tout autour de nous.
L’autocar qui me ramena d’Aïn Benian était presque aussi plein que celui de l’aller. Mères et grands-mères à couffin, vieux en turbans, le clin d’oeil preste à l’Européen qui revient, adolescents nombreux, étonnamment calmes, jeunes filles au front studieux, discrets garçons aux pensées invisibles.
En ville, je trouvais un graveur et, chez lui, un modèle de plaque d’une matière synthétique mais revêtue d’une fine couche de métal doré. Au moins cela. Au graveur, je donnais consigne du texte, le même qu’à l’origine mais avec la modification de date qu’avait proposée Jean de Maisonseul : Jean Sénac était mort le 30 août 1973. Il fallait aussi un soleil. Contrairement à Cocteau, J. S. plaçait un soleil sous sa signature. Il y avait quelque chose d’une nuit glaciale dans le soleil de Jean Sénac.
Je récupérais la plaque sans fautes. Le soleil avait été reproduit à l’ordinateur, un peu raide, avec six branches au lieu de cinq, mais au moins il était là. Au cimetière d’Aïn Benian, le lendemain, j’avais avec moi la plaque percée de quatre trous et quatre mètres de fil de fer souple pour la fixer (je verrais bien !) entre les pierres. Un petit homme avait l’air de m’attendre, le même que la veille, le gardien sans doute. Il me suivit jusqu’à la drôle de tombe kabyle, réfléchit puis me proposa d’aller chercher un marteau et des clous. Puis, il revint et s’agenouilla. Tous les deux nous avons choisi l’emplacement, tous les deux nous avons vérifié que tout soit droit. Il a planté l’un après l’autre les clous, tandis que je tenais la plaque. C’était un petit travail important. Une fois la plaque posée, l’homme s’est retiré, comme s’il avait voulu me laisser seul. J’ai regardé la terre sur le dessus. Un tas de choses vibraient. Je crois avoir vu des abeilles, des escargots, des insectes qui sautaient, je ne sais pas. Il me semble qu’un rayon de soleil est venu se coucher sur tout cela. J’ai posé ma main sur la pierre sèche. Un court instant, j’ai laissé ma main l’envelopper.
En sortant, à la porte du cimetière, une femme venue d’on ne sait d’où passa devant nous, seule, âgée, un petit voile sur son nez, le laadjar, comme souvent les Algériennes. Je vis à peine ses yeux mais ils pétillaient de malice. Le gardien me fit comprendre que je devais l’aider aussi. La vieille saisit la pièce et continua à descendre vers la route principale, celle qui longe la mer, celle des véhicules et de mon autocar. Sans se retourner, elle eut cette phrase, lancée telle quelle, dans un semblant de français mais comme en une langue multiple : « Que Dieu le repose ! » Oran était la ville de toutes les races. Tout le monde était là, l’Arabe, l’Espagnol, le juif, le Français, le Berbère. Racistes, tous l’étaient, selon Sénac 1. Les injures : « Sale raton », « Tronc de figuier ». « Baise le chien sur la bouche jusqu’à ce que tu en aies obtenu ce que tu désires. » Et la grand-mère disant : « Je vais te donner au méchant Arabe » – El Moro malo. Car tous vivaient dans ce décor si mystérieux où l’arabe est incompréhensible, dans un décor qui lui colle mieux qu’à tous les autres. Et passent les nomades et les fruits rutilants et les pas des chevaux et les fusils fumants de la fantasia. Dans sa préface à Ébauche du père, Rabah Belamri cite un texte de Sénac d’août 1972, soit un an exactement avant son assassinat. Sénac vit à Alger dans un extrême désarroi : « Cette nuit, dans ma minuscule cave, après avoir franchi les ordures, les rats, les quolibets et les ténèbres humides, à la lueur d’une bougie, dix ans après l’indépendance, interdit de vie au milieu de mon peuple, écrire. Tout reprendre par le début, et d’abord cet essai de roman qui jaunit depuis octobre 1962 dans une valise et dont je ne déplacerai pas une virgule… » C’est que toute une vie, ou presque, a dévoilé pour Sénac une certaine équation : si l’arabe est l’illisible, le mauvais, l’exclu, alors lui, le bâtard, est son frère de sang… « À tel point qu’un jour, on se réveilla presque collés, frères siamois… Silence, humiliation, frustration, c’étaient les miens. » Si l’on veut suivre les allers et venues de Sénac, Ébauche du père est un guide où se succèdent l’avant, l’après, le pendant, l’impossible, le mystère et le rêve de l’homme et du poète.
S’il s’affirme constamment algérien, Jean Sénac porte trois décors, trois histoires, trois pays. L’Espagne d’abord, en antériorité. Ses racines sont espagnoles (comme chez Camus du côté maternel), catalanes sûrement – le grand-père dans la mine – gitanes peut-être – le père sauvage, comme sans patrie. Lorsqu’il pense à cela, c’est « comme une bouffée d’absinthe ». Il y a là quelque chose d’une puissante geste, d’une vibration éternellement triste et nerveuse au même instant. Pour Sénac, l’Espagne s’appellera aussi Federico Garcia Lorca. La France est le pays de la langue. Il n’y a aura pas d’autre langue, en écriture, que celle du pays de France. De cette langue, il dit qu’elle est sa gloire et sa force, mais, dans le même temps, la maudit. Il s’en veut de ne pas connaître l’arabe, se le reproche un moment (« en tant qu’intellectuel algérien »), puis, la quarantaine passée, renoncera à l’apprendre. Après tout, elle est sa gloire, sa force, et même Kateb Yacine eut ce mot : « Le français, un butin de guerre. » La France, ce sera aussi l’espace de la « métropole » : Paris, Gentilly, Marseille, Briançon, Châtillon-en-Diois… Et en dépit de telle accroche, de telle autre attache, l’Algérie restera la mère. L’Algérie, « droite et frappée dans le soleil » n’est pas seulement nourricière, elle est significative des matins du monde, des naissances. Affectivement, politiquement, poétiquement, tous plans confondus.
Éric Sarner
(1) Et Lorca : « Je suis de Grenade qui est une ville juive, gitane et musulmane », puis, après son voyage à New York, il ajoute : « Je suis noir aussi. »
N° 93 – Les Lettres Françaises mai 2012
