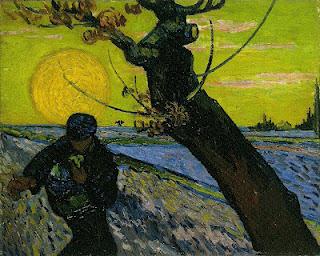 Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à
laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce
qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs
rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,
avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le
trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à
l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès
le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en
être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont
il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme
de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire
drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids
supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni
fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame
de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à
leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais
pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs
désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train
qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac
de la vie.
Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est
une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui
constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est
rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser
aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support
est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux
possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que
l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.
Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile
s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la
première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de
regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être
peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la
terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme
généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et
prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,
sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres
(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif
dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant
pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses
passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,
son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,
l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le
dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à
Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures
qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui
l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux
mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait
dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a
la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel
aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :
parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,
pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son
fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son
marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des
peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être
compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,
c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine
l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le
comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un
peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,
un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude
relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.
Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez
Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300
tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de
900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en
aura peint qu’une petite cinquantaine.
Le semeur, 1888.
Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à
laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce
qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs
rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,
avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le
trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à
l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès
le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en
être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont
il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme
de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire
drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids
supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni
fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame
de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à
leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais
pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs
désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train
qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac
de la vie.
Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est
une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui
constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est
rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser
aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support
est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux
possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que
l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.
Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile
s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la
première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de
regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être
peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la
terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme
généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et
prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,
sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres
(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif
dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant
pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses
passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,
son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,
l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le
dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à
Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures
qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui
l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux
mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait
dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a
la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel
aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :
parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,
pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son
fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son
marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des
peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être
compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,
c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine
l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le
comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un
peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,
un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude
relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.
Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez
Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300
tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de
900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en
aura peint qu’une petite cinquantaine.
Le semeur, 1888.
Magazine
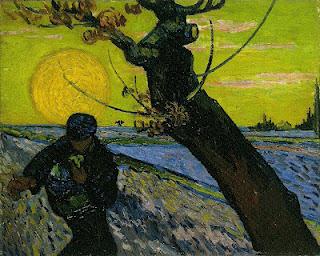 Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à
laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce
qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs
rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,
avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le
trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à
l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès
le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en
être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont
il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme
de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire
drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids
supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni
fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame
de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à
leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais
pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs
désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train
qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac
de la vie.
Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est
une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui
constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est
rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser
aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support
est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux
possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que
l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.
Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile
s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la
première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de
regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être
peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la
terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme
généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et
prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,
sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres
(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif
dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant
pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses
passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,
son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,
l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le
dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à
Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures
qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui
l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux
mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait
dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a
la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel
aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :
parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,
pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son
fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son
marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des
peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être
compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,
c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine
l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le
comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un
peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,
un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude
relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.
Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez
Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300
tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de
900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en
aura peint qu’une petite cinquantaine.
Le semeur, 1888.
Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à
laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce
qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs
rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,
avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le
trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à
l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès
le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en
être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont
il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme
de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire
drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids
supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni
fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame
de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à
leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais
pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs
désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train
qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac
de la vie.
Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est
une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui
constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est
rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser
aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support
est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux
possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que
l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.
Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile
s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la
première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de
regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être
peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la
terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme
généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et
prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,
sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres
(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif
dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant
pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses
passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,
son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,
l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le
dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à
Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures
qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui
l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux
mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait
dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a
la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel
aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :
parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,
pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son
fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son
marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des
peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être
compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,
c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine
l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le
comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un
peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,
un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude
relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.
Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez
Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300
tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de
900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en
aura peint qu’une petite cinquantaine.
Le semeur, 1888.
