En 2 ans, le conflit social de l'usine Fralib a dégénéré en bataille de tranchées comme seule la France est capable d'en produire. Récit des événements qui ont conduit à cette situation de blocage.
Par Mathieu Morateur.
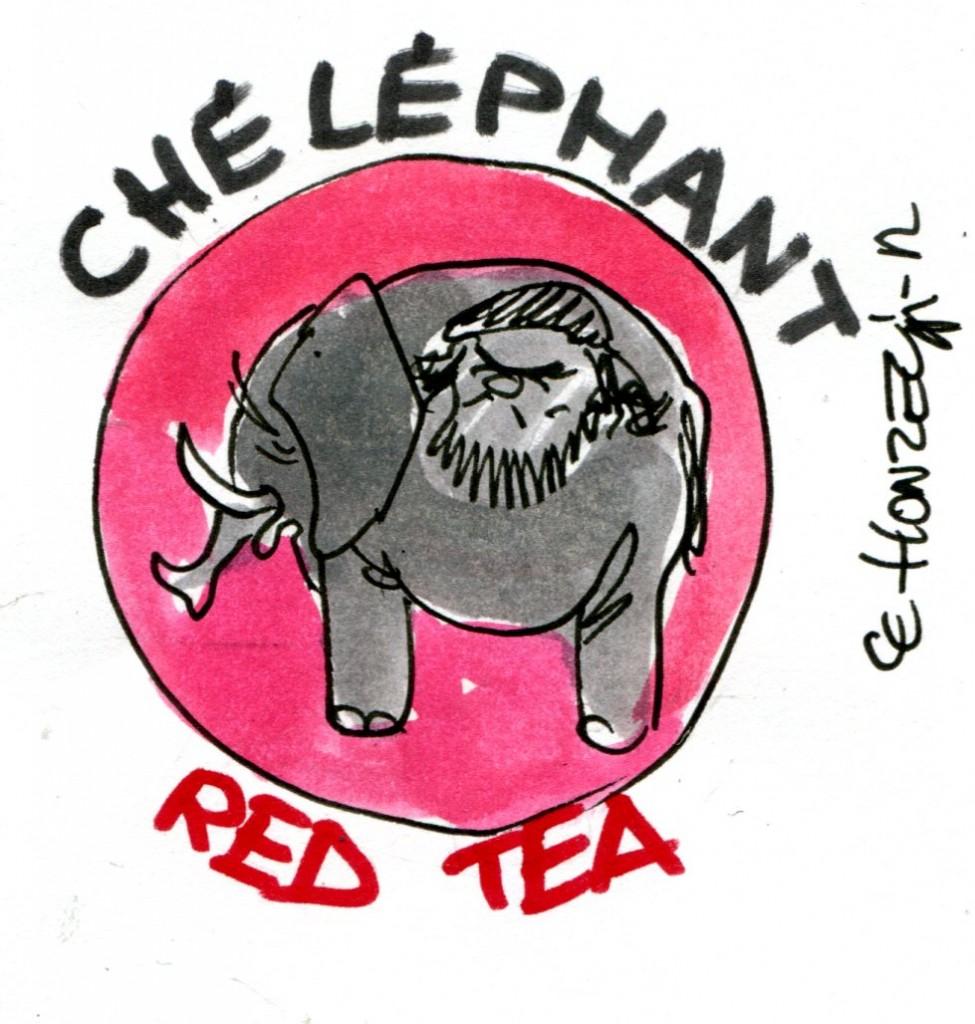
Une histoire marseillaise
Marseille. Sa nostalgie de l'industrie « époque coloniale », ses syndicalistes-rois, son personnel politique clientéliste jusqu'à la caricature, ses « combines » bricolées par des margoulins opportunistes. Absolument tous les clichés qui tuent l'activité économique et l'emploi dans la deuxième ville de France ne peuvent que sortir renforcés de « l'affaire Fralib ».
Il fut en effet un temps, celui des colonies, où Marseille était un centre industriel de tout premier plan. Si les savonneries sont restées emblématiques, c'est toute la transformation de matières premières qui s'était implantée en Provence, et notamment les raffineries de pétrole et les usines agroalimentaires.
C'est dans ce contexte que les frères Digonnet, des marchands spécialistes des produits coloniaux, se spécialisent en 1892 dans le commerce de thé, puis créent en 1927 la Société des Thés de l'éléphant sous forme de SA. La société Ricard, qui avait pour stratégie à l'époque de faire fructifier son réseau de distribution auprès des bars, cafés et restaurant notamment, est progressivement montée au capital pour devenir majoritaire en 1969. L’Éléphant est dès lors la marque leader sur son marché domestique, et c'est la raison pour laquelle Unilever (qui détient déjà – et toujours aujourd'hui – le leader mondial Lipton) la rachète en 1972. Et fusionne ses activités de boissons en France au sein d'une nouvelle entité, Fralib, en 1977.
Cette société cumule les implantations vestigiales, puisqu'en plus de Marseille, ses autres sites se trouvent au Havre et à Dissay dans le Poitou-Charente, toutes ces villes ayant en commun la chute de l'activité portuaire régionale. Progressivement, Unilever réorganise Fralib : vend Dissay, ferme Le Havre, et la production, recentrée sur le thé, est entièrement relocalisée à Gémenos, dans une zone franche qui se développe alors autour du siège du leader mondial de la carte à puce, Gemplus (aujourd'hui Gemalto).
Le marché européen, extrêmement mature, se montrant de moins en moins rentable au cours des années 2000, Unilever décide de se développer sur les marchés émergents, avec un grand succès par ailleurs, et procède à une restructuration de sa production de thés en Europe. Et Fralib se retrouve dans l’œil du cyclone, la CGT majoritaire parmi le personnel ayant refusée tout changement depuis de longues années, y compris le changement de machines (vieux contentieux qui sera ressorti par la CGT au cours du conflit, accusant Unilever d’avoir fait une erreur en achetant ces nouvelles machines, erreur que l’entreprise ferait payer aux salariés de Gémenos).
La multinationale annonce ainsi au début de l'été 2010 la fermeture du site de Gémenos, beaucoup moins rentable que ceux de Belgique et de Pologne, en raison de la résistance aux changements orchestrée par les syndicats. La réaction est immédiate, le conflit social démarre sur le champ. Il ne s'arrêtera plus. La CGT est fière de fêter les 700 jours de mouvement social. Durant lesquels ils se sont, avec l'aide des politiques de gauche, vautrés dans l'irresponsabilité jusqu'à l'absurde.
Une kermesse politique

C'est le président de la Région Provence-Alpes-Côté d'Azur, figure de la mitterrandie Michel Vauzelle qui dégaine en premier en faisant financer par le contribuable une « étude » du cabinet comptable Progexa (qui ne s'adresse qu'à une seule clientèle : les organisations syndicales) à hauteur de 27 000€. Et l'ancien Garde des Sceaux et son vice-président à l'emploi ont présenté avec toute la crème de l'union de la gauche locale le 26 juillet 2011 le fruit de leur investissement avisé, sobrement intitulé : « étude économique, pour une solution alternative, initiée avec les collectivités locales : Synthèse du rapport d'étape »
Si vous avez suivi le lien, et que vous êtes un peu familier de la gestion, la rédaction de cette dépêche de La Provence, écrite manifestement sans aucun esprit critique, n'a pas manqué de vous faire tiquer. Elle annonce sans sourciller un taux de marge de 65,6% pour une usine d'un produit alimentaire de très grande consommation. En ajoutant que la direction souhaite fermer cette poule aux œufs d'or.
Évidemment, pour arriver à ce résultat aberrant, « l'expert » Progexa s'est forcément planté. Et il semblerait que l'incurie (ou la manipulation) soit telle que le chiffre d'affaires attribué à l'usine est en fait… le produit des ventes au consommateur ! En effet, pour les 2900 tonnes avancées, 135 M€ correspondent à un prix de 46€/kg environ. Allez voir le prix de vente au public des sachets de thés Lipton et en moyenne, vous ne tomberez pas très loin… TVA comprise ! Unilever dit vendre la production de Fralib pour 25,48€/kg en moyenne à travers la réponse, très feutrée devant tant de bêtise ou de mauvaise foi (au choix), de son expert. Y sont détaillées les autres « erreurs » (ou ficelles du sabotage).
Mais surtout, le caractère « alternatif » annoncé tient toutes ses promesses. Car d'emblée, Progexa pose ses conditions pour la poursuite de l'activité : 1- maintenir tous les emplois ; 2- investir 2 millions de plus dans la création d'un atelier d'aromatisation ; 3- céder les bâtiments (qui ne sont pas à Unilever, nous le reverrons), l'outil industriel et la marque Éléphant pour 1€ symbolique aux employés. Vous voyez une contradiction entre la condition 1 et la condition 3 ? Progexa non, certainement parce qu'il n'est à ce moment fait état d'aucune solution juridique (reprise par les salariés ? sous quelle forme ?).
Unilever, décidément très poli, ce doit être l'éducation batave, répond alors simplement qu'il attend une proposition juridique claire et que le groupe est prêt à discuter sur tout sauf la cession de la marque Éléphant.
C'est 1 mois plus tard, le 22 août 2011, que le futur président François Hollande rend visite aux « Fralibiens ». Et, jouant l'apaisement comme de bien entendu en période électorale, il a assuré aux derniers nommés qu'il ferait renoncer Unilever à sa marque.
Les coulisses d’un plan social

À partir de ce revers, changeant de stratégie, et d'avocats, la direction de Fralib va s'efforcer dans un premier temps de trouver des candidats à un départ volontaire pour avoir un minimum de reclassements à proposer dans le cadre du PSE. Évidemment pour cela, il faut sortir le carnet de chèque. Mais c'est le seul moyen de s'en sortir, estiment les spécialistes des coulisses du social dans l'industrie. Et qu'ils chiffrent par expérience, dans la région marseillais, comme suit : le minimum, pour un ouvrier qui a de l'ancienneté, c'est un package de 50 000€. Pour les techniciens, ça peut monter jusqu'à 100 000€, quand on ajoute l'indemnité de licenciement, le financement d'une formation qualifiante et certifiante en vue d'une reconversion, et l'indemnité prévue par le protocole transactionnel pour se prémunir contre les recours ultérieurs.
Et pendant que les leaders syndicaux recevaient tout au long de la campagne tout ce que la gauche a produit de candidats aux hautes fonctions de l’État au premier semestre 2012, c’est ainsi 79 des 182 salariés de Fralib qui choisissent de s’extirper à bons comptes de ce traquenard qui semble déjà si mal embarqué. Et le 20 avril dernier, c’est un PSE pour 103 personnes qui est donc accepté par le tribunal de Marseille. Avec, cette fois-ci, un reclassement proposé en France et à salaire au moins égal pour chaque employé, comme cela est prévu par la loi. On attend le résultat de l’appel interjeté par les avocats de la CGT, au prétexte que le PSE aurait dû concerner les 182 employés initiaux (qui ont, on l’imagine, très envie d’être réintégrés à ce maelström).
La lutte finale
Lâchés par une grande partie de leurs troupes, les syndicalistes reprennent espoir avec l’élection de leur chevalier blanc à l’Élysée. Dans l’euphorie, ils se mettent en tête dès le 11 mai de « bloquer » l’usine. Laquelle est à l’arrêt depuis juillet 2011… Pourquoi ? Parce que cette occupation gêne Unilever qui doit rendre les clés du site en septembre 2012, à la fin du bail de location-gérance grâce auquel elle l’exploitait. Et qu’à cela ne tienne si le juge des référés permet l’intervention de la force publique pour les expulser, car voilà qu’un nouvel édile s’apprête à investir médiatiquement, avec l’argent du contribuable. Il s’agit d'Eugène Caselli, le président de Marseille Provence Métropole, ancien bras-droit de Jean-Noël Guérini, qui le surnommait affectueusement « brushing », aujourd’hui repenti (ou balance ou calomniateur, selon les points de vue), qui voit là l’occasion de surfer une vague montante, qui pourrait bien l’aider à accéder à l’étage de l’Hôtel de Ville, si possible dans le bureau du Maire. Et, sous le coup lui aussi de l’euphorie suivant les célébrations de la première victoire d’un socialiste à l’élection présidentielle depuis près d’un quart de siècle, il décide de balancer 5,3 millions d’euros pour racheter le terrain et les murs de l’usine.
Les deux meneurs, le secrétaire du CE et le délégué syndical (tous deux) se sentant pousser des ailes, présentent alors leur « solution alternative » définitive. Et cette fois-ci, c’est carnaval ! Ils n’omettent pas de glisser qu’ils seraient les mieux placés pour devenir président et directeur général de la future Société coopérative et participative (SCOP), laquelle reprendrait l’usine, une fois que Unilever aura réinjecté 3 à 3,5 millions dans l’outil industriel. Mais ça ne s’arrête pas là ! Unilever serait également dans l’obligation d’acheter la production de l’usine (au prix de 45€/kg, ils avaient dû rater la réponse), de financer la formation des personnels qui reprendraient les fonctions support (à hauteur de 1 million), de subventionner les salaires et charges de tous les personnels à hauteur de 30%. Et bien sûr, céder la fameuse marque Éléphant pour le non-moins fameux euro symbolique. À ce stade, on peut se dire que les conditions de départ sont exagérées afin de s’en sortir honorablement lors d’une dernière négociation. On remarquera au passage que tout loyer est exclu du budget (parler de plan d’affaire serait mensonger), alors qu’Eugène Caselli avait argué que l’investissement consenti ne pouvait qu’être rentable considérant ce que la collectivité pourrait tirer de l’immeuble…
La contre-proposition d’Unilever est d’ailleurs plutôt alléchante : cession gratuite de l’outil industriel, assortie de 5 millions d’euros de trésorerie, soit 64 000€ d’indemnité transactionnelle (en plus de l’indemnité de licenciement donc) par employé de la futur SCOP, puisque seuls 78 valeureux combattants souhaitent se lancer dans cette aventure. Les troupes s’amenuisent.
Là, tous les créateurs d’entreprise se diront : ils font une bonne affaire les bougres, ça paye d’écumer les plateaux de télévision locales pendant 2 ans, on se retrouve à la tête d’une entreprise dont l’ensemble des actifs immobilisés est couvert par les capitaux propres, et qui a suffisamment de cash pour couvrir un besoin en fonds de roulement correspondant à environ 5 cycles d’exploitation.
Sauf que, loin d’être satisfaits, les compères cégétistes restent sur leur position, accusant Unilever de prendre peur qu’un concurrent se développe ! Un concurrent qui, avant même d’exister, lui ordonne d’acheter sa future production…
Et la France du redressement alternatif, pardon productif, de s’enthousiasmer en rythme sur l’idée géniale de Progexa-CGT. Évidemment le ministre s’enflamme, mais d’anciens cadres du secteur, plutôt proches de la gauche, ayant en commun d’être au chômage mais pas dépourvus d’opportunisme et de cynisme, viennent expliquer dans la presse qu’ils sont disponibles pour aider les héros de Gémenos. Moyennant une bonne place dans l’organigramme bien sûr.
Requiem pour une industrie
Il faut mesurer que le cas de Fralib n’est qu’une redite de l’affaire Nestlé, qui avait fermé au mitan des années 2000 son usine, emblématique, de Marseille dans le quartier de Saint-Menet. Comme pour Nestlé, les salariés payent effectivement le prix du jusqu'au boutisme syndical qui a ruiné la compétitivité du site et se retrouvent enferrés dans un combat désespéré, tant ils mesurent à juste titre qu'ils ne peuvent espérer retrouver ces conditions de rémunération, survivances d'une parenthèse dorée aujourd'hui lointaine.
Comme pour Nestlé, politiques et syndicalistes ont transformé un drame social en cirque médiatique. Et sachons reconnaitre d'ailleurs qu'en 2005/2007, c'est un gouvernement de droite qui avait eu le même comportement inconséquent que celui d'Hollande-Montebourg aujourd'hui.
Comme pour Nestlé, le résultat, tant sur le plan humain que sur le plan de l'image envoyée aux investisseurs et aux créateurs, sera catastrophique.
La réalité assomme ceux qui se pensaient être protégés par les luttes et les droits acquis, mais l'Europe n'est plus un marché prioritaire pour les géants de l'agroalimentaire, et Marseille n'en est plus la plaque-tournante. Et ces fameux droits acquis, au nom desquels les syndicats refusent tout changement, se sont révélés être un fardeau dans ces circonstances. Les emplois industriels ont évolué, passant sous l’effet de la robotisation, domaine dans lequel nous sommes en retard tant sur nos voisins européens que sur les asiatiques, de l’ouvrier au technicien et à l’ingénieur. Ce qui devrait être une chance devient en France une menace, car notre pays semble incapable de faire ce saut qualitatif.
Fralib est le nom de la faillite de notre système éducatif. Fralib est le nom de la couardise et du cynisme de nos « élites » politiques. Fralib est le nom du fardeau que nous nous imposons en glorifiant un prétendu âge d’or des luttes sociales et en punissant les innovateurs et créateurs de richesse au nom de la justice sociale, vocable qui ne désigne que la jalousie. Fralib est donc le nom de notre chute à venir. À moins que le bon sens ne traverse subitement les frontières de l’Hexagone ?

