Je me suis attelé à préparer pour la rentrée une seconde édition d’American parano, qui sera diffusée sous une forme que mon éditeur et moi étudions actuellement, et je me replonge dans le matériau non utilisé ainsi que d’anciens articles de ce blog que j’ai effacés depuis. Et je retrouve un texte sur un film culte du cinéma américain, The Fountainhead (Le rebelle) de King Vidor de 1949. Et comme je tombe en même temps sur des extraits mis en ligne sur YouTube…
J’en parle rapidement dans American parano (page 212) mais de manière succincte, François Bourin n’ayant dit à l’époque en riant que c’était très bien mais trop long, sauf à l’envoyer aux Cahiers du cinéma. Voilà donc la version (trop) longue.
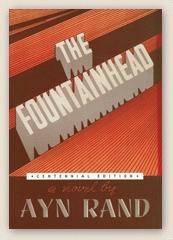
Pourquoi ce film ? Parce qu’aujourd’hui c’est devenu un film dérangeant. Chef-d’œuvre trop peu diffusé mais unanimement adulé des cinéphiles, à la photographie noir et blanc d’une beauté plastique époustouflante, irradié de la relation passionnelle de ses deux acteurs principaux, Gary Cooper et Patricia Neal, il narre l’histoire sublimée d’un architecte américain dont le modèle évident est Frank Lloyd Wright, confronté au conservatisme de ses pairs et surtout à l’hostilité plus ou moins amoureusement gay d’un patron de presse et de son critique qui se retranchent derrière l’opinion des lecteurs ― comprenons la majorité morale. Le message du film est que l’artiste, pour créer, doit aller contre le conservatisme de la populace (mob). Le film semble parfaitement tocquevillien, jusque dans ses subtilités ; ainsi quant à savoir si c’est le média qui façonne l’opinion en lançant des campagnes de presse ou le média qui se soumet à une supposée opinion dont il ne serait que le porte-voix, ou lorsque le héros est soumis de la part des promoteurs à un véritable chantage et est contraint pour vivre de travailler comme ouvrier carriériste.
Or l’ouvrage transposé dont le film est la substantifique moelle est tout autre. Gros pavé indigeste à l’écriture laborieuse d’Ayn Rand, écrit à la fin des années trente, il fait l’apologie non pas seulement de l’artiste libre et incompris, seul porteur de progrès puisqu’il rompt avec une opinion collective forcément conservatrice, mais bien du surhomme qui n’a pas à se soumettre aux lois de la société ni à s’occuper des autres, et s’arroge le droit de créer mais aussi de détruire. C’est la forme exacerbée du « just be » ou « just do it » de certain slogan publicitaire.
La longue plaidoirie de la fin, qui fait plusieurs pages dans le livre et six minutes dans le film (ci-dessous en deux versions, l’un non sous-titrée mais l’autre de mauvaise qualité, au choix…), grande scène judiciaire incontournable des mythes américains, n’est qu’une infâme bouillie à prétention intellectualiste : « The first right on earth is the right of the ego. Man’s first duty is for himself. His moral law is never to place his prime goal within the persons of others. His moral obligation is to do what he wishes, provided his wish does not depend primarly upon other men. etc… »
Force est de constater, pour avoir revu récemment ce film chéri, qu’il sonne d’une tout autre manière qu'auparavant à l’éclairage des évènements survenus depuis 2001, et que les théories pseudo philosophico-politiques parfaitement ridicules qu’Ayn Rand développa parallèlement sous la dénomination d’objectivisme (il y a même un Ayn Rand Institute), sorte d’ultra-cartésianisme dévoyé et sectaire, ont un authentique goût de fascisme à l’américaine. En s’arrogeant le droit de détruire sa propre œuvre, outre une vision primaire et barbare de la création artistique, ne laissant derrière lui que le néant, le surhomme précipite la société qui l’a contrarié dans le chaos.
C’est un peu ce que semblent nous annoncer aujourd’hui certains oiseaux de malheur de Washington, notamment les néocons qui ont fait de Ayn Rand une de leurs sources d'inspiration. Mais pas seulement : il y a jusque dans les discours d'Obama, notamment lorsqu'il prétend changer l'Amérique et ainsi changer le monde, des relents de cet objectivisme. Car Obama ne veut pas changer l'Amérique et le monde, il veut changer l'Amérique donc le monde. Avis aux amateurs...

