Par Johan Rivalland.
La liberté est le sujet fondamental au centre des préoccupations de Contrepoints, à travers articles, analyses, réflexions, discussions.
Au-delà de l’actualité, de l’Histoire, des perspectives d’avenir, qu’en est-il de ce sujet dans la littérature, en particulier lorsqu’on pense à son opposé le plus extrême : le totalitarisme ?
J’ai déjà eu l’occasion, ici-même, de commenter quelques grands romans d’Ayn Rand, qui trouveraient toute leur place dans cette série. Je vais donc prolonger avec d’autres réalisations, dans des registres parfois très voisins.
Sixième volet, aujourd’hui, qui s’intéresse à ceux qui se rebellent contre un système (totalitaire ou plus simplement dictatorial).
Le prisonnier de Patrick Mcgoohan, Don Chaffey et Robert Asher
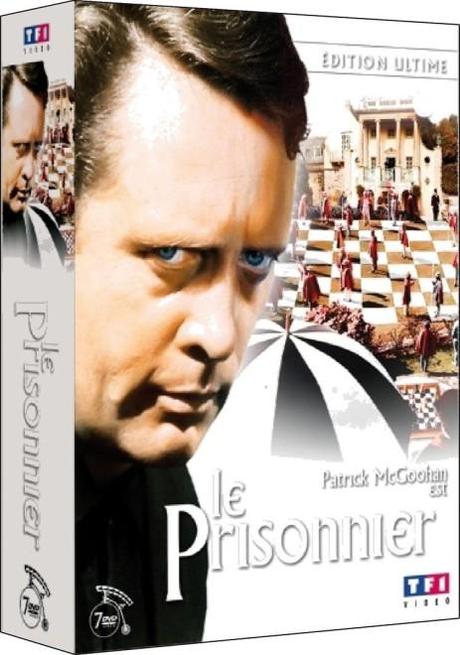
Si vous ne connaissez pas, alors n’hésitez pas. Une fiction en 18 épisodes de grande qualité, recélant une bonne part de mystère et de symboles forts, très proches de bien des points abordés dans notre présente série. Entre 1984, Divergente ou le Passeur, l’univers totalitaire soviétique ou le joueur d’échecs, on retrouve ici tous les ingrédients de ce qui constitue l’univers totalitaire, ses efforts constants de manipulation mentale et les velléités d’en échapper, au risque de sa vie.
À ne pas manquer.
Antigone de Jean Anouilh (mais aussi Sophocle, Bertolt Brecht, Jean Cocteau ou Henry Bauchau)
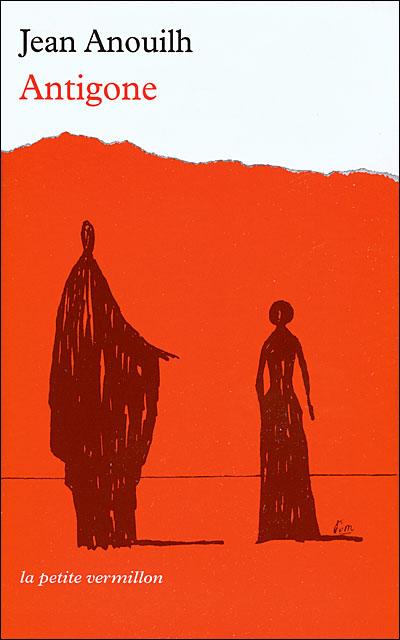
La version de Jean Anouilh, la plus célèbre aujourd’hui, est particulièrement efficace et permet de faire revivre cette œuvre immortelle de Sophocle, en restituant toute la grandeur.
Que pouvait alors apporter Bertolt Brecht de différent, après toutes les adaptations contemporaines de la pièce, et notamment celle d’Anouilh ? Un prologue qui se déroule à Berlin en avril 1945, alors qu’il n’est pas rare de trouver pendus à des réverbères des soldats, déserteurs, parfois simples adolescents apeurés par le climat de destruction et d’anéantissement qui emporte tout sur son passage.
Dans ce contexte, deux sœurs se trouvent confrontées à la situation où elles découvrent, en ouvrant leur porte un matin, leur frère pendu et un soldat SS qui les sonde avec suspicion. La première nie connaître l’individu pendu à la corde, tandis que l’autre s’apprête, semble-t-il, à détacher la dépouille, contrevenant ainsi à l’ordre public, quelle que soit l’iniquité qui le définit et au péril de sa vie, car quiconque s’aviserait de détacher un cadavre exposé aux yeux de tous se verrait condamné aussitôt au même sort.
C’est alors qu’on se retrouve dans le palais de Créon, du temps de l’Antiquité, en présence de deux autres sœurs, Antigone et Ismène… Le parallèle est intéressant, évocateur, particulièrement efficace. Et Bertolt Brecht parvient habilement à nous convaincre du bienfondé de la réflexion sur Antigone en le ramenant à sa plus brûlante actualité. Avec un Créon qui incarne un dictateur sans pitié, qui n’est pas sans faire penser à un homologue de 1945 dans son jusqu’auboutisme ravageur.
Pour le reste, mis à part quelques nuances ou différences par rapport à la pièce classique (l’absence du caractère religieux de la tragédie pour le remplacer par une dénonciation des dérives du pouvoir et de l’État, ou encore la situation de départ avec les deux frères qui ne se sont pas, ici, entre-tués mais l’un ayant renoncé à poursuivre la guerre d’agression et de conquête initiée par son oncle à la suite de la mort de l’autre et étant alors considéré comme un traître, tué de la main-même de Créon), cette adaptation reste fidèle à l’esprit de l’originale.
Une très bonne adaptation, intelligente et réussie. Avec un véritable apport personnel.
Cette fascinante Antigone a ensuite été adaptée en un roman, et de quelle manière !, par Henry Bauchau. Subtilité du langage, phrases à la fois simples et incroyablement mélodieuses, où chaque mot choisi semble être le plus juste, chaque phrase comportant le nombre exact de mots, permettent de retracer la vie d’Antigone ainsi que des principaux personnages qui font partie de son histoire. Nous revenons ici aux sources de l’existence de la célèbre fille d’Œdipe et de Jocaste, en amont de la pièce. Étéocle et Polynice n’étaient déjà plus lorsque débute celle-ci ; là commençait l’intrigue. Avec Henry Bauchau, nous revenons en arrière, lorsque les deux frères ne s’étaient pas encore entre-déchirés.
L’analyse psychologique des personnages est implacable. Tant d’Étéocle et Polynice, dont on apprend quels furent l’enfance et les ressorts de leur rivalité comme de leur admiration réciproque, que de leur mère Jocaste, aux multiples facettes, ou de leur sœur Ismène, dont le caractère est ici bien plus complexe et affirmé qu’il ne peut apparaître dans les différentes versions de la pièce. Sans oublier Créon, dont le visage prend encore une autre dimension que dans les différentes versions que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer, l’orgueil puissant, le calcul politique, un certain réalisme guidé par la détestation d’Antigone (qui n’était pas particulièrement présente dans d’autres versions) prenant le pas sur le reste, les éventuelles hésitations relevées chez Anouilh notamment n’existant pas ici.
Et, bien sûr, psychologie extrêmement particulière et complexe d’une Antigone mue par le sentiment de justice, mais aussi d’une liberté chère à acquérir et bien paradoxale, rejetant la perversité des lois iniques et la condamnation illégitime de Polynice, dont elle tente tout au long du roman d’apaiser la rivalité fraternelle malgré la force inéluctable du destin tragique de la famille. Une Antigone dont on ressent toute la profonde souffrance, celle liée à sa ténacité et son esprit incorruptible, qui ne lâchent rien et ne souffrent pas les décisions injustes ou les errements humains. Regard aussi, bien entendu, sur la relation paternelle avec l’Œdipe dont elle accompagna les années d’errance, au prix de ressentiments de la part de ses proches. Et sur Hémon, dont on apprend qu’il ne fut pas le seul homme de sa vie.
Un roman très réussi, plein de finesse et écrit avec grand talent, malgré peut-être quelques longueurs vers la fin. Un retour aux sources et un pari osé, celui d’élaborer une analyse psychologique très fine des personnages dans leur complexité, tentant d’apporter une explication aux événements de la pièce en remontant en amont. On conseillera toutefois de lire au préalable la pièce, pour plus d’imprégnation et de connaissance des ressorts de l’histoire. Soit l’originelle, celle de Sophocle, à qui revient le mérite de cette création, soit celle de Jean Anouilh, vers laquelle va personnellement mon attachement.
La religion du poignard : Éloge de Charlotte Corday de Michel Onfray
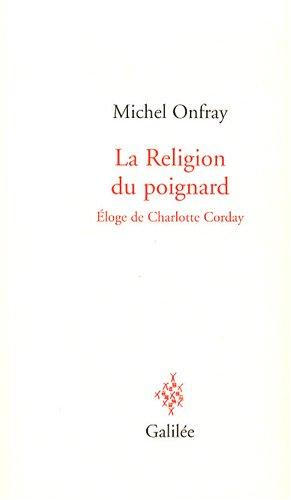
Cependant, faute d’avoir encore eu le temps de lire d’autres ouvrages sur ce célèbre personnage féminin, je m’en tiendrai à ce que j’ai simplement lu.
Sophie Scholl, Antigone, Charlotte Corday, trois noms de rebelles face à un système autoritaire ou totalisant. L’une n’a jamais existé, mais a marqué durablement les esprits par sa force de caractère. Les deux autres ont défendu, comme elle, des causes d’un haut intérêt éthique, mais de manière presque anecdotique au regard des événements effroyables qui se déroulaient à leur époque respective (du moins sur l’instant, et nous y reviendrons). Les trois ont en commun d’être de jeunes femmes d’une très grande force morale et d’un courage exemplaire. Et toutes les trois ont péri au terme de la peine capitale, en connaissance de cause, en n’ayant rien fait pour y échapper, plaçant la cause qu’elles défendaient au-dessus de leur propre vie.
Des trois figures, Charlotte Corday reste néanmoins, à mes yeux, celle au sujet de laquelle je me pose le plus de questions. En effet, contrairement aux deux autres qui ont agi de la manière la plus pacifique qui soit, Charlotte Corday a tout de même recouru à la violence et à l’assassinat. Oui, mais n’était-ce pas pour « sauver 100 000 vies », comme elle le dit elle-même ? Dilemme de toujours, car dans le cas présent on peut être tenté de défendre ce point de vue, mais qu’en est-il dans le cas d’un terroriste qui lui aussi trouvera une justification à des assassinats, que l’on réprouvera cette fois totalement ? (à l’image, par exemple d’un Battisti, condamné par la justice italienne et que, pourtant, tant de « bonnes consciences » défendent en France, de manière qui me paraît ici totalement injustifiée et éminemment choquante).
Voilà longtemps que je désirais lire un ouvrage sur Charlotte Corday. J’avais déjà lu ou vu des choses la concernant en divers endroits (livres, revues, et même un téléfilm), mais difficile de savoir quel auteur et quel ouvrage pouvait faire l’affaire, tant les points de vue peuvent être différents. Et c’est pourquoi j’avais temporairement renoncé, en attendant de trouver le bon ouvrage. C’est alors que, par hasard, j’ai écouté une émission radiophonique au cours de laquelle Michel Onfray (qui en principe n’est « vraiment pas ma tasse de thé ») était invité, à l’occasion de la journée de la femme (une seule journée, ciel !), pour présenter ce livre. Or, sa présentation et la modération de ses propos m’ont agréablement surpris. Ce qui m’a conduit à m’intéresser à ce petit essai.
Si, sur un plan intrinsèque certains éléments me plaisent (je vais dire lesquels), malheureusement, il y a aussi quelques sources de déception. D’abord, et surtout, la taille de l’ouvrage. 80 pages, sachant que le texte lui-même ne débute qu’à la page 13 et qu’il y a plusieurs pages blanches intermédiaires pour des sauts de page entre les différents chapitres, cela ne donne au total qu’une soixantaine de pages (!). Et encore, vu le format (faible largeur des pages) et l’espacement (marges hautes et basses), le contenu est vraiment très restrictif. Finalement, le petit recueil se lit en guère plus d’une heure. L’essentiel était dit au cours du petit quart d’heure d’entretien radiophonique que j’évoquais et je n’ai rien appris de plus. À l’arrivée, on peut parfaitement imaginer que ceci aurait pu donner lieu à l’une des conférences pour lesquels l’auteur s’est rendu célèbre.
Malgré tout, je suis agréablement surpris par la vision offerte de la Révolution française, dont l’auteur reconnaît penser le plus grand bien, mais tout en désapprouvant clairement et fortement la violence sans nom et la bestialité extrême à laquelle elle a donné lieu. Parce que la vérité est rétablie sur ce personnage monstrueux, malhonnête, arriviste, fraudeur, médecin charlatan, faussaire, sanguinaire, tyrannique, harangueur, vivisecteur et acheteur de cadavres (l’auteur explique chacun de ces qualificatifs), qu’est Jean-Paul Marat, guidé par ses mauvais instincts de vengeance car lui-même n’est qu’un raté qui ne désirait rien de moins que d’être anobli, reconnu, admiré, sans qu`il y soit parvenu malgré toutes ses bassesses et compromissions pour y parvenir.
Et, enfin, parce que même si finalement on reste un peu sur sa faim au sujet d’une Charlotte Corday dont on n’apprend pas grand chose, il n’en dresse pas moins un éloge mérité (même si on peut s’interroger sur son souhait de lui coller à tout prix l’étiquette de « libertaire »), elle qui a si souvent été vilipendée ou moquée pour son acte jugé par beaucoup parfaitement inutile, voire contre-productif. Mais serait-elle restée dans l’histoire si son amour de la liberté et sa force de caractère (voir aussi l’intéressant témoignage du bourreau Sanson à son sujet) n’avaient marqué ainsi les esprits ? Et j’approuve Michel Onfray lorsqu’il insiste sur le fait qu’isolé son acte n’a eu en fin de compte aucune portée immédiate, mais qu’il en dépendait de chacun ensuite de relayer son courage pour que cet acte révèle toute sa portée.
Et il n’en reste pas moins que Charlotte Corday demeure un modèle de courage, de force de caractère et de puissant amour de la liberté. À ce titre, elle mérite sans doute sa place dans cet article.
L’homme révolté d’Albert Camus
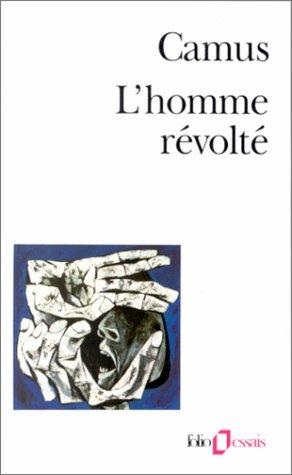
Après avoir défini la notion de révolte, distincte de celle du ressentiment, Albert Camus montre que « le problème de la révolte semble ne prendre de sens précis qu’à l’intérieur de la pensée occidentale. On pourrait être plus explicite encore en remarquant, avec Scheller, que l’esprit de révolte s’exprime difficilement dans les sociétés où les inégalités sont très grandes (régime des castes hindoues) ou, au contraire, dans celles où l’égalité est absolue (certaines sociétés primitives). En société, l’esprit de révolte n’est possible que dans les groupes où une égalité théorique recouvre de grandes inégalités de fait. Le problème de la révolte n’a donc de sens qu’à l’intérieur de notre société occidentale. On pourrait être tenté alors d’affirmer qu’il est relatif au développement de l’individualisme si les remarques précédentes ne nous avaient mis en garde contre cette conclusion » (quelques pages auparavant, Albert Camus montre que l’on peut se révolter au spectacle de l’oppression des autres ; ce qui n’est d’ailleurs pas contradictoire avec le sens que donne par exemple Alain Laurent à l’individualisme). C’est, finalement, le passage du sacré des sociétés traditionnelles aux valeurs de liberté et de conscience élargie de l’espèce humaine et des droits de l’individu qui induisent cette apparition du sentiment de révolte.
Une fois le terme défini, Albert Camus passe ensuite en revue, à travers cet ouvrage, à travers des analyses complexes et absolument remarquables, les différents types de révolte (métaphysique, historique, vis-à-vis de l’art, et dans son rapport au meurtre ou au terrorisme). Tour à tour, il dresse ainsi un panorama éloquent et complexe de la révolte contre Dieu, la négation de celui-ci, le nihilisme, les fondements de la pensée révolutionnaire de 1792, les régicides et déicides, en distinguant poésie révoltée et révolte historique dans son prolongement de la réflexion philosophique, comme dans une vague montante et allant s’amplifiant, jusqu’à atteindre des sommets de turpitude et de turbulence extrême, avec son lot de contradictions ultimes. Des analyses qui permettent de mieux comprendre la pensée révolutionnaire du XXème siècle, inspirée entre autres par la pensée hégélienne. Ainsi, sous l’assaut de la pensée révoltée, la divinité de l’homme en vient à remplacer la religion traditionnelle, au nom de principes d’abord, puis de faits.
Si l’on peut s’interroger sur la sorte de fascination, voire d’admiration, que semble éprouver Albert Camus à l’égard des terroristes de la fin du XIXème siècle, que l’on pourrait presque qualifier, sinon de romantiques, du moins d’idéalistes et d’âmes tourmentées accomplissant leurs actes au nom de principes qu’ils considèrent justes, notre auteur n’éprouve pas la même indulgence à l’égard des révolutionnaires, qui n’ont plus rien d’humain et ne répondent plus à aucun principe, ce qui n’en fait plus des révoltés. Au terrorisme individuel, œuvre parfois de « meurtriers délicats », pour lesquels une vie a encore un prix, succède un terrorisme d’État, basé sur un régime de terreur et écrasant les libertés, au nom de la liberté (reléguée à un horizon indéfini, voire illusoire).
Aux récriminations à l’égard d’Hitler succède une critique absolument brillante de Marx, des marxistes et des révolutionnaires, qui se sont fourvoyés dans des erreurs tant au regard de l’économie (en ce domaine, la compréhension d’Albert Camus, basée sur l’observation et les faits, est tout à fait prodigieuse) que de la science. À une démarche se voulant scientifique (le socialisme scientifique), Albert Camus oppose une fin de non recevoir et la qualifie plutôt de scientiste, apportant une démonstration très intéressante (cf. pages 260 à 280 environ). De là l’échec de la « prophétie » théorisée par Karl Marx. Ce qui fait dire à Albert Camus qu’« on ne s’étonnera donc pas que, pour rendre le marxisme scientifique, et maintenir cette fiction, utile au siècle de la science, il a fallu au préalable rendre la science marxiste, par la terreur ». Rappelons que l’ouvrage date de 1951. Des analyses très clairvoyantes et courageuses pour l’époque, et dont beaucoup aujourd’hui seraient incapables.
Ainsi, les stratégies établies par Lénine, loin d’aboutir à l’accomplissement de la liberté, que recherchaient les révoltés, conduisent à ce que « la vraie passion du XXème siècle, c’est la servitude« . En effet, « à la fin, quand l’Empire affranchira l’espèce entière, la liberté régnera sur des troupeaux d’esclaves, qui, du moins, seront libres par rapport à Dieu et, en général, à toute transcendance ». À cette fin, l’individualisme est nié et remplacé par la propagande ou la polémique, qui sont deux sortes de monologue. « L’abstraction, propre au monde des forces et du calcul, a remplacé les vraies passions qui sont du domaine de la chair et de l’irrationnel. Le ticket substitué au pain, l’amour et l’amitié soumis à la doctrine, le destin au plan, le châtiment appelé norme, et la production substituée à la création vivante, décrivent assez bien cette Europe décharnée, peuplée de fantômes, victorieux ou asservis, de la puissance ».
En fin de compte, la déception d’Albert Camus est immense à l’égard de ce qu’est devenu le sentiment de révolte. À peine l’homme était-il délivré des contraintes religieuses, qu’il était parvenu à abattre, qu’il s’en inventait de nouvelles, bien plus terrifiantes et « intolérables ». La vertu, de « charitable » devient « policière » et, « pour le salut de l’homme, d’ignobles bûchers s’élèvent ». « Les sources de la vie et de la création semblent taries. La peur fige une Europe peuplée de fantômes et de machines. Entre deux hécatombes, les échafauds s’installent au fond des souterrains. Des tortionnaires humanistes y célèbrent leur nouveau culte dans le silence. Quel cri les troublerait ? Les poètes eux-mêmes, devant le meurtre de leur frère, déclarent fièrement qu’ils ont Les mains propres (…) Dans les temps anciens, le sang du meurtre provoquait au moins une horreur sacrée ; il sanctifiait ainsi le prix de la vie. La vraie condamnation de cette époque est de donner à penser au contraire qu’elle n’est pas assez sanglante ». « Après avoir longtemps cru qu’il pourrait lutter contre Dieu avec l’humanité entière, l’esprit européen s’aperçoit donc qu’il lui faut aussi, s’il ne veut pas mourir, lutter contre les hommes (…) La révolte, détournée de ses origines et cyniquement travestie, oscille à tous les niveaux entre le sacrifice et le meurtre. Sa justice qu’elle espérait distributive est devenue sommaire. Le royaume de la grâce a été vaincu, mais celui de la justice s’effondre aussi. L’Europe meurt de cette déception. Sa révolte plaidait pour l’innocence humaine et la voilà raidie contre sa propre culpabilité ».
Pour finir, Albert Camus se demande donc s’il faut renoncer à toute révolte, acceptant les injustices, conduisant à un « lâche conformisme ». Mais il est un fait, selon lui, que nous ne sommes plus véritablement dans un monde révolté, la révolte étant devenue « l’alibi de nouveaux tyrans ».
Et, « en logique, conclut-il, on doit répondre que meurtre et révolte sont contradictoires ». Cependant, il ne semble pas délégitimer complètement le meurtre, puisqu’il le justifie « par exception », le vrai révolté devant accepter sa propre mort et sacrifice en contrepartie, au nom de la liberté totale qu’il défend et de sa protestation justement contre la mort (Albert Camus évoque différents cas, en particulier celui des frères Karamazov, mais aussi par exemple (même s’il y insiste beaucoup moins) de personnages emblématiques tels que Charlotte Corday).
Un essai, en définitive, particulièrement ardu, qui nécessite une bonne culture à la fois littéraire et historique. Je n’avais pas estimé la puissance intellectuelle d’Albert Camus, qui m’a ici absolument ébloui. Une lecture à aborder avec une solide volonté et une grande détermination. Pour ma part, j’ai souffert tout un été sur cette lecture contraignante et exigeante, au cours de laquelle j’avoue ne pas avoir toujours tout compris. Bon courage, donc, aux courageux qui se lanceront dans cette découverte, qui a aussi le mérite de permettre de mieux comprendre la pensée de l’auteur et ce qui se cache derrière ses romans.
Prochain volet, à suivre : Science sans conscience…
— Patrick McGoohan, Don Chaffey et Robert Asher, Le Prisonnier, TF1 Vidéos, octobre 2009, 7 DVD.
— Jean Anouilh, Antigone, La Table Ronde, mars 2008, 128 pages.
— Michel Onfray, La religion du poignard : Éloge de Charlotte Corday, Éditions Galilée, collection Débats, février 2009, 80 pages.
— Albert Camus, L’homme révolté, Gallimard, novembre 1951, 388 pages.

