Par Amaelle Guiton.
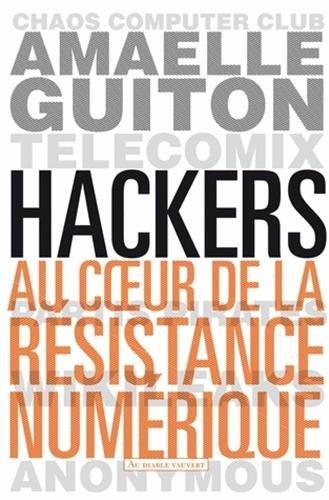 Depuis la parution de Hackers : Au cœur de la résistance numérique, je me promène régulièrement, de conférences en débats (on n’y pense pas vraiment quand on écrit un livre, mais le fait est que le « service après-vente » est un des aspects les plus agréables et enrichissants de ce genre d’expérience). Pour le moment, j’avais toujours eu affaire à des publics adultes – plus ou moins geek, plus ou moins au fait des enjeux politiques du numérique. Jusqu’à ce que Lucile, dont le stage à la Free Software Foundation Europe se termine dans quelques jours, me propose de participer avec elle à une des rencontres mensuelles organisées par le (vaste) lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes, pour causer histoire et enjeux du « réseau des réseaux » (comme on disait aux temps anciens des dinosaures).
Depuis la parution de Hackers : Au cœur de la résistance numérique, je me promène régulièrement, de conférences en débats (on n’y pense pas vraiment quand on écrit un livre, mais le fait est que le « service après-vente » est un des aspects les plus agréables et enrichissants de ce genre d’expérience). Pour le moment, j’avais toujours eu affaire à des publics adultes – plus ou moins geek, plus ou moins au fait des enjeux politiques du numérique. Jusqu’à ce que Lucile, dont le stage à la Free Software Foundation Europe se termine dans quelques jours, me propose de participer avec elle à une des rencontres mensuelles organisées par le (vaste) lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes, pour causer histoire et enjeux du « réseau des réseaux » (comme on disait aux temps anciens des dinosaures).
Joli hasard du calendrier : initialement prévu le 4 février, ce « Mardi de Doisneau » est, au final, tombé pile hier pour « The Day We Fight Back », la journée mondiale contre la surveillance de masse. Pour autant il ne s’agissait pas, ni pour Lucile ni pour moi, d’aborder l’Internet par son « côté obscur ». Mais, au contraire, de faire un peu rêver, de donner envie d’y mettre les mains – en retraçant l’aventure des pionniers, en revenant sur les valeurs qui ont modelé l’outil, en montrant en quoi il est une formidable opportunité en matière d’accès au savoir et de prise de parole. Ce qui n’empêche pas d’aborder les problèmes de censure, de surveillance, d’hypercentralisation, bien au contraire – histoire de faire prendre conscience que les libertés ne s’usent que si on ne s’en sert pas…
Comment « expliquer l’Internet » à des gens qui l’ont toujours connu ? Comment rendre compte du bouleversement qu’a représenté son extension, que représente son usage de masse ? Comment donner envie à des gamins de quinze ans de le faire vivre de manière active ? D’y prendre la parole, d’y construire des projets ? De ne pas se contenter des sentiers balisés de leur profil Facebook ou des algorithmes de Google ? Comment les encourager à investir le réseau, à l’heure où les plus enthousiastes réalisent avec effroi l’ampleur des pratiques de surveillance ?
Nous avions un peu moins d’une heure et demie devant nous, face à deux classes de seconde qui n’avaient pas spécialement choisi d’être là. Je crois qu’au final, nous nous en sommes plutôt bien sorties. En deux temps – « Liberté et partage, une histoire de l’informatique » puis « La révolution de l’accès au savoir » (à toutes fins utiles, j’ai mis les slides de ma partie en pied de ce billet) – et une bonne demi-heure de questions/réponses. Pas toujours évident de leur faire prendre la parole (c’est tellement moins compliqué de bavarder avec son voisin), mais ça a fini par sortir. Et ça disait des choses plutôt intéressantes sur la manière dont des lycéens des années 2010 peuvent percevoir cet outil avec lequel ils ont grandi.
Madame, c’est quoi un frigo sur Internet ?
 J’étais partie de 1971, et des 23 machines alors connectées au réseau Arpanet, pour aboutir en quelques étapes à « l’Internet des (milliards d’objets », avec l’exemple du frigo – qui peut désormais servir d’expéditeur de spam. Étonnement dans la salle. Question : « Madame, c’est quoi un frigo ? » Nouvel étonnement – de ma part cette fois. Je traduis : « Ben, un réfrigérateur. » Rires. « Non, mais c’est quoi un frigo sur Internet ? »
J’étais partie de 1971, et des 23 machines alors connectées au réseau Arpanet, pour aboutir en quelques étapes à « l’Internet des (milliards d’objets », avec l’exemple du frigo – qui peut désormais servir d’expéditeur de spam. Étonnement dans la salle. Question : « Madame, c’est quoi un frigo ? » Nouvel étonnement – de ma part cette fois. Je traduis : « Ben, un réfrigérateur. » Rires. « Non, mais c’est quoi un frigo sur Internet ? »
On pourrait s’imaginer qu’à l’heure du smartphone pour (presque) tous, de la télé connectée et des reportages sur la domotique au JT de 20 heures, des ados trouvent banale l’idée que les objets les plus quotidiens deviennent partie intégrante du réseau. Apparemment pas. La perspective que le frigo familial puisse un beau jour passer ses commandes « tout seul » a plutôt rencontré l’incrédulité – voire un peu d’inquiétude. À croire que pour eux, intuitivement, l’Internet est une affaire d’humains, et que les machines ne font pas « des choses » sans intervention directe de leur propriétaire. Ce qui serait à la fois terriblement naïf, et profondément rassurant.
Est-ce qu’on peut mettre des trucs faux sur Wikipedia ?
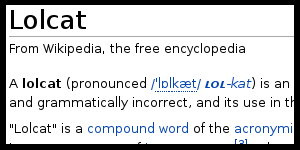
Parler de Wikipedia en milieu scolaire, c’est comme parler d’alcool à la radio – ne pas oublier l’avertissement d’usage, merci de ne pas copier-coller pour les devoirs à la maison. (Soulagement des profs dans la salle.) Ceci posé : pas de plus bel exemple de construction collective des savoirs, de collaboration entre « experts » et « amateurs ». À portée de navigateur, en prime ! En voilà qui n’ont jamais connu le poids d’un volume de l’Universalis, ou le temps de l’encyclopédie sur cédérom (qu’à l’époque on trouvait tellement moderne). Des trucs dans lesquels il n’y avait même pas d’entrée consacrée à Jean-Marc Morandini, c’est dire, et où la notice faisant référence à Alan Turing était vraiment toute petite.
Alors oui, jeune homme, « on peut mettre des trucs faux sur Wikipedia », sans que ça déclenche une alarme, une intervention de la patrouille ou un zéro pointé. Simplement, il y a de fortes chances pour que ce soit corrigé par un ou plusieurs internautes, parce que c’est ça, le principe. On se dit, à ce moment-là, que l’idée qu’on puisse « mettre des trucs faux sur Wikipedia » doit heurter quelque chose comme le (les) sens du « juste », et que la résolution collaborative du problème n’est pas la chose la plus facile à appréhender. (Les ados aiment souvent les « lois d’airain », y compris, bien sûr, quand il s’agit de les transgresser.) Wikipedia parle aussi d’articulation des responsabilités individuelle et collective, d’esprit critique, et de gestion politique, au sens premier du terme, de l’élaboration des savoirs.
Pourquoi est-ce qu’on bloque pas tout simplement les sites de téléchargement illégal ?
 Sans même entrer dans le débat du bien-fondé d’une solution aussi expéditive (nous avions aussi prévu une partie sur le partage et le remix, sacrifiée faute de temps), il semblerait qu’envisager que les frontières puissent tout simplement rendre difficiles certaines interventions ne soit pas la première idée qui leur vienne. Après tout, ils ont grandi avec un réseau mondial. Facebook, lui, ne connaît pas les frontières. Et on a manifestement dû leur dire que télécharger du contenu protégé, ça pouvait leur attirer des ennuis. Alors, pourquoi ne pas prendre le problème en amont ? (Que fait la police ?) Parce que c’est tout simplement plus compliqué que ça n’en a l’air. La petite aventure lucrative de Megaupload a tout de même duré sept ans…
Sans même entrer dans le débat du bien-fondé d’une solution aussi expéditive (nous avions aussi prévu une partie sur le partage et le remix, sacrifiée faute de temps), il semblerait qu’envisager que les frontières puissent tout simplement rendre difficiles certaines interventions ne soit pas la première idée qui leur vienne. Après tout, ils ont grandi avec un réseau mondial. Facebook, lui, ne connaît pas les frontières. Et on a manifestement dû leur dire que télécharger du contenu protégé, ça pouvait leur attirer des ennuis. Alors, pourquoi ne pas prendre le problème en amont ? (Que fait la police ?) Parce que c’est tout simplement plus compliqué que ça n’en a l’air. La petite aventure lucrative de Megaupload a tout de même duré sept ans…
Et puis, la censure, si ça marchait vraiment sur le réseau, ça se saurait – vous savez ce qui se passe quand on tape sur un Flamby, comme ça, paf ? Non, ça ne s’écrase pas.
C’est vrai qu’il y a une « face cachée » de l’Internet ? C’est vrai qu’on peut acheter de la drogue ?
Puissance de la parole médiatique mainstream. Les lycéens de Robert-Doisneau ne connaissaient ni le nom d’Edward Snowden, ni celui de Julian Assange, ni le programme Prism, mais certains d’entre eux avaient entendu parler du « darknet » et du réseau Tor. De ce « côté obscur » propre à entretenir tous les fantasmes. Je ne sais pas s’ils ont tout saisi de nos explications sur les différents usages de l’anonymat, mais je crois avoir trouvé une manière à peu près efficace de leur répondre, lors d’un court échange qui a consisté à leur poser trois questions :
– Est-ce qu’on peut acheter de la drogue dans la « vraie vie » ?
– Est-ce qu’on peut acheter des armes dans la « vraie vie » ?
– À votre avis, il y a une différence entre Internet et la « vraie vie » ?
En chœur : Oui. Oui. Non. CQFD. Là encore, je trouve ça plutôt rassurant – on a suffisamment de témoignages quotidiens de la difficulté, dans les générations précédentes, à envisager le réseau comme un espace social au sens plein du terme, avec tout ce que ça implique. Chez celle-là, ça fait partie de « la vie » (« vraie » dans toutes ses dimensions), avec tout ce que ça implique.
Internet, est-ce que c’est un bien pour l’humanité, ou est-ce que c’est un mal ?
Léger flottement, petit vertige. Vous avez quatre heures devant vous, les jeunes ? Répondre en une minute ou deux à une interrogation aussi profonde, aussi politique, vieille comme le monde – puisqu’après tout on peut l’appliquer à n’importe quelle grande avancée technique : gageure. Réprimer, alors, l’envie de s’embarquer dans un long développement sur la manière dont le réseau renouvelle les formes mêmes du politique, sur l’éthique (hacker) incorporée à la technique et comment elle modèle en retour les pratiques de ceux qui l’utilisent, sur le déterminisme technologique au cœur des impensés des « pères fondateurs », sur les rapports de pouvoir sur le réseau.
En rester à ce qui intuitivement peut faire sens pour eux, quand bien même on saurait que ça n’est pas si simple. Qu’une technologie n’est pas par nature « bonne » ou « mauvaise » – que l’important, c’est comment on s’en sert. Dire que la réponse à cette question, c’est aussi d’eux qu’elle dépend. Que c’est à eux (à nous) qu’il revient de l’écrire – là, maintenant, et pour un moment. Que savoir si ça va nous libérer ou nous enfermer, comment, jusqu’à quel point : c’est aussi leur affaire, parce que c’est aussi leur réseau.
Croiser quelques regards, dans les filles des premiers rangs (ce sont toujours des filles qui sont aux premiers rangs), où on croit lire que le message est passé. Pour combien de temps, jusqu’à quel point, on n’en sait rien. Se dire, en tout cas, qu’on n’a pas perdu sa journée.
—
L’article original est à lire sur techn0polis.net. Vous y trouverez également une copie de l’excellente présentation faite à l’occasion de cette rencontre.

