 Au début des années 1980, Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975), anglais naturalisé américain, et qui a passé en France une grande partie de sa vie, auteur de plus de soixante-dix romans et d’innombrables nouvelles, s’il avait été beaucoup traduit dans les années trente, était quelque peu tombé dans l’oubli, et son nom ne survivait qu’auprès d’une coterie d’aficionados qui traquaient ses oeuvres en VO. Grâce à Christian Bourgois et à Jean-Claude Zylberstein, qui ont réédité en 10/18 près d’une trentaine de titres, il a retrouvé une nouvelle jeunesse, et son nom est maintenant celui d’un classique absolu de la littérature anglaise, d’un parangon de l’humour british.
Au début des années 1980, Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975), anglais naturalisé américain, et qui a passé en France une grande partie de sa vie, auteur de plus de soixante-dix romans et d’innombrables nouvelles, s’il avait été beaucoup traduit dans les années trente, était quelque peu tombé dans l’oubli, et son nom ne survivait qu’auprès d’une coterie d’aficionados qui traquaient ses oeuvres en VO. Grâce à Christian Bourgois et à Jean-Claude Zylberstein, qui ont réédité en 10/18 près d’une trentaine de titres, il a retrouvé une nouvelle jeunesse, et son nom est maintenant celui d’un classique absolu de la littérature anglaise, d’un parangon de l’humour british.
Jeeves, le domestique stylé et malin, et son jeune maître riche et écervelé, Bertie Wooster, dont il est à la fois le mentor et le protecteur, sont devenus des types, au même titre que Monsieur Pickwick et son domestique, l’irrésistible Sam Weller, auxquels ils doivent sans doute beaucoup. La quinzaine de romans dans lesquels ils apparaissent constituent sans doute la part la mieux connue de l’oeuvre de Wodehouse, au même titre que le cycle de Blandings Castle, théâtre des mésaventures de Lord Emsworth et de sa tribu.
Mais en dehors de ces deux corpus majeurs, Wodehouse a donné naissance à un certain nombre de personnages récurrents, qui font parfois trois petits tours avant de disparaître… quitte à ressurgir un demi-siècle plus tard. Car le romancier avait la main verte, et sous sa plume le moindre personnage prend un relief cocasse qui le rend inoubliable, et inoubliable pour son créateur lui-même, qui semblait avoir du mal à se détacher définitivement de ses personnages.
Depuis une dizaine d’années, les Belles-Lettres, toujours sous la houlette de Jean-Claude Zylberstein, ont entrepris de poursuivre l’entreprise lancée par 10/18, et de faire traduire des titres jusqu’alors inconnus en France. Et on s’aperçoit qu’il ne s’agit jamais de fonds-de-tiroirs : le génie comique de Wodehouse, sa verve, son imagination, semblaient couler à flux constant.
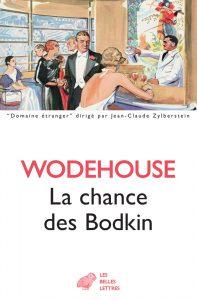
Wodehouse ne pratique pas la satire sociale, mais il a un sens aigu des différences sociales, et de ce qui caractérise chaque classe, et il pratique son art avec une constante drôlerie. Le lecteur va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement, de trouvaille en trouvaille, emporté sur le tapis magique d’un perpétuel ravissement.
A la différence des Jeeves, où Wodehouse joue moins sur le rythme que sur des variations infinies autour de thèmes convenus, il montre ici qu’il est un implacable mécanicien d’horlogeries comiques. Et La chance des Bodkin, accessoirement, est (avec le Qu’est-ce qui fait courir Sammy ?, de Budd Schulberg), un des romans les plus féroces et les plus drôles sur Hollywood, – même si tout se passe en mer.
Comme s’il regrettait d’avoir oublié Monty Bodkin pendant près de quarante ans, il revient à lui en 1972, dans l’un de ses derniers romans. Et il prouve qu’il n’a rien perdu de sa vista narrative. Le récit commence là où le premier s’est arrêté, aux Etats-Unis. Maintenant, Monty décide de rentrer en Angleterre, toujours en quête de Gertrude Butterworth. Et on retrouve avec délectation quelques autres personnages déjà connus (mais pas le steward gaffeur). A une époque (1972) où la comédie américaine classique est morte depuis longtemps, Wodehouse la ressuscite par la plume, il en retrouve la verve avec un naturel et un entrain qui, chez un quasi-nonagénaire, ont quelque chose de miraculeux. L’intrigue n’est qu’un prétexte, mais on est esbaudi à chaque paragraphe par une trouvaille de style, de vocabulaire, une image incongrue, une réplique. On a l’impression de lire une sorte de père spirituel de Jean Echenoz, un père spirituel qui dispense les pierres précieuses de son écriture et de son humour avec une aisance d’autant plus confondante qu’elle n’est jamais forcée.
Ces deux pépites jusqu’alors inconnues sont peut-être le moyen le meilleur de pénétrer dans une oeuvre dont a plaisir à penser que, comme celle de Simenon, on n’en aura jamais fait le tour.
Christophe Mercier
P.G. WODEHOUSE, La Chance des Bodkin ; Monty, Gertrude, Sandy et les autres Traduits de l’anglais par Anne-Marie Bouloch. Les Belles-Lettres, 320 et 190 pages, 14,9 euros)
