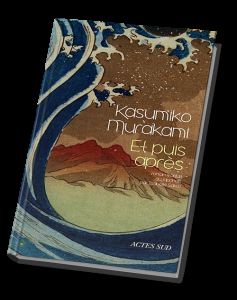 La banalité de la violence humaine des dernières décennies tend à effacer la mémoire des catastrophes naturelles. Le tremblement de terre du Tôhoku qui fit près de seize mille morts le 11 mars 2011, au Nord-Est du Japon, entraînant le désastre nucléaire de la centrale de Fukushima, aurait pu progressivement sombrer dans l’oubli. Mais le nom de Fukushima, symétrique de Hiroshima, ne sera sans doute jamais oublié et fait partie de l’Histoire malheureuse de l’humanité. À une tragédie monstrueusement volontaire a répondu ce que l’on a voulu présenter comme une tragédie involontaire.
La banalité de la violence humaine des dernières décennies tend à effacer la mémoire des catastrophes naturelles. Le tremblement de terre du Tôhoku qui fit près de seize mille morts le 11 mars 2011, au Nord-Est du Japon, entraînant le désastre nucléaire de la centrale de Fukushima, aurait pu progressivement sombrer dans l’oubli. Mais le nom de Fukushima, symétrique de Hiroshima, ne sera sans doute jamais oublié et fait partie de l’Histoire malheureuse de l’humanité. À une tragédie monstrueusement volontaire a répondu ce que l’on a voulu présenter comme une tragédie involontaire.
Bien entendu, les responsabilités humaines liées à la construction d’une centrale nucléaire dans une zone sismiquement aussi fragile et plus généralement à l’autorisation d’un tel complexe aussi près de zones habitées, ne sont pas inexistantes. Et le procès que l’humanité doit se faire à elle-même, quant à la question nucléaire, n’est pas terminé.
L’importante littérature publiée depuis le 11 mars 2011 n’a malheureusement pas résolu ce problème gigantesque : on a voulu longtemps dissocier la mise en cause de l’usage destructif de la force nucléaire de son usage domestique pour la création d’énergie. Et l’on se rend compte que cette dissociation est artificielle et ne correspond absolument pas à la réalité. Le danger phénoménal que représente cette production énergétique aux conséquences incontrôlées a été rendu évident par les désastres de Tchernobyl et donc de Fukushima.
Personne n’a oublié les sarcasmes de Nicolas Sarkozy et de Nathalie Kosciuscko-Morizet qui étaient allés prétendument sur le site de Fukushima — où ils n’ont pas mis les pieds, car il était interdit de s’approcher de la centrale à moins de 200 km— et affirmaient qu’il n’y avait en France aucun danger comparable (à propos de la centrale de Fessenheim), étant donné la différence des sites géographiques.
Le physicien japonais Hiroaki Koide avait publié de nombreuses mises en garde dans son laboratoire de recherches de l’Université de Kyôto bien avant le désastre de Fukushima. Ses prédictions ont été hélas confirmées. Et il a dénoncé l’alliance du risque que l’on faisait courir à la population et des intérêts financiers que représentaient la construction et la production énergétique des centrales, notamment autour de la compagnie électrique japonaise TEPCO, du jour au lendemain mondialement connue et accusée. Mais Hiroaki Koide a rappelé que la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne avaient une part importante de responsabilités (car ils utilisaient les déchets pour la construction d’armes atomiques, sous prétexte d’empêcher le Japon de le faire…). Bref, la fameuse dissociation des problèmes (qui avait été à l’origine d’une polémique entre Claude Simon, défendant dans des textes d’une totale ignorance et d’une agressivité arrogante, et soutenant les essais nucléaires français du Pacifique, et Kenzaburô Ôé rappelant au contraire la solidarité des centrales nucléaires et de la possible utilisation de l’arme atomique) n’avait aucun sens. Par ailleurs, l’impossibilité de contrôler les déchets subsistants sur place et surtout les eaux de refroidissement dès lors qu’elles sont contaminées par fissures et infiltrations, rend le danger inévitable, ce qu’ont prouvé les conséquences du séisme. Sans parler de la quasi-impossibilité du démantèlement des centrales. Du coût faramineux et de la durée interminable du chantier, qui empêchent d’assainir définitivement les zones et d’évacuer tout risque pour la population environnante.
On a à l’esprit ces problèmes gravissimes en lisant le roman de Kasumiko Murakami, qui pourtant n’écrit pas une seule fois le mot « nucléaire » dans ce livre. Car elle s’en tient au tsunami lui-même. Elle raconte la vie d’un vieux pêcheur, Yasuo, qui vit de la récolte d’algues et qui est, comme des milliers d’habitants de la région, surpris par le séisme, alors qu’il travaille sur le rivage, en ce début d’après-midi du vendredi 11 mars 2011.
Kasumiko Murakami a longtemps vécu à Paris où elle a dirigé un journal de mode, la version japonaise de Madame Figaro. Elle a traduit en japonais plusieurs auteurs français de renom parmi lesquels Patrick Modiano. Elle a donc mené une vie très éloignée non seulement de son pays natal, mais de préoccupations aussi dramatiques. Elle se trouvait à Tôkyô lors du tremblement de terre, le plus violent de l’histoire du pays depuis que l’on est en mesure d’évaluer mathématiquement les secousses. Plus violent encore que le tremblement de terre de 1923 qui avait détruit une grande partie de la capitale japonaise et que celui de 1896 qui avait déjà frappé le Tôhoku.
Elle accompagne une amie psychiatre dans un hôpital d’une grande ville de la région sinistrée, Minami-Sanriku. Comme beaucoup de bénévoles, elle a le réflexe de venir en aide aux survivants, en apportant couvertures et provisions. Son expérience journalistique ne l’avait jamais mise en présence de catastrophes de ce type et elle voulait, cependant, interroger les victimes, privées en quelques minutes de tous leurs biens, de tout logement, presque de toute identité, et endeuillés par des disparitions de proches.
Mais, interrogeant ceux qu’elle aidait, elle butait contre des difficultés, car ils hésitaient à se confier, ne souhaitant pas être nommés. Elle a donc opté pour la forme romanesque qui, souvent, permet de communiquer plus directement et de manière plus efficace et compassionnelle. L’exemple avait été donné par de grands écrivains japonais à propos de la dernière guerre. Qu’il s’agisse de Shôhei Ôoka (à propos de la débâcle l’armée japonaise en Indonésie, dans Les feux) ou de Masuji Ibusé (à propos de Hiroshima, dans Pluie noire). Elle prend donc pour protagoniste Yasuo qui, lorsque est annoncé un raz-de-marée d’une puissance exceptionnelle, a le courage de s’embarquer avec d’autres pêcheurs et de voguer vers le large, selon les prescriptions habituelles dans un tel cas. En effet, les marins ont plus de chance de survivre en affrontant la lame en mer plutôt qu’en l’attendant sur le rivage, car, tant que le mur d’eau ne s’est pas formé en s’écrasant sur la terre, on peut résister à la violence du courant entraîné par le séisme des fonds marins. Il sauve ainsi sa vie et celle des autres pêcheurs qui le suivent (il est le chef du syndicat marin local).
Yasuo, à partir du large, peut observer la destruction de la côte et quand, au bout de trois jours, il regagne la terre, il va devoir partager le combat de tous les survivants, en compagnie de sa femme avec laquelle il a pu communiquer par un code lumineux (en agitant, de très loin, un faisceau lumineux d’une torche électrique), selon un code qu’ils avaient établi en cas de catastrophe analogue.
En entrant dans la vie intime et familiale de son personnage (dont la mère meurt dans une maison de retraite, victime du tremblement de terre), Kasumiko Murakami choisit le « petite Histoire », plutôt que la grande. Mais cela lui permet de rappeler que l’on ne comprend vraiment un tel drame qu’en prenant un point de vue subjectif et individuel, afin de s’affranchir des chiffres et des statistiques auxquelles le plus souvent se réduisent les informations le concernant. Derrière les chiffres, se trouvent des destins individuels.
On peut, certes, être surpris que l’auteur n’évoque pas le problème nucléaire, même si les habitants ne sont pas immédiatement touchés par cette préoccupation au moment du séisme. Mais l’on sait qu’il y eut des zones non seulement sinistrées par le tsunami, mais ensuite totalement paralysées par le danger de la contamination des cultures et des eaux poissonneuses. Des villages, des communes entières ont été évacuées, désertées, dans l’attente d’un assainissement incertain. Elle ne veut pas participer à cette énorme polémique auquel de nombreux ouvrages ont été par ailleurs consacrés (notamment celui de Michaël Ferrier, Fukushima, récit d’un désastre, Gallimard). Elle s’en tient à des vies détruites de gens simples auxquels elle donne discrètement la parole. Et elle suggère tout ce que révèle le désastre dans la vie privée des individus soudain contraints de la partager avec des inconnus et s’exposant à eux, avec toutes les misères et les secrets de tant d’existences obligées d’abandonner leurs soucis personnels pour vivre un drame collectif.
Des documentaires (ceux de Kenichi et Christine Watanabé, en particulier) ont permis de faire entendre des témoignages de ces doubles victimes du séisme et du nucléaire et de montrer l’importante mobilisation de militants, japonais et internationaux. Mais Kasumiko Murakami, dans son bref et émouvant récit (dont le titre rappelle celui d’un célèbre roman de Sôseki, Sore kara, Après quoi…), évite ce débat. En revanche, elle évoque les nombreuses inquiétudes regardant les indemnisations, la reconstruction et l’intervention des pouvoirs locaux et nationaux, tentant de juguler les initiatives privées et s’emparant de tout ce qui permettrait une rentabilisation de la reconstruction, sous le prétexte de la sécurité… Considérablement affaiblie par la perte de tous leurs repères, la population après avoir été la proie de la nature devient celle des pouvoirs politiques… L’auteur touche alors à ce que cette tragédie a d’universel. Et le destin de cette famille du pêcheur n’est pas très éloigné, se dit-on, de celle des personnages de Visconti dans La terre tremble ou des habitants de Pompéi. Et probablement des victimes des séismes de Haïti, de Macerata et d’Amatrice.
René de Ceccatty
Kasumiko Murakami, Et puis après Traduit du japonais par Isabelle Sakai Actes Sud, 98 p., 13,80€
