 Elizabeth Goudge est ressuscitée, grâce au Mercure de France, et c’est une bonne surprise, d’autant que le Domaine enchanté (The Bird in the Tree, 1940),
Elizabeth Goudge est ressuscitée, grâce au Mercure de France, et c’est une bonne surprise, d’autant que le Domaine enchanté (The Bird in the Tree, 1940),
premier volume de la trilogie de la famille Eliot, qui est au cœur de son œuvre, n’avait jamais été réédité depuis sa première parution, en 1946, aux éditions Jéheber, disparues depuis. Espérons que l’éditeur aura la bonne idée de nous redonner à lire les deux volumes suivants, l’Auberge du pèlerin (The Herb of Grace, 1948, qui était disponible en Livre de poche, nº 208-209, à la fin des années 1950, ce qui fait quand même un bail) et la Maison des sources (The Heart of the Family, l953, introuvable depuis l’édition Plon de 1954).
Elizabeth Goudge (l900-l984), dont la quasi-totalité de sa petite trentaine de romans a été traduite entre l’immédiate après-guerre et les années l970, n’a pas eu la fortune posthume qu’ont connue chez nous ses contemporaines Daphné du Maurier ou Rosamond Lehmann, relues et réévaluées, et elle reste la plus méconnue des grandes romancières anglaises néovictoriennes du XXe siècle (Christine Jordis, dans son excellent Gens de la Tamise, ne la citait même pas).
Pour beaucoup, elle reste – en France, au moins, car en Angleterre elle a ses fanatiques, ses sites Internet, et elle continue à être éditée – une romancière sentimentale et datée, dont les titres les plus célèbres, – l’Arche dans la tempête, la Cité des cloches, le Pays du dauphin vert – fleurent bons les vieux livres de poche des années 1950-1960, aux tranches colorées et aux couvertures délicieusement illustrées, sans pour autant mériter qu’on prenne la peine de les relire, sinon en guise de madeleines d’enfance.
Et pourtant… pourtant, cette fille unique du doyen du collège de théologie de Wells, dans le Devon, puis d’Oxford, dont l’enfance a été partagée entre des villes médiévales, écrasées par leur cathédrale, et les vacances à Guernesey, chez ses grands-parents maternels, est l’une des romancières anglaises les plus singulières et les plus personnelles du XXe siècle, la plus sûre descendante des Brontë ou d’Elizabeth Gaskell. Son œuvre romanesque est dotée d’un charme, au sens magique du terme, d’une poésie secrète, entre mysticisme et légende, reconnaissables en quelques pages. De bons lecteurs, comme Jean-Pierre Sicre et Daniel Arsand, ont tenté, en vain, de lui redonner vie chez Phébus. Et mon amie Marianne Alphant la relit toujours avec la même admiration. C’est d’ailleurs elle qui, alors que nous parlions du Pays du dauphin vert, le seul de ses romans que je connaissais, m’a conseillé d’aller plus loin, de lire la trilogie familiale rééditée aujourd’hui, et ses romans situés dans les lieux de son enfance. Et j’ai été conquis.
Elizabeth Goudge aime les histoires de familles abondantes (peut-être parce qu’elle-même était fille unique et a vécu célibataire, en compagnie de ses parents, jusqu’à leur mort) et de vieilles maisons (qu’elle connaissait bien) toujours habitées par les souvenirs du passé. Elle aime les ambiances médiévales (même dans des décors contemporains) et les scènes de théâtre sur lesquelles des amateurs montrent d’anciens mystères. les romans, en général (hormis le célèbre Dauphin vert, qui commence dans les îles anglo-normandes chères à l’écrivain, mais s’achève en roman d’aventures chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, et l’Enfant venue de la mer, roman historique tardif et peu convaincant), sont dépourvus d’action trop visible, reposent sur une perception très personnelle des rapports humains, toujours éclairés par la lumière douce de la charité et de la compassion (charité évangélique qui n’a rien à voir avec le sentimentalisme).
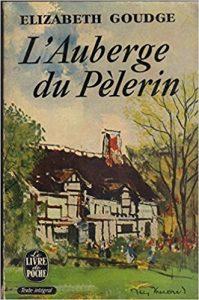
Je termine en précisant que, pour l’écrivain, cette trilogie représentait l’aboutissement de son œuvre. Marianne Alphant, en lectrice subtile et avertie, ne dirait sans doute pas le contraire. Moi non plus.
Christophe Mercier
Le Domaine enchanté, d'Elizabeth Goudge Traduit de l'anglais par Hélène Godard Mercure de France, 300 pages 21,8 €
Tweet
