 Sébastien Laudenbach, réalisateur de La Jeune Fille Sans Mains (source : Festival National du Film d’Animation)
Sébastien Laudenbach, réalisateur de La Jeune Fille Sans Mains (source : Festival National du Film d’Animation)
La première moitié du film est extrêmement sombre, très dure, voire cruelle., ce qui est assez rare pour un film d’animation. Pourquoi votre choix s’est-t-il porté sur ce conte des frères Grimm ?
En fait, ça paraît bête à dire, mais on pourrait dire que c’est plutôt lui qui m’a choisi. Il y a un peu de ça… Au départ, c’était une proposition d’un producteur, il y a plus de quinze ans, en 2001. Ce producteur m’avait proposé d’adapter une pièce de théâtre d’Olivier Py qui s’appelle La jeune fille, le diable, et le moulin, qui est elle-même l’adaptation de ce conte.

J’ai alors travaillé sur une première version du film qui était très différente de celle finalement produite. À tous les niveaux. Aux niveaux de la cible, du design des personnages, de la mise en scène, du scénario, et aussi de la production. C’était une production tout à fait classique, avec scénario, storyboards… On a fait des pilotes, j’ai travaillé avec une équipe. C’était vraiment toute une infrastructure.
On a finalement abandonné le projet en 2008 faute de financements. On n’a pas trouvé assez d’argent, donc on a dû renoncer au film sous cette forme-ci. Mais de mon côté, l’histoire ne me quittait pas.
J’ai donc voulu faire l’adaptation, à un moment donné, sous forme de bande dessinée, étant à la base dessinateur. Même si je n’avais jamais fait de BD, je me disais que ça pouvait être une voie intéressante, j’y repensais souvent.
J’avais aussi écrit une version pour être filmée en prises de vues réelles, dont je n’ai jamais rien fait (rires). Ce n’était pas vraiment un scénario, plutôt un synopsis d’une dizaine de pages.
Parallèlement à tout ça, j’ai réalisé des courts-métrages d’animation, j’ai enseigné, j’ai beaucoup expérimenté. Pour finalement arriver à un moment charnière, en 2012, année au cours de laquelle se sont passés pour moi deux événements décisifs.
D’une part, j’ai réalisé un court-métrage expérimental, lié à des recherches théoriques que je mène avec un groupe d’amis. Un groupe d’amis avec lequel on a fondé un groupuscule qui s’appelle l’Ouanipo, en fait une émanation de l’Oulipo – Ouvroir de littérature potentielle -, un groupe d’écrivains qui se sont mis ensemble dans les années soixante, autour en gros de Raymond Queneau et George Perec, dont le principe est de faire de la littérature à partir de contraintes formelles qui préexistent, afin de faire émerger des formes qui ne sont pas forcément attendues au départ. Les Oulipiens se définissent comme des rats construisant le labyrinthe dont ils se proposent eux-mêmes de sortir (rires). Donc à partir de l’Oulipo, il y a eu plusieurs sous-émanations disons « X-po », où à la place du X il y a eu autre chose que la littérature : l’Oupeinpo pour la peinture, l’Ocuipo pour la cuisine, l’Oubapo pour la bande dessinée qui est d’ailleurs assez active. Et donc l’Ouanipo, dans le cadre duquel on s’est réuni plusieurs fois, afin de définir un certain nombre de contraintes et de règles.
Et en 2012, je réalise un court-métrage avec une contrainte, sous ce label Ouanipo. Et je réussis à faire un film de douze minutes, en dix jours d’animations et un mois de post-production. J’expérimente donc là-dedansdes façons nouvelles – pour moi en tous cas – de faire de l’animation, très héritées pour certaines d’un film de Norman McLaren, qui s’appelle Blinkity Blank. Un film fondateur pour moi, comme d’autres films de McLaren d’ailleurs.
Parmi toutes les contraintes que Louanipo a mises en place, il y en a une qui vient de Blinkity Blank. Même si en fait, ce dernier n’y répond pas lui-même tout à fait. Cette contrainte, on l’a appelée la cryptokinographie.
Le principe de la cryptokinographie, c’est de faire une animation pour laquelle aucun des photogrammes qui composent l’animation n’est porteur du sens de cette animation.
Par exemple, on voit un monsieur qui passe avec un chariot. Mais sur aucune des images, on voit le monsieur avec le chariot. C’est-à-dire que ce n’est que le mouvement qui donne le sens.
Alors il y a plusieurs manières de répondre à la contrainte, et bien sûr, l’une d’entre elles est de donner des images parcellaires, d’enlever de l’information graphique. C’est ce que fait McLaren, même si lui joue dans Blinkity Blank sur des images totalement vides et des apparitions un peu iconiques de formes extrêmement synthétiques.
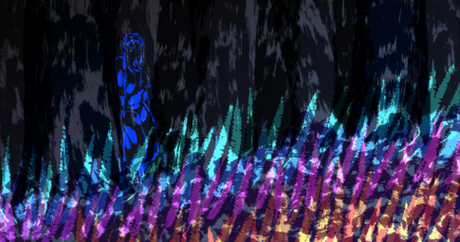
Donc une autre manière de répondre à cette contrainte est la décomposition des formes, et d’enlever de l’information au niveau graphique.
Donc je fais ce court-métrage en utilisant beaucoup la cryptokinographie, et je fais le constat que je suis arrivé à faire ce film de douze minutes en dix jours d’animation et un mois de post-production.
La même année, deux mois après, mon épouse passe le concours de la Villa Médicis, et m’annonce qu’on va partir pendant un an à Rome. Donc là je me dis « un plus un égal trois », peut-être que je peux faire tout seul ce long-métrage que j’ai laissé dans un tiroir, qui devait être prévu pour être fait par un studio, en l’occurrence Folimage.
Me voilà donc avec l’argent de ma femme, un bout de son atelier, son temps aussi… Donc merci ma femme (rires). Car c’était la première fois qu’un tel espace-temps m’était offert, et j’étais totalement prêt à relever le défi. C’était le bon moment pour moi de faire ça, et de faire cette adaptation du conte de Grimm.
À ce moment-là, je n’avais ni de producteur, ni les droits du premier scénario, ni les droits de la pièce de théâtre. Donc je suis reparti du conte qui, lui, est dans le domaine public.
Finalement, le film que vous avez vu est un film qui a été entièrement improvisé, du premier plan jusqu’au dernier. Sans avoir écrit de scénario, sans faire de storyboard. Au gré de mes inspirations.
Comment avez-vous réussi à obtenir ce résultat – vraiment bluffant – tout seul ?
Avec un peu de temps (rires). Mais aussi parce que je connaissais très bien le projet, c’était un moment de ma vie où j’étais prêt à faire ça.
Et puis je n’avais pas beaucoup de pression en fait. Je pouvais très bien me planter, il n’y avait pas d’enjeux. Pas de producteurs, pas de comptes à rendre. Donc si je me plantais, ce n’était pas très grave : au moins j’aurais passé du bon temps et essayé.
Alors une des choses que j’ai faite, c’est que j’ai tenu un blogue, au départ un peu pour fanfaronner auprès de mes collègues, « je vais faire un film tout seul » un peu en faisant le coq, mais surtout pour qu’on me surveille. Je voulais que les gens puissent m’accompagner dans ma démarche, ne pas être totalement esseulé. Je voulais me contraindre quand même à fournir des informations et des images aux gens.
Vous vous êtes donc occupé seul de l’animation, de la composition des images. Comment s’est alors passée l’intégration de la musique d’Olivier Mellano ? Comment êtes vous passé d’un travail purement personnel à un projet dans lequel est venu se greffer celui d’autres créatifs ?
En fait tout s’est fait très naturellement de ce point de vue. Je connais Olivier depuis très longtemps. On a fait d’autres films ensemble, et je voulais dès le départ, même lors de la première version du film, que ce soit lui qui en compose la musique.
Parce que je voulais que ce soit de la musique électrique, sur cette espèce de Moyen Age réinventé. Une musique contemporaine pour créer un décalage.
J’aime beaucoup la musique d’Olivier parce qu’elle apporte une dimension romanesque, un souffle. Elle amène une jeunesse, même je trouve une certaine idée de l’adolescence. Alors ça fait sûrement écho à ma propre jeunesse (rires), les jeunes aujourd’hui n’écoutent plus de rock, mais moi j’aime beaucoup en écouter.
Donc voilà, ça c’est fait un peu comme ça.

En fait quand je suis rentré en France, j’avais potentiellement quarante minutes de film. Que je n’avais pas vues, parce que le film étant fait sur papier, il me fallait du temps pour en faire la prise de vues, et je n’ai pas pris ce temps-là lorsque j’étais en Italie. Donc je n’avais aucune idée de ce que j’avais fait. J’avais quatre-cent soixante planches, j’en avais vues seulement trente.
Donc je me suis d’abord occupé de ces quarante premières minutes, puis un an après, j’ai repris l’animation pour aboutir à un premier montage. Et j’ai envoyé ce premier montage à Oliver, en lui disant « tu as carte blanche », et en lui demandant ce qu’il en pense.
La musique a été faite de manière très organique, tout a été fait de façon très organique d’ailleurs. Parce que le film, contrairement à tous les autres films d’animation, comme il n’y avait pas de storyboards, j’ai abouti à ce premier bout-à-bout avec énormément de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc je suis reparti en arrière, j’ai rajouté des plans, j’en ai enlevés d’autres. Dans une même journée, j’étais en animation, en post-production parce que je faisais la mise en couleur, en montage, et en écriture, puisque j’ai écrit les dialogues à la fin.
En fait je m’enregistrais, je voyais si ça fonctionnait. Quand ce n’était pas le cas, je changeais les dialogues, des scènes qui étaient muettes sont devenues dialoguées, et vice-versa… Il y avait beaucoup moins de dialogues au départ, j’en ai beaucoup rajoutés lorsque j’ai fait mes reprises de plans.
Et donc la musique a été enregistrée alors que le film n’était pas tout à fait terminé. Il y avait notamment des séquences sur lesquelles j’ai dit à Olivier « tiens, ce serait bien que tu me fasses une musique que je pourrais couper quand je veux », pour une séquence qui va raconter ça mais qui n’existait pas.
En gros Olivier m’a fait la musique en quelques jours, c’était très rapide.
La principale gageure de la musique est que celle-ci ne prenne pas le pas sur les émotions véhiculées par les images. Qu’elle ne soit pas omniprésente. Dans le cas de La Jeune Fille sans Mains, on peut voir que le dosage de ce point de vue a été très bien pensé.
Oui, le dialogue se fait assez bien entre la musique d’Olivier et mes images. Mais ça depuis toujours en fait, depuis qu’on travaille ensemble. On s’apprécie énormément, on se respecte beaucoup, et c’est quelque chose qui, je pense, se sent dans notre dynamique musique-images.
Concernant le son à proprement parler, Norman McLaren était notoirement connu pour faire émerger le son du grattage à même la pellicule. Dans La Jeune Fille Sans Mains, on a parfois l’impression que le son également proviendrait également du papier gratté. Est-ce quelque chose que vous avez utilisé sur le film ?
Absolument pas (rires). Non il y a eu un gros travail de son, j’ai eu un monteur son qui m’a accompagné dès que je suis rentré en France. Et qui a travaillé pendant pratiquement un an sur le film. Pas à temps plein, mais de manière ponctuelle. Et ça a été un très bon collaborateur.

Mais voilà, je souhaitais vraiment qu’il y ait ces trois niveaux de sons, entre le très factuel et le naturaliste, l’intermédiaire avec les dialogues, et le très abstrait avec la musique.
Est-ce également quelque chose que vous avez abordé à la fin ou en amont du projet ?
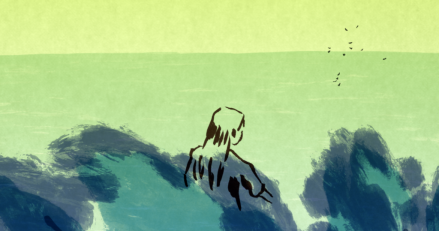
Je ne savais pas vraiment quoi faire avec ce personnage, donc je fais arriver la jeune fille à la rivière, elle hésite. Je me dis qu’elle va traverser la rivière, elle met les pieds dans l’eau… D’ailleurs, il y a beaucoup de plans à ce moment-là, ça m’a laissé le temps de réfléchir (rires).
Et donc ne sachant pas comment répondre à ma question, je savais qu’elle ne pouvait pas aller de l’autre côté, je me suis dit « pourquoi ne pas la faire couler ? ». Et c’est en la faisant couler que j’ai eu l’envie de créer cette déesse de l’eau, qui en plus est un personnage très important.
Donc j’ai monté ces trois minutes-là, j’ai tout de suite écrit les dialogues, alors que quand j’ai animé la scène, je savais que les personnages allaient se parler, mais je ne savais pas ce qu’ils se disaient. Donc j’avais prévu des bouches qui bougent, sans savoir ce qu’ils allaient bien pouvoir se dire.
Pourrait-on dire que vous avez principalement fonctionné à l’intuition ?
Énormément. Jusqu’au bout en fait. D’ailleurs je n’ai toujours pas vu le résultat final. Je n’arrive pas à voir le film terminé, justement à cause de cette intuition probablement. Le fait que je sois derrière tout, et que tout soit issu de quelque chose de très profond, de non réfléchi. Il y a quelque chose de très animal en fait dans tout ça.
Mais ce qui était très agréable, c’est que je n’ai jamais eu l’impression d’exécuter quoi que ce soit. Mais de toujours construire comme on fait un modelage : on ajoute, on retranche, et ça à n’importe quelle étape de la fabrication. Alors qu’en animation, on passe normalement notre temps à valider des trucs.

On valide le scénario, puis on va faire un storyboard, qu’on va à son tour valider. Puis chaque étape de l’animation va être validée… Alors que pour La Jeune Fille Sans Mains, je n’ai validé que le film au final.
Jusqu’au dernier moment, il y a eu des changements. Le film aurait pu basculer, il était constamment mouvant. Je crois que cet aspect organique, très instinctif et donc un peu animal de la fabrication se retrouve dans le trait, qui est vraiment un geste. Et je crois qu’au-delà de ce dont le film parle, au-delà du sujet, c’est ce qui rend le film vivant.
Or en animation, les films ont tendance, je trouve, à être des films morts. Je pense que je n’aime pas beaucoup l’animation actuelle à cause de ça. Voir des films très verrouillés, qui peuvent être très beaux, mais qui sont fermés.
Seriez-vous prêt, pour vos projets futurs, à retenter ce genre d’expérience ?
Je crois que je voudrais trouver un entre-deux. Le film m’a appris plein de choses, et a été plus fort que moi bien souvent. Quelque part c’est lui qui m’a dicté sa voie, mais il est clair qu’on ne peut pas faire tous les films comme ça.
D’un autre côté, je n’ai pas non plus envie de perdre la liberté que j’ai eue.
Donc je me pose la question, et je suis en train de me la poser très concrètement car j’ai déjà un nouveau projet en gestation. Que je n’ai pas envie de faire tout seul, mais que je n’ai pas envie de faire comme un film d’animation normal non plus (rires). Il sera sans doute plus classique disons dans l’approche.

Donc je n’ai pas envie de faire ce film tout seul, mais comment faire pour que la liberté que j’ai eue puisse être mise en place dans un autre contexte ?
Alors une des pistes, c’est de me dire qu’une fois de plus, je pense que je ne vais pas faire de storyboard. Je vais improviser le film, même si j’ai un scénario et les dialogues que j’ai écrits, avec ma femme.
Donc j’ai déjà dit au producteur qu’on allait faire le film comme ça, sans storyboard dans sa continuité, et puis on verra.
Alors bien sûr, ça fait que c’est compliqué de travailler avec d’autres personnes. Ça veut dire que je vais faire au moins les phases principales de l’animation tout seul. Mais comme j’adore dessiner…
Je me rend compte d’une chose, c’est que le cinéma d’animation est extraordinaire, la palette du langage est extrêmement vaste dans l’animation. C’est génial ! Quand on regarde les courts-métrages d’animation, on voit que cette palette est employée à plein. Il y a une grande liberté visuelle et narrative dans les courts-métrages. Que l’on ne retrouve plus du tout dans les longs-métrages. Le langage cinématographique des longs-métrages est en gros un langage de prises de vues réelles, et c’est même bien souvent un langage de prises de vues réelles un peu pauvre, très classique en fait.
Et ça, qu’on aille chercher du côté de Disney, de Miyazaki… Alors il y a quelques contres-exemples bien sûr. Je pense d’ailleurs que Takahata est un très bon contre-exemple.
On m’évoque souvent la parenté qu’il peut y avoir entre La Jeune Fille Sans Mains et Le Conte de la Princesse Kaguya, dans l’approche de l’animation. En particulier cette séquence au cours de laquelle la princesse s’enfuit, qu’elle court.

En fait j’ai vu Kaguya alors que j’étais en train de faire ce film, donc il était déjà largement commencé, mais c’est sûr que La Jeune Fille Sans Mains répond de ce travail.
Takahata, c’est un défricheur, c’est quelqu’un qui cherche, qui se remet tout le temps en question. C’est pour ça que c’est pour moi un très grand réalisateur. Il ne se repose jamais sur quelque chose d’acquis. Alors j’adore les Miyazaki également (rires). Mais Takahata possède ce côté chercheur qui me parle davantage.
Donc voilà, je me demande pourquoi les longs-métrages d’animation ont un langage qui doit se réduire à de la prise de vue réelle, même si c’est bien fait ou maîtrisé.
Je pense qu’on doit utiliser tout ce que l’animation nous permet d’utiliser. Sachant qu’elle a une grosse carence intrinsèque, c’est qu’il n’y a pas d’êtres humains, pas de visages. Et que la puissance d’une expression, d’un regard, d’un souffle, et d’une émotion qui passent en un instant sur un visage, on ne l’a pas en animation. Mais c’est une erreur grave que d’essayer de la reproduire.
C’est la même problématique que l’on retrouve actuellement en jeu vidéo. Ça ne fonctionne pas, parce que ce ne sont pas des êtres humains. Alors ça peut éventuellement fonctionner si l’on est très très proche de la représentation humaine de façon très photo-réaliste, mais quel est l’intérêt ? Alors qu’il y a un vrai intérêt en animation à justement s’éloigner du réel.
C’est pour ça qu’il y a des films de McLaren qui m’émeuvent. Par exemple, Synchromy est un film qui m’émeut, alors que c’est un film purement abstrait, mais avec une animation très forte, très puissante.
Cette distance avec le réel nous permet d’en parler, mais d’une autre manière. C’est vraiment pour moi la force de l’animation.
Interview donnée à la Cinémathèque Québécoise



