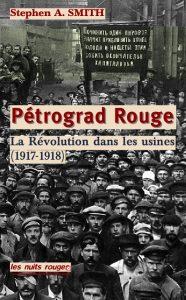 Pétrograd rouge n’est pas un livre récent, mais c’est un livre important pour appréhender la Révolution russe. Issu d’un travail de thèse de l’historien britannique Stephen A. Smith et publié il y a plus de trente ans en anglais, l’ouvrage est enfin traduit en français dans le contexte du centenaire de la Révolution russe. Ses qualités sont telles qu’on ne peut que s’en féliciter. Depuis plusieurs décennies, l’historiographie de l’URSS et de la Révolution russe a été bousculée par ce que l’on a appelé les « historiens révisionnistes », attachés avant tout à décrire l’épaisseur du contexte social russe dans la trajectoire révolutionnaire puis post-révolutionnaire. Dans ce courant historiographique, les principaux acteurs politiques sont ainsi mis en retrait par rapport aux classes et aux couches sociales, et l’analyse des discours officiels se voit complétée par celle des pratiques quotidiennes de la population, de ses représentations et de ses mentalités. L’étude de la façade institutionnelle et officielle du pays – que ce soit pour la diaboliser comme le fait l’historiographie conservatrice, ou pour la louer comme le faisait l’historiographie soviétique officielle – se voit enrichie par la prise en compte de tout un pan dissimulé de la réalité soviétique, très éloignée des motions de congrès et des directives du Politburo.
Pétrograd rouge n’est pas un livre récent, mais c’est un livre important pour appréhender la Révolution russe. Issu d’un travail de thèse de l’historien britannique Stephen A. Smith et publié il y a plus de trente ans en anglais, l’ouvrage est enfin traduit en français dans le contexte du centenaire de la Révolution russe. Ses qualités sont telles qu’on ne peut que s’en féliciter. Depuis plusieurs décennies, l’historiographie de l’URSS et de la Révolution russe a été bousculée par ce que l’on a appelé les « historiens révisionnistes », attachés avant tout à décrire l’épaisseur du contexte social russe dans la trajectoire révolutionnaire puis post-révolutionnaire. Dans ce courant historiographique, les principaux acteurs politiques sont ainsi mis en retrait par rapport aux classes et aux couches sociales, et l’analyse des discours officiels se voit complétée par celle des pratiques quotidiennes de la population, de ses représentations et de ses mentalités. L’étude de la façade institutionnelle et officielle du pays – que ce soit pour la diaboliser comme le fait l’historiographie conservatrice, ou pour la louer comme le faisait l’historiographie soviétique officielle – se voit enrichie par la prise en compte de tout un pan dissimulé de la réalité soviétique, très éloignée des motions de congrès et des directives du Politburo.
Une classe ouvrière originale
Stephen A. Smith s’inscrit tout à fait dans cette démarche « révisionniste » et c’est très logiquement que son livre, Pétrograd Rouge. La Révolution dans les usines (1917-1918), débute par une histoire de la classe ouvrière de la capitale de l’Empire russe, bien avant la chute du régime. L’identité sociale de cette classe est importante pour comprendre ses modalités d’intervention politique dans le contexte de la Révolution. La classe ouvrière de Pétrograd était sur certains points une classe sociale en rupture avec les autres classes populaires russes. Bien avant la révolution, elle s’avérait nettement plus éduquée que la paysannerie : sur ce point le développement culturel d’une ville où la population est alphabétisée à 80 % en 1920 contre 33 % au niveau national l’avait marqué. Elle était ainsi politisée et les partis socialistes y obtenaient depuis longtemps un vrai écho. Toutefois Stephen Smith montre bien des spécificités par rapport au modèle de la classe ouvrière de l’Europe occidentale : les traditions issues de l’artisanat qualifié n’existaient pas et, les qualifications requises restant limitées, il n’y avait pas d’authentique « aristocratie ouvrière » russe. Du fait de la répression antisyndicale, les conditions salariales étaient très médiocres, surtout si on les met en relation avec des loyers prohibitifs qui encourageaient l’entassement des familles dans des appartements aux conditions sanitaires désastreuses. En effet, la croissance démographique de la ville avait entrainé une forte spéculation immobilière, dans un contexte d’incurie urbaine : une partie des quartiers ouvriers de la ville n’étaient toujours pas pavés avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L’attractivité d’une capitale qui accueillaient de nombreuses usines modernes, et parfois d’origine étrangère, bouscula la classe ouvrière locale : elle fut ainsi composée en partie d’ouvriers fraichement installés et conservant de fortes attaches rurales, qui se concrétisaient par l’envoi d’argent au village ou la détention d’un lopin de terre. Avec l’entrée en guerre, on constate une recrudescence de l’embauche de jeunes ouvriers et de femmes, notamment dans l’industrie textile où les unités de production sont plus petites.
Stephen Smith montre ainsi avec clarté les lignes de clivage qui touchaient la classe ouvrière de la ville : l’archétype du métallurgiste masculin et socialiste, alphabétisé et politisé était loin de correspondre à toutes les aspects d’un prolétariat en pleine recomposition. En 1914, l’ouvrier prolétaire traditionnel n’était donc pas numériquement majoritaire. Pourtant, même traversée par des différences sociologiques, la classe ouvrière allait se montrer une classe mobilisée lors des événements révolutionnaires de 1917.
L’apparition des comités d’usine
Le récit de Stephen Smith s’accélère lorsque la Révolution de février éclate. Les comités d’usine deviennent des nouveaux acteurs du récit, et ce d’autant plus qu’une loi du nouveau gouvernement provisoire entérina leur existence le 23 avril. Éclipsés par les soviets, absents de l’État et la révolution de Lénine, les comités d’usine (fabzavkom), apparus très vite dans les usines du pays, jouèrent pourtant un rôle important dans les événements. Ils naquirent dans les usines d’État puis s’étendirent rapidement aux autres industries, se subdivisant en comités d’ateliers et se couronnant d’un Comité central des comités d’usine (CCCU). Même si l’activité à la base, dans les ateliers et les fabriques, est le point de gravité des comités d’usine, ceux-ci organisèrent des congrès dès mai 1917 qui finirent pas être « panrusses » et donc à portée nationale. L’analyse de ces congrès et ses motions permet à Stephen Smith des allers-retours éclairants du haut vers le bas et du bas vers le haut. Cela l’incite à tordre le coup à quelques lieux communs.
Non, les comités d’usine n’étaient pas de sensibilité libertaire, sinon de manière marginale. Si l’on retrouvait en leur sein toutes les sensibilités du mouvement ouvrier, des mencheviques aux anarchistes, les comités d’usine ne se conçurent jamais comme une alternative à l’organisation étatique. Très tôt, ils appelèrent à l’intervention de l’État dans l’économie russe, puis durant la deuxième partie de l’année 1917, à l’instauration d’un État prolétarien et ils ne pensèrent jamais se substituer à ce dernier. Cela n’excluait évidemment pas des exigences de gestion démocratique dans les usines, une question d’autant plus sensible que l’usine tsariste était incontestablement autoritaire et vexatoire, notamment après 1914. Les ouvriers de Pétrograd, peu habitués à la discipline industrielle puisque souvent d’origine rurale, étaient très sensibles aux comportements de la hiérarchie, aux amendes et aux humiliations. D’une manière ou d’une autre l’activité des comités d’usine ouvrit la problématique du « contrôle ouvrier » dans les lieux de production.
Dans le contexte du délitement de l’économie russe et de la perturbation des chaines de production, les comités devaient intervenir parfois hors de tout contexte légal : ils surveillaient l’acheminement des matières premières, les répartissaient entre usines du fait de la pénurie généralisée, géraient la discipline au travail et les cadences contre l’autoritarisme des contremaîtres, mais aussi contre l’absentéisme croissant chez les ouvriers, ils bloquaient des licenciements… Ils vont jusqu’à se pencher sur les comptes des entreprises, à s’intéresser aux carnets de commande. Il y a toute une forme d’auto-activité de la part d’une classe dominée assez fascinante même si Stephen Smith, dans sa description, évite tout romantisme révolutionnaire : il s’agissait avant tout pour les comités d’usine de faire survivre les structures de production dans un contexte d’effondrement généralisé. Et l’analyse des comptes financiers était souvent bien difficile même pour des ouvriers qualifiés.
« Le patron a disparu »
On comprend pourquoi la revendication de nationalisation fut émise très tôt par les comités d’usine : ces nationalisations permettaient d’éviter les fermetures, dans une situation de sabotage ou de fuite des patrons. Bien souvent les capitalistes ne supportaient pas le contrôle ouvrier ou s’avéraient surtout soucieux de conserver ce qu’il restait de leurs biens. Cette radicalité précoce des comités d’usine dans lesquels les bolcheviques furent majoritaires dès mai 1917, donc bien avant de l’être dans les soviets, explique qu’ils approuvèrent aussitôt la révolution d’octobre 1917. Cette communauté de point de vue avec la direction du parti bolchevique explique d’ailleurs que Lénine a tenu d’emblée, dès novembre 1917, à soumettre un décret sur le contrôle ouvrier devançant même les attentes des organes dirigeants des comités d’usine. Smith identifie ainsi un « moment libertaire » chez Lénine qui dura plusieurs mois et durant lesquels il fit preuve d’une grande confiance envers les masses populaires.
Toutefois, le déroulé des événements le fit changer d’avis : les complications économiques se multiplièrent tout comme les conflits non seulement entre les patrons et les ouvriers, mais aussi entre les salariés (notamment entre les ouvriers et les ingénieurs, les techniciens et les contremaîtres). Des tensions entre les syndicats et les comités d’usine sur leurs champs de compétence respectifs obscurcirent les choses. Alors que des masses d’ouvriers avaient quitté la capitale faute de travail, ou pour participer au partage des terres, et que les plus politisés intégraient les rangs de l’Armée rouge, le gouvernement bolchevique décida finalement la nationalisation de toute l’industrie qui ne l’était pas encore en juin 1918. Puis, pour redresser la productivité devenue catastrophique, il imposa la direction unique dans les usines. Les comités fusionnèrent avec les syndicats et eurent pour tache de soutenir la productivité au point devoir parfois justifier la réintroduction des primes voire du salaire aux pièces.
Stephen Smith produit toutefois un portrait nuancé des derniers temps des comités d’usine : s’il déplore le tournant autoritaire dans les usines, qui mena à des acrobaties théoriques pour justifier ce qui était condamné quelques mois auparavant, il pointe bien les contraintes très lourdes qui pesaient sur le gouvernement bolchévique. Il constate aussi que l’héritage du contrôle ouvrier et des comités d’usine ne fut pas balayé du jour au lendemain : en 1920, à Pétrograd, 69 % des usines pratiquaient encore la direction collégiale et non la direction unique, malgré les consignes données par Moscou depuis deux ans. Cette attention très fine de Pétrograd Rouge aux réalités locales et à leurs contradictions, fonde largement l’intérêt d’un ouvrage qui se caractérise aussi par une empathie distanciée mais réelle envers les ouvriers de la ville, et qui s’avère donc hautement recommandable.
Baptiste Eychart
Stephen A. Smith, Pétrograd Rouge. La Révolution dans les usines (1917-1918) Les Nuits rouges, 434 pages, 17 €.
Please follow and like us:
