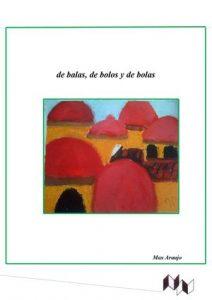 Né au Guatemala en 1950, Max Araujo est écrivain et promoteur culturel. Il a fait des études de philosophie et de littérature à l’Université Rafael Landivar de Guatemala. Diplômé de l’Université Mariano Galvez, il est également avocat et notaire. Il a représenté le Guatemala auprès du CERLALC. Il est aujourd’hui vice-ministre de la culture.
Né au Guatemala en 1950, Max Araujo est écrivain et promoteur culturel. Il a fait des études de philosophie et de littérature à l’Université Rafael Landivar de Guatemala. Diplômé de l’Université Mariano Galvez, il est également avocat et notaire. Il a représenté le Guatemala auprès du CERLALC. Il est aujourd’hui vice-ministre de la culture.
Max Araujo est l’auteur d’un recueil de poésies : Atreviéndome a ser, de différents livres de contes comme, par exemple, Cuentos, fábulas y anti fábulas (1980), Puros cuentos los de mi abuelo y otros cuentos (1990), Cuentos del Des-amparo (1996). Il a, par ailleurs, publié différents essais sur la législation et la gestion culturelle ainsi que sur le droit des populations indigènes dans le domaine culturel : Las Utopias aún son posibles. Joseph Wresinski: una solución para América Latina (2007) ou encore La Legislación cultural internacional y su incidencia en la cultura de Guatemala (2011). Son œuvre a été récompensée par le prix national de littérature en 1988.
Le texte, inédit en français, que nous traduisons et publions ici, est extrait de l’ouvrage De balas, de bolos y de bolas (De balles, de rumeurs et d’ivrognes), édité en 2014 chez Nueva Narrativa, lequel réunit de courtes nouvelles dont certaines sont autobiographiques. Des récits qui ont d’autant plus de force qu’ils vont à l’essentiel et disent tout à la fois : le plaisir, l’amour, la violence, la mort, la résignation et la souffrance. Ils permettent à Max Araujo d’aborder les problèmes sociaux et culturels de son pays avec originalité et talent.
Marc Sagaert
Ce que l’eau a emporté
Cette nuit-là, il a plu des cordes. Quelques maisons ont roulé sur les versants de la montagne. Les chiens ont aboyé jusqu’au petit matin. A midi, on compta les morts. Des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des hommes et des femmes ! Ma tante Clotilde, qui à ce moment-là était rentrée des Etats-Unis — où elle était partie quand elle était jeune et belle et où elle avait découvert à l’époque comment on pouvait payer les services de la migra, en ouvrant les jambes et en fermant les yeux — a commencé à prier sans s’arrêter. C’est pour vos âmes, mon fils, me dit-elle, et nous nous sommes agenouillés à prier tous ensemble. A peine avions-nous commencé le troisième Notre Père, que le chat de la voisine commença à miauler. Les poules et les coqs se joignirent au tapage et une horde de rats passèrent entre nos jambes. « C’est le diable », a crié ma grand-mère et elle s’est évanouie. Le bruit de sa chute et nos cris firent que l’oncle Aurelio se leva de sa chaise et laissa son journal. Pourquoi tant de désordre ? demanda-t-il et il s’empressa d’ajouter : « avec tant de vacarme, je n’ai même pas pu lire les pages littéraires ». « Toi no voir que mam Genara est tombée, lui répondit tante Clotilde ; toi ne rien respecter parce que cette cabane où tu vis, avoir été construite avec les dollars, que moi envoyer tous les mois. Ou toi avoir oublié ? » J’écoutais sans y prêter attention ce dialogue et je n’ai réagi que quand l’oncle Aurelio m’a demandé d’aller chercher le docteur Carlos René García, qui avait sa clinique au coin de la rue, voisine du magasin de donia Chon, la femme qui vendait de la cusha (1) aux charamileros (2) du village. J’étais à peine sorti de la maison et je marchais dans la rue quand j’entendis un bruit retentissant et qu’une quantité d’eau et de boue est arrivée sur moi et m’a entrainé deux pâtés de maison plus bas, près de chez les Aguilar, célèbres pour les combats de coqs qu’ils organisaient. Je me suis agrippé comme j’ai pu au balcon de la fenêtre de leur maison et je suis monté sur le toit. Depuis mon poste d’observation, j’ai vu les voitures, les lits, les chaises, les ustensiles de cuisine, les vaches, les morceaux de bois et autres objets passer devant moi, également arrachés par le courant, comme la Luisa, complètement nue, montée sur un vieux coffre, qui était la fierté de son mari, un collectionneur d’antiquités qui affirmait que ce meuble avait appartenu au général Justo Ruffino Barrios, un de ses ancêtres. C’était la première fois que je voyais une femme comme Dieu la fit venir au monde. Je ne pensais pas, à ce moment-là, que quatre ans plus tard, la même Luisa, alors qu’elle était veuve et moi un adolescent qui commençait à faire des rêves érotiques, m’initierait aux plaisirs de l’amour. Je n’oublie pas cette première fois, il m’en souvient très bien, il était six heures du matin ce jour de jeudi saint où je suis passé chez elle pour lui donner deux litres de lait du négoce de traite que possédait mon oncle Lalo. Mets le réveil veux-tu, me dit-elle, et elle m’a tiré jusqu’à sa chambre. J’ai accédé à sa demande avec joie, et pendant deux ans, tel l’étalon poussé par l’instinct va retrouver sur la montagne son endroit favori, je n’ai cessé de faire, presque chaque jour, cette délicieuse gymnastique matinale, jusqu’à ce que mon oncle Lalo me surprenne et se propose d’apporter lui-même le lait à la Luisa. Ce qui devait être sa perdition, provoquer son divorce, et permettre à la tante Silva de récupérer tous ses biens. Raison pour laquelle, saisi d’une fureur de cochon, il finira par vivre avec les ivrognes du village, jusqu’au jour où une cirrhose l’emportera vers une vie meilleure.
C’est ce jour fatidique à six heures qu’ils ont retrouvé ma grand-mère, l’oncle Aurelio et la tante Clotilde. La maison leur était tombée dessus. Ils survécurent par miracle. La tante Clotilde, avec les jambes dans le plâtre, est retournée aux Etats-Unis. C’est là qu’à sa mort ils l’enterrèrent. Mamá Genara s’est retrouvé en chaise roulante pour la plus grande joie de mes neveux qui l’emmenaient partout. Ils la firent tomber plusieurs fois mais cela n’alla pas plus loin que la peur et quelques remontrances. Elle est morte dans son lit, il y a vingt ans. En odeur de sainteté, dit ma cousine Chus, responsable de la catéchèse de la paroisse de notre village. C’était une âme de Dieu, comme l’est aujourd’hui ma cousine Caroline, devenue bonne sœur deux jours après l’inondation et le glissement de terrain. En remerciement, dit-elle, parce que personne de la famille n’est mort ce jour-là. Mon oncle Aurelio après cet évènement a formalisé sa situation avec la fille de don Paco Escobar, le propriétaire terrien d’origine espagnol, possédant les principaux terrains de la région. A la mort de ses beaux-parents, il hérita de l’administration de leurs biens. Aujourd’hui, il a trois gardes du corps. Il a toujours été comme un père pour moi. C’est lui qui a financé mes études et qui s’est occupé de moi jusqu’à ce que j’obtienne ma licence à l’université San Carlos. Aujourd’hui je suis avocat.
Cette catastrophe naturelle a marqué un avant et un après dans ma vie et celle de ma famille. A ma manière, j’en suis sorti gagnant. Comme dit justement le dicton, « A quelque chose malheur est bon », cependant le village ne s’en est pas encore remis, on voit toujours les traces de la tragédie. Plusieurs de ses maisons n’ont pas été reconstruites. D’un point de vue architectonique, le village a perdu son identité. Et cela s’est encore aggravé dans les années 80, avec le conflit armé, quand nombre de ses jeunes se sont enrôlés dans la guérilla et que la contre-insurrection a fait des siennes. Beaucoup de ses voisins furent assassinés et d’autres ont fuis.
Ainsi vont les choses dans ce pays de balles, de rumeurs et d’ivrognes.
Max Araujo
(1) Cusha : liqueur artisanale fermentée (2) Charamilero : alcoolique buvant de l’alcool bon marché
