 « On dit que Dieu prit dans sa main un peu d’argile et fit tout ce que vous savez. L’artiste à son tour (s’il veut vraiment faire œuvre créatrice divine) ne doit pas copier la nature mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. » (Paul Gauguin, Cahier pour Aline, Tahiti, 1891).
« On dit que Dieu prit dans sa main un peu d’argile et fit tout ce que vous savez. L’artiste à son tour (s’il veut vraiment faire œuvre créatrice divine) ne doit pas copier la nature mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. » (Paul Gauguin, Cahier pour Aline, Tahiti, 1891).
Entre autres blockbusters de la rentrée artistique, deux grandes expositions célèbrent deux créateurs qui ont marqué la fin du XIXe et le début du XXe siècle, par leur exceptionnelle créativité, leur non-conformisme, allant pour l’un jusqu’à faire parler de « sauvagerie » (revendiquée), pour l’autre à confronter le visiteur à un « fauve ». Ne modérons pas notre impression : les deux expositions consacrées à Gauguin au Grand Palais et au Derain des années 1904-1914 au Centre Pompidou sont éblouissantes. Rompant délibérément, farouchement, avec les canons, même les innovations, qui les précèdent, l’un et l’autre ont fait preuve d’une audace, d’une volonté de renouvellement, d’une puissance créatrice, qui en font des « phares » de leur temps, selon l’expression baudelairienne, jusqu’à aujourd’hui.
Pourtant, l’un comme l’autre font l’objet de suspicions. Pour Derain, on sait que c’est son évolution ultérieure qui a fait problème. D’abord son « retour à l’ordre », après 1920, qui lui a fait se renier (ou se sentir impuissant : « Comment peindre après tout ce que nous avons vécu ? ») et se rendre aux Maîtres dont il s’était d’abord éloigné et qui l’ont conduit à une production beaucoup moins dérangeante que celle de ses premiers chefs d’œuvre. Puis, devenu une sorte d’icône, « plus grand peintre français vivant » (André Lhote, 1920), ce qui lui a nui, il participe, peut-être contraint, au malencontreux « voyage à Berlin » des artistes, en 1941, et en acquis l’opprobre pour longtemps : de son vivant et ensuite. Pour Gauguin, l’abandon (la répudiation ?) de sa famille au Danemark, patrie de sa femme, puis la fréquentation de très jeunes filles et jeunes gens à Tahiti et aux Marquises, dans la dernière partie de sa vie (1891-93, 1895-1903), posent la question de l’exploitation colonialiste. Cette accusation est ainsi portée contre une sorte de prédateur plus ou moins conscient, que libèrent les mœurs du pays où il mène une existence d’ailleurs modeste, hostile au clergé et aux fonctionnaires, mais qui peut aujourd’hui paraître scandaleuse.
Dans les deux cas, les expositions n’insistent pas sur ces aspects controversés des deux artistes. En ce qui concerne Derain, l’éclatement d’une personnalité très cultivée, curieuse, créatrice, apparaît avec un éclat fascinant, reconnu par Gertrude Stein qui en fait, plus tard, « le Christophe Colomb de l’art moderne » (mais elle critique son incapacité à poursuivre dans les voies inédites qu’il a inventées), ou le jeune André Breton qui obtient de lui deux gravures pour Mont de piété (1919) et lui reconnaît la qualité de peintre « du trouble moderne ». Doué, audacieux, tel il apparaît dès ses premiers dessins des années 1900 et suivantes, telle apparaît aussi son utilisation de la photographie. Le Bal à Suresnes, grande huile de 1903, qui met en scène un petit militaire tout concentré dansant avec une grande femme raide, est un exemple amusant et dérangeant (on peut voir la photographie, sa mise au carreau, et le tableau, venu de Saint-Louis, Missouri). Puis des événements novateurs se font jour : l’amitié avec un Vlaminck, alors lui aussi très révolutionnaire, qui conduit au fauvisme, à une représentation du paysage, à Chatou notamment, sur les bords de la Seine, au Pecq, des arbres noués et colorés selon la vision de l’artiste, comme on n’a jamais eu l’audace de la faire. Les rencontres et les lieux, l’effet de leur lumière, se diversifient avec Matisse, lui-même portraituré de façon inattendue (toiles de Nice, de la Tate à Londres, 1905), les paysages de Collioure, de l’Estaque, plus tard de Londres où il a été envoyé par Vollard en 1906-07, et d’où il revient avec des peintures qui se différencient de celles de Monet par leur stylisation, leur force et leur diversité (Hyde Park, Quais de la Tamise, divers Ponts, Big Ben …), jusqu’à l’éclosion pure, abstraite, des couleurs (Effets de soleil sur l’eau à Londres). Le rassemblement de ces toiles – dont plusieurs avait été présentées à la rétrospective Derain de 1994 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris – convainc du talent immense du peintre.
Qui n’est pas seulement peintre d’ailleurs, car il est à l’avant-garde, avec Vlaminck, pour s’intéresser aux arts dits « premiers » aujourd’hui, œuvres océaniennes et africaines notamment, vues au British Museum et décrites (avec dessins) à Vlaminck, puis au Musée ethnographique du Trocadéro, celles susceptibles ensuite d’influencer le Picasso des Demoiselles d’Avignon et du cubisme. Il est aussi sculpteur et graveur – on sait, entre autres, la qualité de ses illustrations pour L’Enchanteur pourrissant d’Apollinaire (publié en 1909).
Cette capacité de renouvellement, qui s’allie aux amitiés et aux admirations (pour Cézanne, influençant ses Baigneuses de 1908-09 et ses paysages) conduit jusqu’à la guerre à des œuvres majeures, peut-être tempérées par déjà un certain réalisme qui l’éloigne du renouvellement continu des formes et des inspirations de Picasso et, alors, de Braque. Puis on doit constater ensuite, après une guerre éprouvante, que Derain, aussi talentueux se soit-il montré, n’a pas fait preuve de la même imagination, et s’est coulé dans des moules plus acceptables par une société qui le célébrait – jusqu’à la compromission, peut-être isolée (il n’a pas été un « collaborateur ») de 1941, chère payée ensuite. Peut-être l’emprise du succès social explique ce conformisme, ce compromis. « Matisse et Derain », écrit Breton dans Le Surréalisme et la peinture en 1928, « sont de ces vieux lions décourageants et découragés ». Et, plus méchamment : « ils sont passés à cette arène minuscule : la reconnaissance pour ceux qui les matent et les font vivre. »
Certaines des qualités que nous évoquons pour le Derain des années 1904-14 sont aussi celles de Gauguin, à commencer par la volonté de rompre avec la facilité de reproduire ce qui a été fait, pour « au fond de l’inconnu, trouver du nouveau ». Aussi détecte-t-on chez Gauguin une double aspiration à la recherche et à la fuite. Sa recherche le conduit à multiplier les façons de s’exprimer, presque en se croyant « fou », certainement « tourmenté par l’art » (Lettres à Schuffenecker, 1885), mais convaincu, presque désespérément, de son talent (« Je suis un grand artiste et je le sais. C’est parce que je le suis que j’ai enduré tellement de souffrances », Lettre à son épouse Mette, 1892). C’est ce que l’exposition du Grand Palais cherche à démontrer en insistant sur la diversité de ses modes d’expression, des supports et des matériaux utilisés : toile, papier, gravure, bois, meubles, céramique…, écrits aussi – dans un style sans apprêt mais non sans vigueur qui peut parfois faire même penser à Dubuffet. On peut lire par exemple des passages de ses pamphlets contre l’État, l’Église, l’administration, la « pourriture coloniale », dans divers écrits, dont Le sourire, journal confidentiel rédigé à Tahiti en 1899 ; puis dans le journal Les guêpes.
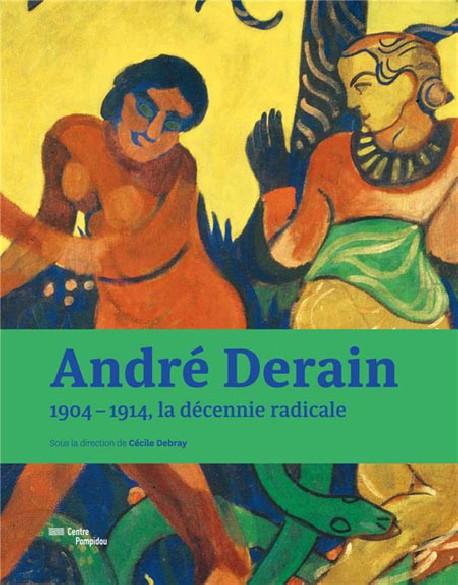
L’exposition présente en effet des bois encadrant la maison de Gauguin (la dernière, modeste, aux îles Marquises) sous le titre de La maison du jouir. Elle contenait aussi ces expressions gravées : « Soyez mystérieuses » et « Soyez amoureuses, et vous serez heureuses », le tout d’inspiration (se voulant) naïve, mais annonciatrice de l’intérêt ensuite porté aux arts premiers (intérêt que Gauguin manifeste aussi dans ses Cahiers, comme celui consacré à « L’Ancien culte mahorie »). Ce désir de jouissance, lié à sa curiosité pour le pays qui l’a accueilli dans son désir de fuite, « en sauvage », de l’Occident, en fait-il un pervers, de surcroît séduisant ou profitant de trop jeunes vahinés ? On a souvent plutôt tendance, à le lire, ou à relever les rares témoignages de ceux qu’il fréquentait, à le voir comme très malade, insatisfait, morbide même.
Si, dans le cas de Derain, l’interrogation sur ses compromis, surtout avec une société courbée, conformiste, autant par soumission à l’académisme, qu’à la collaboration ensuite, lui a été contemporaine, et a reculé jusqu’à maintenant l’intérêt pour le novateur du début du siècle, les suspicions morales sur Gauguin ne sont que de notre temps, et semblent assez anachroniques. Gauguin semble avoir surtout été animé, jusqu’à la passion, à la démesure, par un souci démiurgique de création, d’ailleurs, d’excès. Cette démarche intense justifie le jugement esthétique que l’on peut porter sur un explorateur passionné et extrême de ce qui pouvait être dit par son art, et dont l’effervescence, la sauvagerie revendiquée, émeuvent. Les jugements moraux sont souvent portés par des « armchair moralists » — expression empruntée à l’historien d’art Dario Gamboni. Peut-être, avec le recul du temps, doit-on d’abord retenir l’empathie, qui porte sur la trace, sur l’éblouissement de l’œuvre, incontestables, plus que sur l’homme, friable, inéluctablement friable ?
Philippe Reliquet
André Derain, 1904-1914, La décennie radicale Centre Pompidou, jusqu’au 29 janvier 2018. Gauguin, l’alchimiste Grand Palais, Paris, jusqu’au 22 janvier 2018.
