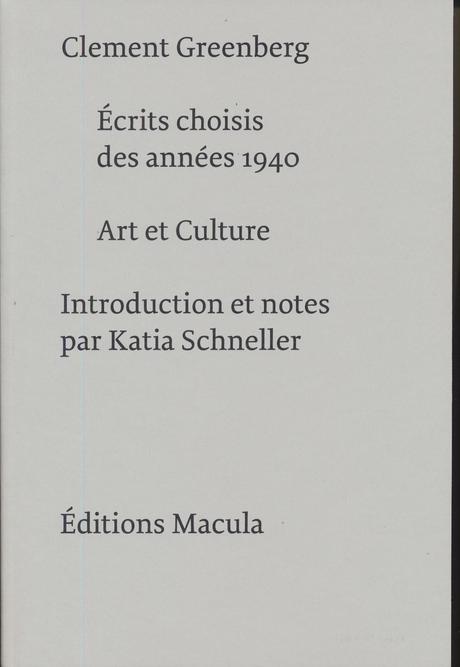 Le peintre Jules Olitski a raconté que lors des visites d’atelier, Clement Greenberg attendait, le dos tourné, que la toile soit installée avant de se retourner pour en capter d’un seul coup l’impression d’ensemble. C’est en effet comme cela que le grand critique formaliste américain procédait : « par surprise », parce que le tableau doit être un éclair, une rencontre-éclair, une illumination…
Le peintre Jules Olitski a raconté que lors des visites d’atelier, Clement Greenberg attendait, le dos tourné, que la toile soit installée avant de se retourner pour en capter d’un seul coup l’impression d’ensemble. C’est en effet comme cela que le grand critique formaliste américain procédait : « par surprise », parce que le tableau doit être un éclair, une rencontre-éclair, une illumination…
Katia Schneller, qui a rassemblé la plupart des écrits du célèbre critique d’art dans un très gros volume pour les éditions Macula, explique savamment que cette approche rappelle un passage du Laocoon de Lessing, qui décrit la « beauté physique » comme « un effet concordant produit par plusieurs parties qui sont embrassées par l’œil d’un seul regard, en une seule fois. »
Un des tout premiers essais de Greenberg s’intitule précisément « Pour un Laocoon plus actuel ». Il date de 1940 et développe les enjeux esthétiques déjà esquissés dans « Avant-garde et kitsch », qui date de 1939, et qui ouvre son célèbre livre Art et Culture qu’il a publié en 1961, aux Etats-Unis, que les éditions Macula avaient traduit en 1968, avant de le reprendre aujourd’hui dans ce monumental volume, la somme, la bible de ce pape de la critique formaliste américaine, Clement Greenberg, qui fut aussi « l’homme le plus détesté du monde de l’art ».
Dans Pour un Laocoon plus actuel, Greenberg renverse la division proposée par Lessing entre la poésie et les arts plastiques, qui doivent s’échapper de la littérature, dit-il ; car Greenberg est celui qui entend réduire l’art à son « medium » (la toile et la peinture) ; il est celui aussi qui veut non seulement bannir la mimésis de l’art abstrait, mais également l’imagination. La liberté de peindre est alors conçue comme une libération de toute forme d’icône, au point d’être une sorte d’« aniconisme », comme l’a expliqué Hans Belting dans son ouvrage Le Chef-d’œuvre invisible (Jacqueline Chambon, 2003). Au fond, Greenberg est celui qui exhorte les jeunes artistes à ne pas faire d’images, à bannir l’iconographie, à détruire l’espace pictural réaliste, à détruire peut-être même aussi la peinture…
Néanmoins – et cela peut paraître paradoxal -, il ne se situe pas dans la position de rupture – de tabula rasa – défendue par son rival Harold Rosenberg, avec qui il fut le porte-parole de l’expressionnisme abstrait de l’école de New York. Greenberg est en vérité influencé par un critique littéraire et poète comme T.S. Eliot, qu’il présentait comme le fondateur de la nouvelle école de critique littéraire anglophone ; car de la même façon qu’il faudrait avant tout se concentrer sur le ressenti, l’expérience, et chercher à comprendre le sens général d’un texte au lieu de vouloir le décrypter, il faudrait avoir une pensée critique à l’égard de l’histoire et de son medium : « Pour être vraiment grand, le grand art doit reprendre tout ce qui le précède », dit Greenberg.
C’est tout l’objet de son article intitulé « De la nécessité des grands maîtres », ou encore de celui intitulé « Peinture à l’américaine », qui est le dernier texte qu’il publie dans Partisan Review, en 1958, où il reconnaît que plusieurs peintres de l’expressionisme abstrait nourrissent un véritable goût pour les maîtres anciens : c’est en effet le cas pour de Kooning, par exemple, qui a beaucoup regardé les tableaux de Tintoret, à Venise. Mais il n’est pas sûr que Greenberg ait réellement apprécié l’art de de Kooning, beaucoup trop proche de celui de Picasso, qu’il n’a jamais trouvé bon au-delà des années 1920…. De Kooning et Picasso : ce sont des peintres à femmes, pas suffisamment avant-gardistes. Or Greenberg croyait avant tout en l’avant-garde qui seule pouvait sauver la qualité de la culture face à l’invasion du kitsch – le résultat, selon lui, d’une culture de masse issue de la révolution industrielle.
Greenberg – toujours un peu arrogant – disait que le kitsch fournissait aux masses une culture « d’ersatz ». Il était alors un jeune marxiste qui aspirait à l’idéal perdu de la « culture formelle ». Surtout, il avait un autre modèle à proposer : celui de l’école de Hans Hofmann, peintre émigré qui rejetait toute iconographie figurative. Hofmann était pour lui un maître ; il disait en tout cas que l’appellation de « maître » lui paraissait justifiée pour nul autre plus que lui dans le courant « expressionnisme abstrait ». On a pourtant un peu oublié Hofmann, et on se souvient encore bien des Women de Willem de Kooning, tout comme on n’oubliera sans doute jamais les Demoiselles d’Avignon de Picasso… Mais on ne va pas tout ramener à l’affaire WOMEN, le film du siècle, comme l’avait fait Philippe Sollers dans son réjouissant De Kooning, vite, qu’il avait publié aux éditions de La Différence, en 1988 (réédité en 2007), et où il disait par exemple du cubisme, autour duquel Clement Greenberg tourne beaucoup, pour dire son déclin, qu’il était « une façon de tenir à distance et d’encadrer par le dessous du dessus, et de tous les côtés à la fois, le déferlement imminent des incubes et des succubes »…
Il est vrai que Clement Greenberg nous fait un peu l’effet du prêtre troyen Laocoon, fils de Priam et d’Hécube, qui avait désobéi à Apollon en s’unissant à son épouse devant l’autel du dieu, et qui fut alors condamné à être étouffé par des serpents avec ses deux fils. Cet épisode fut d’abord chanté par Homère, dans l’Iliade, puis par Virgile dans son Enéide, qui le représente en train de hurler de douleur. Pour Winckelmann, l’auteur de l’Histoire de l’art dans l’Antiquité, Laocoon – dans le groupe sculpté du 1er siècle avant note ère, découvert à Rome en 1506 et offert au pape Jules – ne crie pas mais « gémit » et se « plaint » ; pour Lessing, il ne peut pas crier, car un cri ferait un trou hideux dans la pierre (ce qui ne serait pas conforme à la loi d’harmonie de la statuaire antique). Mais pour Clement Greenberg ?
Faut-il s’en remettre à Pierre Bourdieu qui disait dans son cours du collège de France de 1998-2000, consacré à Manet et que l’on peut lire dans son ouvrage Manet. Une révolution symbolique (Seuil), que « si l’on a fait une analyse suffisamment conséquente, on peut comprendre pourquoi Greenberg voit ce qu’il voit et pourquoi il ne voit pas ce qu’il ne voit pas, et du même coup lui prendre ce qu’il voit tout en disant qu’on sait pourquoi il ne voit pas ce qu’il ne voit pas et qu’il faut le réintroduire pour voir complètement ce qu’il ne voit pas. » C’est aujourd’hui chose faite avec ce livre magistral de ses Ecrits choisis des années 1940, Art et Culture (introduction et notes par Katia Schneller) où l’on voit que l’homme le plus détesté du monde de l’art apparaît bien comme le théoricien par excellence du Modernisme dans le domaine des arts plastiques. Car Greenberg, après tout, c’est peut-être Byzance qui nous tend ici la coupe de la critique d’art…
Didier Pinaud
Clement Greenberg, Ecrits choisis des années 1940, Art et Culture Introduction et notes par Katia Schneller Editions Macula, 312 pages, 20 €
