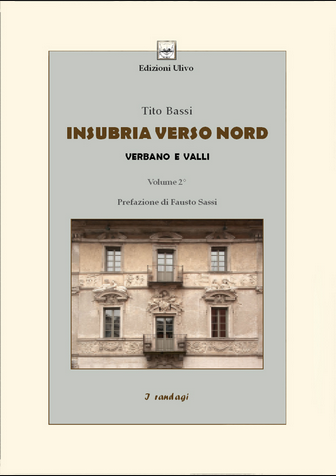 Tito Bassi est né en Suisse italienne et a vécu jusqu’à son adolescence dans la région de l’Insubrie en Lombardie, une région très présente dans plusieurs de ses récits. Il vit au Guatemala depuis le début des années soixante-dix. Tito Bassi est l’auteur de plusieurs romans et de différents tomes de mémoires, publiés en Suisse, au Guatemala et en Espagne. L’auteur de Mala Vida et de El Molino del oso, raconte dans Gavilan Blues l’histoire d’un jeune Guatémaltèque issu d’une famille conservatrice de propriétaires terriens, qui découvre son attirance pour les hommes. La Bella Nin, que nous publions ici pour la première fois en français, est un fragment de sa tétralogie autobiographique Insubria verso nord. Romans d’initiation, de chronique et de voyages, ces récits sont non seulement le portrait d’une époque mais encore l’analyse de réalités sociales et culturelles qui prennent sous la plume de l’auteur une résonance particulière.
Tito Bassi est né en Suisse italienne et a vécu jusqu’à son adolescence dans la région de l’Insubrie en Lombardie, une région très présente dans plusieurs de ses récits. Il vit au Guatemala depuis le début des années soixante-dix. Tito Bassi est l’auteur de plusieurs romans et de différents tomes de mémoires, publiés en Suisse, au Guatemala et en Espagne. L’auteur de Mala Vida et de El Molino del oso, raconte dans Gavilan Blues l’histoire d’un jeune Guatémaltèque issu d’une famille conservatrice de propriétaires terriens, qui découvre son attirance pour les hommes. La Bella Nin, que nous publions ici pour la première fois en français, est un fragment de sa tétralogie autobiographique Insubria verso nord. Romans d’initiation, de chronique et de voyages, ces récits sont non seulement le portrait d’une époque mais encore l’analyse de réalités sociales et culturelles qui prennent sous la plume de l’auteur une résonance particulière.
Marc Sagaert
La Belle Nin
La dernière maison en direction du coteau de Ceneri, appartenait à la « Belle Nin », une femme âgée dont le surnom avait quelque chose de malicieux, parce qu’elle n’était aucunement belle, bien au contraire, avec ses traits masculins qui incommodaient ma mère, quand je lui disais que cette femme « se rasait, avait l’air d’un homme et travaillait comme un homme ». Intrigué et plein de malice, je revenais toujours sur ce thème et mon père, avec la diplomatie qui le caractérisait disait « mon enfant, un peu de prudence, les apparences sont parfois trompeuses ! »
La Nin portait sur la tête un fichu serré derrière la nuque comme les pirates, et moi j’étais ravi de l’accompagner sur la colline où elle avait une cabane pour le pâturage d’été, dans laquelle elle gardait au frais le beurre et autres produits laitiers, et je devisais avec elle au long du chemin sur les oiseaux et les croyances populaires dont elle était experte. C’est ainsi que j’appris que selon nos ancêtres, le chant du hibou est de mauvais augure et que le cri de la chouette annonce, la nuit, la lamentation d’une âme abandonnant cette vallée de larmes. Je pensais : « Elle veut me donner la frousse ». Et elle y arrivait, évidemment. Et mes nuits se faisaient plus ténébreuses encore, lorsque tapi au fond des draps, je croyais entendre les sinistres bruits de la forêt.
Cette femme étrange, qui maniait une canne à la main droite, et qui selon certain, hurlait les nuits de pleine lune et maudissait son prochain, faisait peur à beaucoup de monde. Comme je l’ai dit, son visage était peu féminin. Elle portait des pantalons sous la robe, et ce fichu sur la tête, qui, si elle l’avait porté comme les vieilles du village, aurait encore plus effrayé parce qu’il aurait reflété la parfaite caricature des sorcières de contes pour enfant. Elle était cependant affable avec moi et je la saluais quand je passais devant chez elle. J’essayais seulement d’éviter ses baisers parce que j’avais en horreur la barbe hirsute et mal rasée de son menton.
Assise sur un banc, la Nin se mettait parfois à battre la crème avec un vieil ustensile de bois. Une espèce de batte dont le disque perforé à l’extrémité était pris dans un cylindre de douves vertical opportunément bloqué entre ses jambes. Une demie heure plus tard, grâce au mouvement rythmé du manche entre ses mains, la crème devenait une masse compacte qui, pressée dans des moules également en bois, se changeait en petites briques de beurre. Une fois enveloppées dans un papier de parchemin, celles-ci étaient prêtes à la vente.
Il me paraissait surprenant que de toutes les maisons anciennes du village, la sienne fut la seule dont la fumée du fourneau s’échappait librement par les pierres plates du toit sans passer par un conduit spécifique et que, même ainsi, elle noircissait pas autant les murs de sa maison que ceux des cuisines moins rustiques qui possédaient une cheminée. Il m’est arrivé de la questionner à ce sujet et elle me répondit de manière laconique que le secret était « de savoir renvoyer la fumée ». Sa réponse est restée gravée pour toujours dans ma mémoire. Car, en fin de compte, dans la vie, en ce qui concerne les événements ou les personnes, le secret réside également dans la manière de « savoir renvoyer la fumée ».
En attendant, je continuais à déranger les miens avec mes doutes sur le sexe de la Nin, les assurant que, dans sa maison, elle cachait quelqu’un. « Ou elle parle toute seule, ou elle cache un homme là-dedans » affirmais-je avec beaucoup de sérieux. « Elle l’appelle Negrín » insistais-je. En fait, non sans malice, j’étais convaincu qu’il s’agissait d’Artemio, un voisin du coin qui maraudait effrontément déguisé en femme. « Artemio est fou » disait les gens avec bienveillance, l’absolvant ainsi de pires considérations. « Et toi, morveux, arrête de nager en eau trouble, ne mets pas ton nez où il ne faut pas », me sermonnait mon père.
Un jour enfin, j’ai découvert le vrai Negrín. J’ai demandé à la vieille, de manière franche et directe, à qui elle parlait aussi familièrement derrière les portes. Elle m’invita d’un signe de tête à entrer dans la maison tout en s’exclamant à tue-tête « Negrín, Negrín, viens ici, n’aie pas peur, celui-là, c’est le fils de la Marruja (c’était le petit nom de ma mère quand elle était enfant). Marruja, Marruja, Marruja, répéta la voix râpeuse d’un resplendissant corbeau noir de jais qui les ailes déployées traversa toute la largeur du local avant de se poser sur l’épaule de sa patronne. Ses yeux ronds et brillants me faisaient peurs, et, chaque fois que la Nin me parlait, celui-ci, furieux et jaloux, tirait de son bec puissant l’unique boucle d’oreille qu’elle portait à l’oreille droite, comme si il voulait l’arracher. Et elle, lui attrapant doucement le bec avec la main, lui disait en signe de reproche « Tu exagères, laisse-moi parler, laisse-moi parler », comme quelqu’un qui réprimande un enfant mal élevé ou un mari sénile.
Mais comme le motif de ma visite ce jour-là était d’acheter du beurre pour ma mère, la Nin m’impressionna encore plus quand elle demanda à Negrín les clés du cadenas et que l’oiseau s’en alla en sautant jusqu’au fond de la maison et revint quelques secondes après avec la clé pendu au bec, suspendue à un lacet. Il se reposa quelques instants sur l’épaule pour lui familière de la vielle dame, puis, acte suivant, vola jusqu’au verrou de la porte de la cave qui restait toujours fraiche. Pendant que l’on se rapprochait de lui, il répétait avec insistance : « Beurre, beurre, ruaaak ».
Quand, avec l’aide de mon père, j’ai voulu en savoir plus sur le fascinant oiseau, j’ai vu dans l’encyclopédie familiale que les corbeaux sont monogames et qu’ils ont la vie longue, et cela a attisé mon imagination parce que je savais que les animaux sauvages en période d’accouplement perçoivent l’appel de la nature et, de fait, s’ils ne sont pas attachés ou en cage, s’en vont. Cependant, ce corbeau vivait et a vécu de nombreuses années sans être aucunement attaché, et n’a jamais, sous aucun motif abandonné Nin.
Un jour, j’ai accompagné le curieux couple au Mont Ceneri et nous avons cheminé sur le sentier des salamandres, appelé ainsi en raison de l’abondance ici de ces lézards noirs aux taches jaunes et oranges, qui m’ont toujours captivé. Le corbeau voletait nous devançant de cinquante mètres en cinquante mètres et la Nin disait : « allons au Muscendro ! » (nom du mont Ceneri en dialecte). Et Negrín répétait : « Muscendrooo, Muscendrooo, crrac, crrac. » A un moment donné, pendant une pause sur le chemin, alors que j’avais entre mes mains une salamandre capturée dans le riachuelo que nous venions de traverser, le vorace Negrín, a volé et s’est posé sur mon avant-bras. Alors, en une fraction de seconde, il attrapa la pauvre salamandre, la redressa de deux habiles petits coups de bec, fit un dernier mouvement et l’engloutit d’un coup me regardant avec insolence comme s’il me demandait si je n’en avais pas une autre. (…)
De quel genre était finalement la Belle Nin, au profond de son cœur ? Et, puisque nous y sommes, comment se sentait le pauvre Artemio, son voisin, qui, ayant été déclaré fou par les gens du village, ne faisait plus peur à personne quand il s’habillait en femme ? (…)
Tito Bassi
